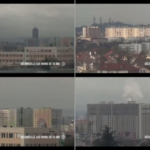Comment parler de la périphérie ?
L’art du dissensus contre le regard policier
Ce texte fait partie du dossier « Images indociles », dirigé par Raphaël Szöllösy et Benjamin Thomas. On peut lire leur introduction et consulter la liste des textes ici.
Prendre position
À rebours de l’imagerie médiatique dominante, l’art documentaire travaille à donner forme à un autre « partage du sensible » selon les termes désormais tant cités de Jacques Rancière. Si à l’échelle de la production sonore et visuelle globale cet art occupe une position minoritaire, à l’intérieur du milieu intellectuel où ces objets circulent essentiellement, le désir d’explorer des régimes de visibilité alternatifs est largement partagé.
En abordant l’écriture de ce texte dont le projet est d’étudier l’énonciation de périphéries urbaines chez l’artiste Till Roeskens, j’éprouvais une sorte de découragement ou, du moins, une inquiétude. Quel besoin d’un énième texte venant redire la force dissensuelle des images de l’art, à l’intérieur d’une petite communauté déjà sensible à leurs formes et acquise à leur cause ? N’est-il pas plus urgent de participer à faire résonner ces voix au-delà du cercle restreint des « amis » que nous sommes ? Et, au fond, ces images résistantes ont-elles besoin de nos discours pour accomplir leur humble projet ?
L’inquiétude ressentie au moment d’écrire – attablée loin des espaces dont mon texte a la prétention de parler – se dissout en partie en franchissant, devant mon ordinateur, la frontière symbolique qui sépare art cinématographique et journalisme télévisuel, en particulier lorsqu’il s’agit de représenter les quartiers populaires. Ces deux types de production audiovisuelle sont le plus souvent analysés séparément dans le champ académique, selon des problématiques et des approches distinctes – sociologique ou esthétique, pour le dire vite. Pourtant, la mise en regard de l’indocilité raréfiée des images de l’art et du flux des reportages télé a un effet saisissant. Tout contre le spectacle hallucinatoire et pourtant ordinaire du journal de BFMTV ou des émissions du type Pièces à conviction (France 3), Enquête exclusive (M6), Enquête d’action (W9), 90’ enquête (TMC), l’importance politique de redire la force d’images autres s’impose.
Au fond, écrire ici sur quelques images indociles « n’a pour rôle, quelles que soient les techniques mises en œuvre, que de dire enfin ce qui était articulé silencieusement là-bas »[11][11] Michel Foucault, L’Ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, p. 19., pour reprendre les termes par lesquels Michel Foucault qualifie tout travail de commentaire. Cette démarche naît d’un espoir ténu mais lancinant : celui d’accroître la sensibilité à des formes de pensée alternatives mais aussi, en examinant attentivement ces tactiques esthétiques, celui de faire circuler leur force politique dans d’autres objets et d’autres situations vécues. Dans le processus de politisation que nous vivons actuellement, toutes les micro-forces critiques et inventives sont bonnes à prendre.
Mais comment les initiatives indisciplinées peuvent-elles parvenir à se rassembler, autrement que sous la forme de la sympathie réciproque ou de la juxtaposition sans montage ? C’est à cette difficulté que se heurtaient frontalement les mouvements sociaux français – en particulier Nuit Debout, au printemps 2016 – il y a encore quelques années. Plus récemment, les Gilets jaunes, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, le renouveau des luttes féministes et antiracistes sont parvenus en certaines occasions à faire mieux converger des voix fragmentées, par-delà le clivage entre centre et périphéries, urbaines et rurales. Comment et à quel niveau le travail de lecture des images, qui cherche à rendre compte de la manière dont certaines formes nous affectent, peut-il prendre part à un mouvement de convergence des sensibilités et des revendications ?
Pour réfléchir à cette question, il m’apparaît que le travail d’un artiste inquiet comme Till Roeskens permet de dessiner des ouvertures. Je souhaite aborder deux de ses œuvres documentaires – un moyen-métrage : Un Archipel (prod. Khiasma, 2012) co-réalisé avec Marie Bouts et une performance filmée : Plan de situation #7. Consolat-Mirabeau (prod. La Cité maison de théâtre, 2009-2012). Ces réalisations ne valent pas ici comme simples objets d’un commentaire fait à leur propos. Il s’agit tout autant d’y puiser des manières de faire pouvant nourrir nos pratiques intellectuelles et militantes. Car la question de l’énonciation périphérique, au-delà des images des banlieues parisiennes et des quartiers nord de Marseille discutées ici, concerne plus généralement l’invention en acte d’un imaginaire social qui défait les hiérarchies et tente d’instaurer des circulations, là où d’autres érigent des frontières.
Police partout
Des travaux en sciences de la communication et en sociologie des médias se sont chargés de dresser un panorama large de la représentation des banlieues à la télévision française. Guy Lochard s’est ainsi penché avec Henri Boyer sur l’histoire du traitement de la « question des banlieues » entre 1950 et 1994, dont il souligne qu’elle est « un “condensé” de phénomènes sociaux plus généraux et distincts mais qui sont amalgamés et rabattus par la logique du discours informatif sur un lieu symbolique chargé de tous les maux. »[22][22] Lochard Guy, « La « question de la banlieue » à la télévision française. Mise en place et évolution d’un conflit de représentations », Images et discours sur la banlieue, Toulouse : ERES, « Questions vives sur la banlieue », 2002, p. 17. Pour approfondir la question voir : Boyer Henri et Lochard Guy, Scène de télévision en banlieues, 1950-1994, L’Harmattan, Paris, 1998. Selon Jérôme Berthaut, cette dynamique s’est maintenue au cours des dix dernières années[33][33] Voir : Galpin Guillaume, Entretien avec Jérôme Berthaut, « Dix ans après, le traitement médiatique des banlieues n’a pas changé », 29 octobre 2015.. Celui-ci signale que, depuis le début des années 2000, la stigmatisation des habitants des quartiers populaires, souvent d’origine immigrée, tend même à s’accentuer, du fait de la place de plus en plus importante occupée par les faits-divers dans les reportages et journaux d’informations télévisés. Ses travaux montrent que ce phénomène est dû à la logique toujours plus forte de rentabilité, mais aussi à la réalité quotidienne des pratiques professionnelles, caractérisée par une proximité et une dépendance grandissantes entre journalistes et sources policières, incitant les premiers à adopter le point de vue des secondes sur les sujets traités[44][44] Berthaut Jérôme, Darras Éric, Laurens Sylvain, « Pourquoi les faits-divers stigmatisent-ils ? L’hypothèse de la discrimination indirecte », dans Réseaux 2009/5 (n° 157-158), p. 89-124..
Si l’enquête de terrain sociologique donne à comprendre la complexité des dynamiques de production des images médiatiques, l’analyse des « textes » audiovisuels permet de décrire la logique stigmatisante qui y est effectivement à l’œuvre, quelle que soit le degré d’intentionnalité qui y a présidé[55][55] Jérôme Berthaut met en effet en garde sur le fait que les études formelles tendent souvent à simplifier l’intentionnalité qui est à l’origine de ces regards stigmatisants.. Parmi le foisonnement de reportages sécuritaires sur « banlieues » et autres « quartiers sensibles » qui nous proposent de plonger dans le quotidien d’un service de police de terrain, j’aimerais me pencher sur le cas de Violences urbaines. Chroniques du 93 (prod. Beta Prod, 2010), réalisé par Pascal Dupont et diffusé à la télévision sur France 4. La lecture des premières minutes du film permet d’en dégager les grands principes formels et discursifs.
Après un bref générique en lettres blanches, type « machine à écrire », sur fond noir, le film s’ouvre sur des images tournées au téléobjectif, depuis un point surélevé : des panoramiques latéraux balaient rapidement le paysage urbain et s’arrêtent ou zooment sur des ensembles de tours ou des barres d’immeubles au loin. En arrière-plan apparaissent à plusieurs reprises la Tour Eiffel ou la butte Montmartre. Cette première séquence met en scène un regard panoptique qui, à distance et depuis le centre de la capitale, scrute la périphérie : les choix de cadrage se réfèrent explicitement aux mouvements d’une caméra de surveillance. Sur fond de musique électronique rythmée, la voix virile du réalisateur introduit sa démarche en adoptant le ton sérieux caractéristiques des journaux télé :
Il y a deux ans, je réalisais un film sur la BAC des nuits parisiennes, durant celui-ci civils et policiers m’interrogeaient : « Pourquoi ne franchis-tu pas la barrière du périphérique ? Là-bas, tu passes de un flic pour cent habitants à un flic pour cinq cents. » Dès lors, je m’intéressai au 9-3, département atypique dans lequel on trouve près de deux cents cités, dont un quart d’entre elles sont dites sensibles. Il est réputé… le plus criminogène de France. Je décide d’aller voir de mes propres yeux. Est-ce vraiment une zone de non-droit ? Assistons-nous à une évolution plus globale de notre société ?
D’un dispositif panoptique, on glisse alors vers une démarche pseudo-ethnographique : le journaliste devient l’explorateur curieux et courageux, qui délaisse un temps son chez soi pour s’aventurer dans des contrées hostiles mais exotiques – une démarche qui, incidemment, pourrait lui en apprendre un peu plus sur sa propre culture…
De nombreux reportages sur les périphéries urbaines partagent avec le film de Dupont une affinité avec le régime discursif de l’ethnographie coloniale, comme constitution d’un savoir objectivant sur un autre posé comme lointain, dans le temps et dans l’espace [66][66] Voir à ce propos : Fabian Johannes, Le temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son objet, Toulouse : Anacharsis, 2006.. Que le contenu des représentations soit négatif ou « positif », la domination symbolique s’exerce à travers la forme même de l’énonciation, qui fabrique un partage violent entre « nous » et « eux », respectivement sujets et objets de la représentation.
Le générique continue et affiche le nom de l’auteur puis le titre du reportage, tandis qu’en off les voix confuses et inquiètes d’un émetteur de police se mêlent à des bruits de sirène. La musique techno reprend, tandis que se succèdent rapidement à l’écran des plans d’interventions policières tournées de nuit en caméra portée. Le commentaire reprend et va jusqu’à se faire le porte-parole du ministère de l’intérieur, selon lequel :
la Seine-Saint-Denis est un laboratoire de la sécurité. C’est pourquoi une nouvelle unité sillonne le département d’un bout à l’autre. … Ils sont quotidiennement au contact de la délinquance.
Le reporter explique alors avoir passé un mois d’hiver en « immersion » auprès des policiers. L’enchaînement des événements commence : dès le premier soir, deux blessés par balle, la caméra embarque dans la voiture du commandant fonçant sur les lieux. À quelques sept minutes du film, nous sommes déjà au « Jour 7 – 23h30 – Cité du Gros-Saule (Aulnay-sous-Bois) » : l’information s’affiche en bas à gauche de l’écran, telle une fiche d’identification dactylographiée.
Après une énième intervention, le journaliste déclare : « À ce stade de mes observations, je ressens le besoin d’un regard extérieur, je rends visite à Xavier Raufer, célèbre criminologue, afin qu’il m’aide à décrypter mes impressions. » Dans son bureau parisien, le vieil homme blanc en costume livre ses interprétations :
Vous savez qu’aux États-Unis ce n’est pas comme en Europe, ce sont les centres-villes qui sont problématiques et les banlieues qui sont bourgeoises et donc on a ce qu’on appelle « inner-city culture », la culture des centres-villes avec certaines manières de s’habiller, certaines manières de parler, tout ça s’est répandu comme une traînée de poudre à l’intérieur de la jeunesse un peu désœuvrée, un peu marginalisée en Europe, et ça leur sert de sous-culture commune. C’est la raison pour laquelle que vous alliez à Barcelone ou à Stockholm, vous avez dans la périphérie des villes européennes, des gens habillés de la même façon et qui tendent à avoir les mêmes mœurs qui sont une sorte de fascination et de culte pour ce qui est illicite et dangereux : les stupéfiants, les bagarres, etc, voilà, c’est une sorte de fonds commun. Vous avez affaire à des gens, qui en tant qu’adolescents s’agrègent parce que… c’est un défi aux adultes, parce que ça permet de s’affirmer, parce que c’est un stade de la vie dans lequel le développement même de leur cerveau les pousse à agir comme ça.
Ce discours est entrecoupé d’images censées illustrer le propos : des vues de l’intervention nocturne précédente, montrant quelques jeunes en tenues de sport, de loin, sur fond de barres d’immeubles.
À aucun moment dans le film, le reporter inquiet ne cherchera à trouver des réponses aux questions qui le taraudent en se tournant vers d’autres interprétations de la réalité sociale, qui trancheraient avec la ligne officielle. Hormis quelques paroles saisies sur le vif du terrain, le seul témoignage d’une « civile » hors intervention est celui d’une femme noire pauvre, mère de famille, représentante de la bonne citoyenne qui élève ses enfants honnêtement, et vit dans la peur et l’insécurité. Sa parole se trouve complètement intégrée à la mise en scène policière : en ne filmant que ses mains, le réalisateur la fond dans la figure stéréotypée de la « victime » ou du « témoin ».
Le film épouse ainsi parfaitement la perspective des forces de l’ordre et de celui qu’il présente comme autorité détentrice du savoir, un chercheur partisan d’une politique de la répression, dont les raccourcis interprétatifs, au mieux opèrent un réductionnisme psychologique dépolitisant, au pire, frôlent le déterminisme biologique au parfum colonial. Le « célèbre criminologue » s’avère être un ancien militant d’extrême droite, chercheur spécialiste du terrorisme et de l’insécurité urbaine, qui fustige dans ses écrits la « culture de l’excuse » nourrie selon lui par certains sociologues qui justifient les actes criminels [77][77] Voir à ce propos Laurent Bonelli, « France, Grande-Bretagne, Espagne, les suspects font désormais office de coupables. Quand les services de renseignement construisent un nouvel ennemi », in Le Monde diplomatique, avril 2005, p. 12-13.. Or, cette place d’énonciation n’est jamais rendue explicite pour le spectateur. Le pacte documentaire en est perverti : le film étant mis en scène comme une enquête, née d’un besoin d’analyse, le discours purement idéologique de « l’expert » se voit accorder le statut d’interprétation informée et objective.
Le travail formel de Dupont colle également au point de vue policier : parallèlement à l’entretien avec le criminologue, le montage rapide, la musique dramatisante et les éléments typographiques font clairement écho à l’esthétique de séries de fiction, dans lesquels le spectateur est invité à être en empathie avec les enquêteurs. La caméra talonne toujours les forces de l’ordre : elle regarde les habitants des cités depuis la position du policier qui part à l’assaut, faisant d’eux des silhouettes menaçantes. Le floutage anonymisant, censé être une marque de respect pour le droit des personnes, semble être plutôt ici l’occasion de redoubler la logique de désubjectivation de « jeunes délinquants » qui, de sans voix – le film se charge de parler pour eux – se voient également privés de visage.
Ce glissement vers la disparition des habitants des quartiers filmés est frappante dans les reportages d’émissions policières tels 90’ enquête, qui ont au moins le mérite de ne pas se cacher derrière un désir de savoir. Par exemple, dans le reportage diffusé en 2016 « La BAC en action dans les banlieues chaudes », la complicité avec les policiers est totale et l’objectif s’assume comme spectaculaire : les « quartiers chauds » ne sont plus que des décors pour des scènes d’action qui empruntent leur perspective aux jeux vidéo du genre « first person shooter » – la caméra est souvent fixée à même l’uniforme du policier – peuplés d’« individus » ou de « voyous » présumés coupables. Le « jeune délinquant » devient une figure entièrement fantasmée, sans personnalité propre ni histoire singulière, dont la « violence » échoue à être interprétée par des discours collés à l’ici et maintenant du fait divers.
Qu’un reportage comme Violences urbaines, qui fait sans détour le jeu d’une idéologie raciste et sécuritaire[88][88] La diffusion du reportage a été annoncée sur le site d’extrême-droite « Fdesouche »., ne soit pas une production confidentielle, mais un film de 52 minutes diffusé sur une chaîne publique à une heure de forte audience, symptomatise la banalisation contemporaine du regard policier sur les quartiers populaires. Coproduit par France télévisions et diffusé sur France 4 dans la case documentaire « Nouveaux regards » en décembre 2010 à 20h35, puis rediffusé près de dix fois entre 2010 et 2013, le reportage de Pascal Dupont dépasse les 1,5 million de vues sur les différents comptes vidéo en ligne qui le relaient. Contre cette force de frappe, que peuvent quelques images cinématographiques dissensuelles ?
Certaines initiatives émanant des quartiers populaires empruntent la voie de la déstigmatisation. C’est le cas, par exemple, de la société de production Nouvelle Toile, basée à Aubervilliers, dont les courts-métrages comme Fais croquer (2011) de Yassine Qnia ou La Virée à Paname (2013) de Carine May et de Hakim Zouhani ainsi que leur long-métrage Rue des Cités (2013) cherchent explicitement à revenir sur les clichés médiatiques pour les défaire, et y opposer la vérité des habitants de la ville. Cette entreprise de démystification possède une importance stratégique dans l’urgence de la lutte politique : il s’agit de s’attaquer à « la banlieue » comme mythe menaçant, pour y substituer une réalité sociale complexe et diverse, et dénoncer les mécanismes d’exclusion économiques et institutionnels qui s’y jouent. Mais cette bataille de déconstruction, pièce par pièce, d’un imaginaire qui fait littéralement écran à la réalité se joue sur un terrain défini par l’ennemi, tant au niveau thématique – Rue des cités, mi-fiction, mi-cinéma-vérité, reprend par exemple certaines catégories sociologisantes du débat télévisuel : chômage, religion, immigration, relations homme-femme, jeunesse, délinquance, pauvreté… – qu’au niveau du statut accordé aux images : celle de la croyance en un régime de véridicité[99][99] J’ai écrit sur cette question dans « Fables périphériques », in Cahiers du Cinéma, mai 2016, n°722..
D’autres cinéastes issus des quartiers populaires ont plutôt cherché à renouveler le « cinéma de banlieue » en mode majeur, en rompant avec le réalisme sociologique pour donner naissance à des fictions épiques se réappropriant l’imaginaire violent associé aux quartiers dans les médias dominants. Ces dernières années, le débat critique sur les représentations périphériques s’est notamment cristallisé autour de la dé/repolitisation des scènes d’insurrections de la jeunesse dans Divines d’Houda Benyamina (2016) et Les Misérables de Ladj Ly (2019). Parallèlement à ces combats menés sur le terrain de l’ennemi, une autre lutte, du côté des puissances du faux deleuziennes, porte une attention plus discrète à l’ordinaire de la périphérie.
Tactiques de partage de la parole
Ce sont ainsi les voies mineures de la fabulation que cherchent à emprunter Till Roeskens et Marie Bouts avec Un Archipel qui, s’il s’intéresse au même territoire que Violences urbaines, se situe d’emblée hors de son espace d’énonciation. Le film est constitué d’itinéraires, dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, entre Épinay et Montreuil. Sur le modèle des pratiques aborigènes décrites par Bruce Chatwin dans Le Chant des pistes (1987), Roeskens et Bouts ont proposé à des habitants de construire des cartes chantées ou parlées de leur espace quotidien. Au cours de plusieurs rencontres, les artistes ont amené les personnes filmées à trouver leur voix autant que leur voie. Ils ont tout d’abord demandé aux participants d’évoquer un lieu important pour eux dans leur ville, et éventuellement d’écrire un texte. Dans un second temps, ils se sont rendus ensemble sur ce site pour répéter puis tourner ce qui est devenu une performance marchée, entre monologue intérieur et adresse à la caméra. Le film propose un montage de ces errances entremêlées, qui donne naissance à un « espace imaginaire, que plusieurs personnes ont contribué à bâtir »[1010][1010] Marie Bouts, Till Roeskens, Entretien avec Olivier Marboeuf dans le cadre de l’exposition Pistes, première du film Un Archipel, octobre 2010, p. 5. . Il a été présenté lors de l’exposition « Pistes » à l’espace Khiasma, aux Lilas, en 2010, et au festival Cinéma du Réel à Paris en mars 2012.
Plan de situation #7. Consolat-Mirabeau est, lui aussi, l’aboutissement d’un processus de rencontre entre auteur et personnages. Il s’agit d’un conte écrit par Roeskens à partir de deux ans d’échanges avec des habitants d’un quartier du Nord de Marseille, à l’occasion d’une résidence artistique au théâtre de la Cité. L’artiste y raconte sa découverte de la Cité Consolat et des espaces alentours, et rapporte les récits de ceux qu’il a croisés en chemin. En 2011, il restitue ces histoires, à quatre reprises, dans différents lieux du quartier : il installe des chaises au coin d’une rue ou sur une place, et les habitants sont invités à venir écouter ces témoignages entrelacés. Un livre naît de cette expérience et regroupe des photographies, le texte de la performance et d’autres contributions de résidents. Enfin, un « film-trace » conserve la mémoire de la performance, publié sous la forme d’un livre-DVD par l’éditeur indépendant Lowave.
Dans ces deux œuvres, Till Roeskens et Marie Bouts ne cherchent pas à opposer une vérité ethnographique à une fiction colonisatrice : ils s’engagent dans la construction d’un imaginaire autre, et se proposent d’inventer avec leurs personnages des formes et des dialogues nouveaux. Autrement dit, ils n’essaient pas de substituer une bonne image des quartiers populaires à une mauvaise, une démystification à une falsification, mais de réinventer le terrain du conflit ou du jeu lui-même, de reprendre l’imaginaire, en espérant qu’il trouve une voie pour infiltrer le collectif. Pour cela, ils s’essaient à trois gestes de partage de l’énonciation, à rebours de la répression de la figure de l’autre produite par le regard policier.
Donner la parole
Leur première tactique de partage de l’énonciation, typique du documentaire social, peut être synthétisée par cette formule : « donner la parole » aux personnages.
Dans Un Archipel, le travail en amont avec les personnes filmées, sous la forme d’un atelier, permet aux participants d’élaborer leur parole dans un espace protégé, à l’abri du regard de la caméra et du tiers spectateur à venir. Au tournage, de nombreuses séquences sont prises en mouvement. La caméra ne saisit souvent les visages que fugitivement, en passant, ou bien filme les marcheurs de dos ou de profil. Certaines paroles sont enregistrées en off. Parfois, les personnages ferment les yeux, laissés pudiquement à leur espace intérieur. Enfin, le montage vient couper dans les séquences-parcours, ménageant des pauses dans la présence des personnages qui, pour un temps, peuvent exister dans un espace loin de notre regard.
Ces différents procédés rompent avec la forme de visibilité qu’instaure l’entretien face caméra, qui surexpose le visage parlant et focalise l’écoute sur le contenu du discours. Ici, on prête attention aux mots mais également à la mélodie, au rythme. C’est aussi en les suivant dans leurs parcours dans des lieux pour eux chargés affectivement que les filmés nous parlent et que nous les écoutons. Leur parole se trouve entourée par l’espace urbain qui apparaît et disparaît en arrière-plan. Roeskens et Bouts résument ainsi leur relation avec les personnages : « nous devions être à la fois guides et guidés, à l’écoute de cette parole en train de se construire »[1111][1111] Marie Bouts, Entretien avec Olivier Marboeuf, op. cit., p. 4.. « Donner la parole » consiste donc pour les auteurs à créer un cadre – au sens cinématographique comme symbolique – accueillant, où peut s’épanouir la parole de ceux à qui le pouvoir de dire est dénié par les représentations policières.
L’hospitalité de l’énonciation documentaire est poussée à un autre degré dans Plan de situation #7, où le médium qui accueille les voix des personnages devient le corps parlant de l’artiste lui-même. Au cours de son récit, Roeskens rapporte au style direct ou indirect de nombreuses histoires qui lui ont été confiées. Dans le « je » de l’auteur surgissent alors des subjectivités multiples. Par la voix du performeur-intercesseur, c’est maintenant le cousin de l’épicier qui raconte comment il est venu clandestinement d’Algérie en France, à l’âge de quinze ans, son BEP électricité puis ses rencontres avec des filles, puis c’est Lydia qui parle de son enfance, quand on pouvait descendre directement de la colline à la mer, de la rencontre avec son mari, de la génération touchée par le chômage et la drogue, puis du club de football qui est la fierté du quartier, et des luttes contre les destructions de logements, plus tard c’est Julian qui raconte la vie en caravane dans son enfance, puis la sédentarisation, les difficultés financières… Le récit de l’expérience vécue par Roeskens dans le quartier devient une trame ouverte qui héberge une multitude enchâssée de récits, de mémoires et de manières d’habiter. Et si l’auteur ne cherche pas à imiter les voix de ceux qu’il fait entendre, il confère à chacune d’entre elles un rythme, un langage propre, sorte de rencontre intime entre ses mots et ceux des autres.
« Donner la parole » ne correspond pas ici à la modalité, aujourd’hui classique, du cinéma direct – poussée à l’extrême par le journal télévisé – dans laquelle un micro est tendu au personnage à qui revient la tâche de « s’auto-mettre en scène ». Ce dispositif tend à favoriser le choix par les documentaristes de personnalités fortes, ou du moins d’individus chez qui l’auteur décèle un potentiel cinégénique : celui de devenir personnage de cinéma[1212][1212] Voir Jean-Louis Comolli, Voir et pouvoir. L’Innocence perdue, cinéma, télévision, fiction, documentaire, Verdier, Lagrasse, 2004, p. 164.. Roeskens et Bouts font un pas de plus vers les filmés, en inventant des dispositifs à même de faire entendre des voix diverses, réservées, voire même des paroles silencieuses. Le temps partagé et protégé qui précède la performance est pour eux aussi important dans le processus créatif que celui du tournage ou de la représentation : il permet d’offrir aux filmés les moyens de leur parole, énoncée ensuite par la médiation d’un dispositif pudique.
Cette position de partage postule une « égalité des intelligences » selon les termes de Rancière, mais repose sur une inégalité des positions sociales : seul celui qui se trouve dans une position privilégiée et contrôle les moyens d’expression a la possibilité de « donner la parole à l’autre », c’est-à-dire de faire le choix de se mettre en retrait pour faire place à l’autre et l’aider à trouver sa propre voix [1313][1313] À ce propos Linda Alcoff pointe ainsi l’ambivalence de ce désir généreux de laisser l’autre défavorisé parler pour lui-même : « nous devons reconnaître que la décision même de « passer son tour » ou de se retirer ne peut avoir lieu qu’à partir d’une position de privilège. Ceux qui ne sont pas du tout en position de parler ne peuvent pas se retirer d’une action dont ils n’ont pas l’emploi. De plus, décider pour soi-même de se retirer ou non est une extension ou une application du privilège, et non l’abdication de celui-ci. [We have to acknowledge that the very decision to “move over” or retreat can occur only from a position of privilege. Those who are not in a position of speaking at all cannot retreat from an action they do not employ. Moreover, making the decision for oneself whether to retreat is an extension or application of privilege, not an abdication of it.] », dans « The Problem of Speaking for Others », in Cultural Critique, No. 20 (Winter, 1991-1992), p. 24-25. Je traduis.. Par cette attitude, les artistes espèrent produire plus d’égalité, en utilisant stratégiquement leur position privilégiée. Mais ce geste de partage – « donner la parole » – se trouve donc nécessairement en tension avec une autre posture, plus délicate : celle de « parler pour l’autre ».
Parler pour
Dans les deux œuvres étudiées, ce glissement entre « donner la parole » et « parler pour » opère dans les zones où réapparait le statut singulier de la parole des auteurs, tant verbale que cinématographique.
Dans Un Archipel, l’autorité de Roeskens et Bouts se fait sentir dans leur maîtrise formelle et conceptuelle. Certes, le film possède une certaine précarité esthétique liée au tournage à moyens réduits. La caméra est parfois mal stabilisée, les mouvements pas toujours fluides, la voix couverte par les bruits de la rue : ces maladresses inscrivent dans la matière filmique l’expérience située et partagée du tournage. Mais, à cette forme d’ouverture à ce qui échappe répond un désir de contrôle, qui s’exerce par le biais du montage. Ce dernier agence des fragments de parcours et de récits hétérogènes, ménage des croisements imaginaires entre les personnages, inventant ainsi sa propre voie poétique dans une banlieue imaginée.
Au-delà de cette opération fondamentale de réécriture, caractéristique de tout travail documentaire, les auteurs font aussi littéralement entendre leur voix. Le film s’ouvre ainsi sur ces paroles chuchotées :
… Au-delà des grands axes, des villes différentes et semblables s’étendaient à perte de vue. Des lignes discrètes parcouraient le pays, reliant entre eux des points épars. Nous cherchions les passages, les raccourcis, les détours, nous étions à l’affût des points de rencontre probables.
Ces quelques phrases semblent chercher à se mêler anonymement aux voix qu’elles précèdent. Toutefois, la langue et le penchant métadiscursif tranchent avec la polyphonie habitante. À cela s’ajoutent les interventions poético-politiques des artistes à même l’espace de la ville. Jouer avec la toponymie, tracer une croix au sol à la craie, coller une gommette qui servira de point de raccord entre deux lieux : ces gestes visent à produire, à partir de l’environnement prosaïque, un espace autre, fabulé. Du même coup, ils induisent une prise de hauteur par rapport aux voix et aux parcours des personnages qu’ils encadrent.
Dans Plan de situation #7, la réécriture par Roeskens des récits des autres peut également être perçue comme une forme d’appropriation des voix subalternes par une figure dominante ou comme la réaffirmation d’un écart entre différentes capacités de parler. L’artiste est en effet ici celui qui a le pouvoir d’écrire, d’articuler et de performer les mots de tous. Certes, il produit un « récit d’espace »[1414][1414] Voir Michel De Certeau, Chapitre IX « Récits d’espace », in L’Invention du quotidien, T.1, Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990, p. 170-192. au sens où l’entend Michel de Certeau, c’est-à-dire une représentation de l’espace à partir des pratiques et parcours quotidiens. Mais, à un autre niveau, la performance, comme son titre l’indique, a aussi pour ambition d’établir une certaine cartographie « d’en haut », qui embrasse et met en relation les différentes zones du quartier.
Elle rejoint en cela partiellement le savoir omniscient du cartographe ou de l’urbaniste, incarné par les tracés à la craie effectués au sol par le plasticien, selon un procédé emprunté à Marie Bouts[1515][1515] On retrouve ce double niveau – le récit et la carte – dans le dernier plan de situation de Roeskens Plan de situation #8 : Grand Ensemble (prod. Ateliers Médicis, 2017), conte documentaire réalisé à Clichy-sous-Bois. Cette fois, c’est une maquette du quartier en carton, manipulée par une collaboratrice, qui évolue au fil du récit, en même temps que l’artiste déroule les fils de laine colorés représentant les trajectoires des habitants..
Mais n’est-ce pas la nature et l’ambition même de toute démarche documentaire, que de réécrire ou de réarticuler, par le cinéma, la littérature ou le théâtre, la parole des autres, ailleurs et autrement qu’ils ne le feraient eux-mêmes ?
La représentation naît chez Bouts et Roeskens d’un désir de partage, d’une relation de don et de contre-don entre personnages et auteurs : les premiers donnent d’eux-mêmes pour une œuvre à venir, tandis que les seconds donnent aux premiers la possibilité d’être vus et entendus. Reconnaître cette dynamique de réciprocité ne revient pas pour autant à nier l’asymétrie fondamentale de la relation documentaire. Mais comme le souligne Linda Alcoff, le danger existant dans le désir de « parler pour les autres », bien souvent instrument d’une domination, ne doit pas conduire artistes ou chercheurs à un refus inconditionnel de représenter les dominés. Alcoff préconise plutôt « une analyse concrète des relations de pouvoir et des effets discursifs particuliers impliqués » par chaque acte[1616][1616] « En rejetant un retrait général du parler pour, je ne défends pas un retour à une appropriation non-consciente de l’autre, mais plutôt l’idée que quiconque parle pour les autres ne devrait le faire qu’à partir d’une analyse concrète des relations de pouvoir et des effets discursifs particuliers que cela implique. [In rejecting a general retreat from speaking for, I am not advocating a return to an un-selfconscious appropriation of the other, but rather that anyone who speaks for others should only do so out of a concrete analysis of the particular power relations and discursive effects involved] », Linda Alcoff, art. cité, p. 24. Je traduis..
Roeskens explore une autre voie que celle du retrait pour négocier avec l’inégalité des positions : il met en scène, au sein de l’œuvre elle-même, le rapport de pouvoir problématique en jeu dans la relation documentaire. En thématisant les risques et les questions soulevés par sa démarche, l’auteur livre à ses personnages-spectateurs les moyens de sa propre critique, et donc les instruments d’une remise en mouvement des places dans l’énonciation.
Parler à
C’est à cet endroit que les deux œuvres commentées empruntent des chemins divergents. Dans Un Archipel, le film englobe les chants de piste sans expliciter la complexité des rapports en jeu dans la production de l’objet partagé. Marie Bouts formule en ces termes son désir d’horizontalité avec les personnages d’Un Archipel :
Je ne voulais pas du tout être une exploratrice, avec ce que cette place suppose de violence historique sur les territoires et les populations explorées (d’autant que la Seine-Saint-Denis accueille beaucoup de personnes qui ont déjà été « explorées » par les Blancs, dans un passé très proche, avec les conséquences qu’on connaît). Je voulais trouver une place à l’intérieur du monde, en aucun cas être au-dessus et avoir une vision plus large que les autres personnages.
L’aspiration utopique à performer l’égalité à l’intérieur de la représentation poétique de la ville conduit ici à un déni partiel de la nécessaire position de pouvoir occupée par l’auteur. Le montage d’Un Archipel s’affranchit de la réalité sociale inégalitaire pour rassembler des « je » en un « nous » fantasmé. Si cette fiction de devenir annule la séparation violente entre « nous » et « eux », elle opère essentiellement à l’intérieur de la sphère autonome qu’est le film.
Tandis que Plan de situation #7, sans abandonner l’horizon d’une communauté démocratique, affronte la réalité de l’inégalité des conditions pour mieux la défaire. La parole de l’auteur n’y fait pas qu’accompagner ou accueillir la parole des autres. Il s’agit également d’une parole adressée à ces mêmes autres, un « je » adressé à un « vous », qui doute et sans cesse rend visible l’asymétrie problématique des positions.
Tout au long de son conte, Roeskens rapporte les réticences et la suspicion de ses interlocuteurs, depuis le : « – Vous me raconteriez l’histoire de cet endroit ? – Quelle histoire ? Ici y’a pas d’histoire ! » à cette question, énoncée vers la fin de la performance, et restée sans réponse : « Et les bourgeois, ça les intéresse, ce que vous racontez ? Les histoires de gitans, ça les intéresse ? » L’artiste raconte ainsi la beauté de la confiance qui lui a été faite, mais aussi l’hostilité à laquelle il s’est heurté à plusieurs reprises : le vol de son vélo, son agression, parfois des insultes, sa difficulté à revenir à la Cité Consolat, puis son retour malgré tout. Vers la fin de son récit, il en vient à abandonner tout désir de maîtrise de la situation et à mettre directement en cause sa position : « qu’est-ce que je cherche ici, où personne ne m’attend ? Qu’est-ce qui me pousse à vouloir raconter la vie de ceux qui m’ont rien demandé ? Qu’est-ce que c’est ce besoin de… passer des frontières ? Et si vraiment je me prends pour un passeur, est-ce que c’est juste que je sois payé par les pouvoirs publics pour le faire ? » Il se rend alors dans les bureaux de la « Politique de la ville », qui subventionne sa résidence, pour chercher à comprendre ce qui se cache sous ce « Contrat de Cohésion Sociale » : « ça veut pas dire, aussi : que chacun reste à sa place ? »
L’artiste se refuse à produire un art républicain officiel, qui chercherait à minimiser la portée des conflits et le sentiment des inégalités, pour « acheter la paix sociale ». Son conte met en exergue les luttes quotidiennes de ses personnages, tout en exposant les enjeux politiques dans lesquels s’inscrit sa démarche et sur lesquels celle-ci agit comme un révélateur. Aux interrogations qu’il soulève sur la cohésion sociale, Roeskens ne donne pas de fausse solution confortable du haut de son autorité d’auteur, mais propose plutôt, depuis sa place problématique, de cartographier l’espace d’un débat encore à mener. Produire du dissensus apparaît comme la seule voie possible pour imaginer un chemin vers l’égalité démocratique qui, par définition, ne pourra être dessiné que collectivement.
Plan de situation #7 cherche donc une double voie : une boucle poétique et politique, par laquelle l’ordre de l’énonciation réinventé à l’intérieur de la performance fait effet dans l’espace social dont elle provient et auquel elle s’adresse. Il ne s’agit pas de transmettre un message pour faire se lever une foule, mais de mettre en partage les forces mêmes d’une transformation collective, de faire essaimer l’interrogation critique, en faisant communiquer des espaces séparés, en « passant des frontières ». L’œuvre est un dialogue – qui fait la part de la violence et du conflit – entre l’artiste et ses personnages, mais aussi entre des résidents de différentes parties du quartier. Roeskens fait plusieurs fois entendre les préjugés des uns et des autres, et plus tard les met en perspective par le témoignage des personnes concernées. Cette écoute réciproque prend forme à l’intérieur du conte où se confrontent des paroles individuelles. Lorsqu’un homme se plaint du cimetière de voitures et de déchets qui entoure sa caravane et qu’à la question de savoir qui a mis cela ici, il répond « C’est pas nous. C’est des Arabes qui viennent, la nuit, brûler des voitures. », Roeskens poursuit « Quelque pas plus loin, un autre homme m’a dit : Moi, je suis un voleur. J’aime pas faire ça, j’aimerais avoir un autre métier, mais c’est le seul que je sais faire… qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? »
L’écoute se déploie également grâce à l’espace démultiplié de la performance jouée quatre jours successifs, chaque fois dans un autre lieu du quartier. La circulation des paroles des uns et des autres, au-delà des frontières symboliques, permet de faire apparaître les difficultés communes aux différents habitants, de donner à penser le conflit politique entre classes dominées et classes dominantes, plutôt que d’insister sur les clivages entre communautés pour mieux régner.
De plus, la mise en scène cherche aussi à créer un dialogue entre classes sociales, en dédoublant l’espace de sa diffusion, de l’espace local mais pluriel du quartier, à la diffusion en livre-DVD et sur internet, cette fois plutôt à destination du public de l’art, qui se trouve directement mis en question.
La captation intègre la réception in situ du conte, en cadrant le public qui écoute, en rendant compte des interactions entre l’artiste et l’assistance – interpellations, applaudissements, troubles – sur fond des lieux urbains où se déroulent les récits – les tours HLM, la colline, les caravanes…. Cette diégétisation du public relie les deux espaces de réception de l’œuvre – celui de la performance et celui du film – et nous rappelle qu’un discours ne prend sens que dans « le rituel » de son énonciation[1717][1717] Voir Michel, L’Ordre du discours, op. cit., p. 30-31..
Par ce dispositif spatio-temporel complexe, Roeskens parvient à projeter dans son Plan de situation #7 l’image d’une communauté démocratique fantasmée, tout en indiquant les pistes concrètes de sa possible mise en pratique, au-delà du domaine de l’art.
Réinvestir l’espace public
Contre la privatisation des questions sociales et urbaines par un point de vue policier qui nie l’existence de conflits politiques, la voie que nous montre Till Roeskens est celle d’une dynamique démocratique qui vise en premier lieu à recréer un débat autour des affaires communes. Loin de la leçon édifiante du « maître abrutisseur », l’énonciation polyphonique et conflictuelle de Plan de situation #7 crée une forme d’inconfort qui vise à affecter réciproquement, à mettre en partage les sensibilités, à rendre visibles les tensions et le champ des possibles.
Ces énonciations collectives sont minoritaires tant dans leur perspective politique que dans la réalité de leur diffusion : Un Archipel et Plan de situation #7 cumulent chacun à ce jour environ 1000 vues sur la page Vimeo de Dérives.tv qui les diffuse. Mais elles nous proposent une voie essentielle, celle d’un partage de la parole, à rebours des discours actuels qui fabriquent la fracture républicaine qu’ils prétendent dénoncer – tel Manuel Valls, alors premier ministre, déclarant en 2015 qu’« il existe un apartheid territorial, social et ethnique en France »[1818][1818] « Manuel Valls évoque « un apartheid territorial, social, ethnique » en France », Le Monde, 20 janvier 2015. ou Gérald Darminin, actuel ministre de l’intérieur, pour qui : « Il faut stopper l’ensauvagement d’une partie de la société »[1919][1919] Entretien avec Gérald Darmanin, par Arthur Berdah, Jean Chichizola, Christophe Cornevin, Albert Zennou, Le Figaro, 24 juillet 2020..
Nous qui espérons par nos textes relayer la force d’images indociles, nous pouvons faire nôtres les questions, les doutes et les solutions avec lesquels négocie Till Roeskens dans l’espoir de « passer des frontières ». Car son travail sur la performance et sur la réception vient nous rappeler que la signification politique de nos mots dépend de la puissance de leur adresse, de la capacité qu’ils ont à atteindre des spectateurs et des lecteurs, à créer du dialogue, dans des espaces autres que celui de l’échange, certes précieux, entre les pairs. Écrire un texte, agencer des signes pour aiguiser nos propres forces ne suffit pas. Il faut sans cesse questionner notre place et propager le dissensus, dans les salles de cours et à l’université en général, les cinémas, associations, places… et autres espaces publics à inventer.
Demander à l’art et à la recherche de se « rendre utiles » socialement est hélas ce que dicte l’impératif de rentabilité et de productivité néolibéral. Refuser cette injonction ne doit pas pour autant justifier un repli confortable de la pensée dans un territoire propre, dont la force politique se résumerait à son insoumission à tous buts dictés par l’extérieur. Sans prêter l’oreille aux sirènes de l’utilitarisme du savoir, nous avons la responsabilité d’interroger la manière dont la pensée que nous élaborons dans le champ universitaire peut participer à une convergence politique en acte entre des espaces sociaux hétérogènes, plutôt qu’à creuser l’écart entre celles et ceux qui ont le pouvoir de parler, et celles et ceux à qui ce pouvoir est dénié.
ALCOFF Linda, « The Problem of Speaking for Others », in Cultural Critique, No. 20 (Winter, 1991-1992), pp. 5-32.
BERTHAUT Jérôme, DARRAS Éric, LAURENS Sylvain, « Pourquoi les faits-divers stigmatisent-ils ? L'hypothèse de la discrimination indirecte », dans Réseaux 2009/5 (n° 157-158), p. 89-124.
CAILLET Aline, L’Art de l’enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales, Mimésis, Sesto S. Giovanni, 2019.
CARPENTER Juliet, HORVATH Christina (dir.), Regards croisés sur la banlieue, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2015.
COMOLLI Jean-Louis, Voir et pouvoir. L’Innocence perdue, cinéma, télévision, fiction, documentaire, Verdier, Lagrasse, 2004
DE CERTEAU Michel, L’Invention du quotidien, T.1, Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990.
FABIAN Johannes, Le Temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son objet, Toulouse : Anacharsis, 2006.
FOUCAULT Michel, L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971.
LOCHARD Guy, « La « question de la banlieue » à la télévision française. Mise en place et évolution d'un conflit de représentations », Images et discours sur la banlieue, Toulouse : ERES, « Questions vives sur la banlieue », 2002.
RANCIÈRE Jacques, Le Spectateur émancipé, La Fabrique, Paris, 2008.
RANCIÈRE Jacques, La Haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, 2005.
RANCIÈRE Jacques, Le Partage du sensible, La Fabrique, Paris, 2000.
DELEUZE Gilles, Chapitre 6 « Les puissances du faux », in Cinéma 2. L’Image-temps, Éditions de Minuit, Paris, 1985, p. 165-202.