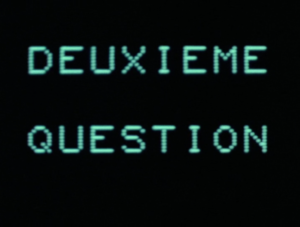Regarder vers l’Ukraine
Notes préliminaires sur les images d’une guerre en cours (1)

On ne le dira jamais assez : pour arriver à voir une image, il serait bien de commencer par la regarder.
Sans surprise, l’invasion de l’Ukraine a amené avec elle un manichéisme qui s’était jusque-là réfugié dans des luttes rhétoriques sévissant sur les réseaux sociaux, et à peine au-delà. La mythique cause juste reprend du service. Une nouvelle qui, à n’en pas douter, sera froidement accueillie par tous ceux qui prennent le parti du gris chaque fois qu’il y a affrontement entre le blanc et le noir. Il est toutefois certain que, dans notre situation, refuser d’adopter la totalité des opinions « correctes » ne devrait jamais suggérer un penchant vers la relativisation des crimes odieux dont l’agresseur russe se rend coupable contre un peuple vaillant, prêt à se battre sans répit. Mais cette position, en retrait critique par rapport aux grandes vérités du moment, nous paraît être la plus pertinente pour tenter d’y voir plus clair à travers cet amas de convictions dures, systématiquement niées par le camp adverse. Un exemple prélevé dans cette vague de forcing opérée sur l’opinion publique ces dernières semaines, appelée à adhérer immédiatement à l’une des visions mises sur la table, pourrait nous éclairer davantage que l’acharnement qui balaie notre société des deux directions opposées. Prélevons-le, donc, de cet endroit qui nous est familier : le cinéma. Et rattachons-le à la figure de proue du cinéma ukrainien contemporain, à savoir le réalisateur Sergueï Loznitsa, qui s’est récemment retrouvé pris entre le Scylla du laxisme moral et le Charybde de la rigueur excessive, que la guerre sait si bien renvoyer dos à dos. Soyons plus précis : initialement, Loznitsa avait reproché à l’Académie Européenne de Film (EFA) son manque de positionnement ferme par rapport à la situation actuelle. L’EFA a donc répondu de la plus démocratique des manières, en portant préjudice à tous les cinéastes russes, sans exception. Loznitsa a rétorqué en criant à l’exagération – quid des artistes persécutés par Kremlin, ou bien des indépendants qui manifestent contre la guerre ? – et a démissionné de l’organisme. Mais le vrai plot twist vient seulement après, au moment où l’Académie Ukrainienne de Film (UKA) annonce qu’elle va expulser le cinéaste de ses rangs et qu’elle encourage le reste du monde à le boycotter. En cause : la sélection de ses œuvres au programme d’un festival du film russe organisé à Nantes et intitulé Entre Lviv et l’Oural (finalement annulé). Trop internationaliste au goût de l’UKA ; trop cosmopolite, pourrait-on dire, tant cette affaire prend un tournant quasi-religieux quant à l’acception conservatrice que l’on semble avoir de « l’homme du monde ».
On voit ici, comme à travers un miroir, le sombre avenir auquel on peut s’attendre après la fin, tellement attendue, de ce conflit. L’embarras de Loznitsa ne concerne pas tellement la bonne attitude à adopter, mais le dosage adéquat de morale qu’on y injecte, et qui semble devenir impossible à discerner. Comme si l’enjeu du moment s’accompagnait d’une perte de dextérité éthique, qui fait qu’on ne peut plus s’approcher du mécanisme de la justice morale – qui punir ? qui sauver ? – sans le casser par notre gaucherie. Dans tous les cas, cet embarras est une image forte de cette guerre. Je conçois l’image, avec Jacques Rancière particulièrement, non pas comme relevant exclusivement du visible – « il y a des images qui sont toutes en mots », disait le philosophe –, mais comme un assemblage entre visible et dicible, qu’il s’agit de déplier soigneusement. Je me trouvais récemment à Berlin pour une courte visite ; la guerre venait de commencer, tout le monde était sous le choc. C’est dans cette ville qu’il est le plus fascinant d’observer, avec une fantastique acuité et comme à l’abri du Temps, la trace préservée dans le réel de cette dichotomie à laquelle je faisais allusion plus haut, qui s’y retrouve serrée entre deux rues portant le même nom, l’une toute en verre, l’autre, se fondant dans la première, faite d’immeubles socialistes en plattenbau à perte de vue. Berlin est la ville où la surimpression – ce procédé technique si cher au pionniers de l’art du visible magnifié – fait peau neuve et nous illumine, dans une étrange dilatation-contraction du Temps, qui l’étire simultanément devant et derrière nous, la ruine des bombardements et la reconstruction vorace, la logique dualiste de la guerre et l’oubli inévitablement apporté par l’armistice, l’idée de vivre avec l’Histoire de l’autre côté de la fenêtre et son effacement à l’âge de la consommation mondialisée. Dans le roman sans doute le plus connu à propos du Mur de Berlin – The Wall Jumper de Peter Schneider, écrit en 1982 –, l’auteur parvenait à une description très synthétique de la production télévisuelle de l’époque qui, sans avoir prétention d’examen critique en bonne et due forme, se prête à un tour de piste supplémentaire à l’occasion de cette guerre. Car la vérité, en ces temps mouvementés, tend à se restreindre, pour se réfugier entre deux raccords, loin de la lourde machinerie de propagande :
« Le soir, le présentateur du journal parle d’une résolution de l’ONU qui condamne l’invasion soviétique de l’Afghanistan comme immixtion dans les affaires internes du pays. À l’écran, des colonnes de tanks russes patrouillent dans la capitale de l’Afghanistan. Le présentateur dit que de telles images n’ont pas été montrées dans les médias de l’Est depuis des semaines.
Peu de temps après je change de chaîne. À nouveau il y a un présentateur assis devant une carte du monde et livrant les nouvelles. Il porte la même cravate et la même veste sport ; il a le même début de calvitie et parle la même langue que le présentateur de l’autre chaîne. Il cite un article de Pravda qui condamne la résolution de l’ONU comme immixtion dans les affaire internes de l’Afghanistan. Les images montrent des armes américaines et chinoises capturées des soldats afghans. Le présentateur note que ces images ne sont pas montrées dans les médias de l’Ouest.
Pour une fraction de seconde, comme je m’apprête à éteindre la télé, je vois l’ombre de sa chaîne homologue de l’Ouest ; puis l’écran devient noir. »
Je viens d’évoquer les mots « abri », « refuge ». Et pour cause. Car l’analyse des images de guerre – tout événement de ce type représente, entre autres, un extraordinaire rassemblement d’images – demeure à tout moment nécessaire. Elle doit s’effectuer avec minutie et à l’écart de toute tendance surplombante face à un matériau audiovisuel potentiellement « indigne », afin de faire fructifier nos moments de répit et de quiétude fragile, ceux dont nous disposons, contrairement à ceux qui, aujourd’hui, se trouvent sur le champ de bataille ou sont forcés de le fuir.


Commençons par noter le retour en puissance de la rance opposition entre ceux qui « tiennent les micros et les sceptres » et « les figurants, c’est-à-dire le peuple en laisse » (Nicole Brenez), qu’on espérait, du moins pour l’Europe, enfouie sous un recoin obscur et honteux du siècle précédent. Car tout flux d’images, si abondant soit-il, se caractérise surtout par ce qu’il nous cache, par ce qu’il occasionne comme oubli ou absence. Et même si la tendance générale, aujourd’hui, semble pencher vers une visibilité débridée, peu de choses paraissent moins contestables que le constat selon lequel cette guerre, comme tant d’autres, fut d’abord un combat médiatique entre deux leaders politiques – et beaucoup d’autres choses encore, mais seulement dans un deuxième temps. Nous avons donc assisté à l’affrontement, par écrans interposés, entre un dictateur pur et dur et un acteur de comédie débile – et si ce dernier a pu jouir, finalement, de l’adhésion enthousiaste du public, cela relève moins de sa personnalité politique et plus de son très charmant avatar médiatique.
Car au-delà de la réalité du terrain, une autre bataille – qui possède, elle, un dénouement prévisible – aura fait rage. Et elle fut livrée précisément autour des deux conceptions, fort différentes, que ces présidents se font du médium audiovisuel. L’échec de Poutine aux yeux du peuple tient justement dans son échec à s’adapter aux nouvelles règles de l’image. Habillé en costume-cravate, emballant les moteurs des chars et des camions soviétiques encore une fois, Poutine semble tout droit sorti des films pompiers d’autrefois (on pense aux diatribes de Serge Daney…), avec leurs foules de figurants et leur pathos face à la grande histoire, qui pour autant se retrouvaient scellés dans des schémas narratifs trop intelligibles, poussiéreux. Il suffit de regarder sa vidéo du 5 mars, lors de son allocution à table, entouré de plusieurs femmes qui le suivent du regard, égaré dans son ample gesticulation. L’image aurait fonctionné – le travail a été raisonnable, vu l’effort sous pression – s’il n’y avait pas cette main qui ne tenait pas en place, et qui passait des fois à travers le micro. Comme quoi la côte de popularité du président tenait, elle aussi, du trucage du cinéma tant elle devait passer par l’invention du pionnier Méliès pour aboutir à un résultat satisfaisant.[11] [11] Erratum: Il semble cependant que ce détail de la main rebelle soit lié à un problème de compression, et non le résultat d’une manipulation.
De l’autre côté, Zelensky apparaît comme l’homme pour qui l’épopée nationale d’un passé cinématographique glorieux ou bien le fond vert de l’illusion n’ont même plus le parfum touchant de la nostalgie. Zelensky est plus à l’aise sur son compte Twitter, où il peut livrer ses petites performances d’acteur, que dans le Parlement, qui lui pose problème, la transition entre les métiers étant bien difficile. Parfaitement conscient du fait que toutes les images possibles ont été déjà vues, il est disposé à utiliser n’importe quel dispositif au nom d’un art pauvre, conçu avec les moyens du bord. Plus la mise en scène est modeste – un coin de pièce mal éclairée, une vidéo en mode « portrait » –, plus son geste créateur est fort. Autrement dit : Poutine travaille avec une profondeur contrefaite de l’image, alors que les images de Zelensky, pour être « vraies », n’ont plus aucune profondeur. Alors que Poutine prépare soigneusement la prochaine allocution télévisée en manière mikhalkovienne, l’Ukrainien a déjà posté on ne sait plus combien de vidéos en live. En fait, ce dernier participe avec brio à l’intronisation d’un nouveau type de leader politique, pour reprendre la classification foucaldienne. Non pas le commandant inapparent, désireux d’effacer sa présence le plus possible, très en vogue après la fin de la deuxième guerre mondiale ; non plus l’apparatchik morose qui a suivi (de Khroustchev à Pompidou) ; même pas le chef d’État charismatique qui a contribué à sexualiser une nouvelle fois le pouvoir (de JFK à Giscard). Mais un homme de spectacle – au sens fort du terme – capable d’étourdir par son ubicuité et d’offrir au peuple l’illusion que rien de fondamental ne le sépare de lui. D’où ce collage de l’outfit kaki – non seulement un habit adapté à la situation, mais aussi l’image de l’homme prêt à intervenir de manière tangible dans le réel –, à comparer avec le manteau sur-mesure de Loro Piana arboré par Poutine lors de son meeting de stade. Le succès de cette sémiologie facile de l’image ne pourrait pas échapper au chef d’État européen qui se rêve toujours en premier de la classe : il faut voir les photos d’Emmanuel Macron en sweatshirt noir, des cernes sous les yeux, arborant avec une barbe de trois jours, indispensable à celui qui est toujours sur le (bon) coup. Mais la logique régressive est bien là : après une période où tous les espoirs ont été permis, nous revenons à nouveau à un état de fait où il y a de moins en moins à voir dans les images du politique, et de plus en plus à décoder.

Le 10 mars, un signal d’alarme retentit sur les radars aériens de plusieurs pays européens : des objets non-identifiés ont pénétré dans leur espace aérien national sans demander l’autorisation, durant une nuit fatidique. Il a fallu attendre le matin suivant pour que les choses soient tirées au clair : un drone datant de l’époque soviétique avait survolé l’entièreté de la zone, s’écrasant finalement en Croatie. Concernant l’incident, le Ministère Roumain de la Défense Nationale a fait naître la colère de ses concitoyens en déclarant ingénument : « L’évolution de cet objet aérien dans un laps de temps très court au sein de l’espace aérien national, la vitesse élevée du vol, l’altitude réduite, tout cela fait qu’il a été impossible d’utiliser d’autres mesures procédurales pour l’identification au vol de cet objet. »
Détrompons-nous : ce qui dérange plutôt dans cette situation n’est pas la précarité technologique des systèmes de défense nationale, que le communiqué du Ministère ne fait que confirmer, impuissant. Ce qui dérange, c’est plutôt la manière apparemment involontaire – puisqu’on parle tout de même d’un drone, c’est-à-dire d’un objet militaire dépourvu d’équipage humain – dont ce petit aéronef a su, à travers son glissement fluide et invisible dans le ciel nocturne, relier plusieurs pays et les ramener en face de leur passé non-occidental. Achevant sa course sur une place publique de Zagreb – la dernière station avant les sombres Balkans –, le drone a réanimé, par son geste internationaliste, de fort mauvais souvenirs. Nouvelle preuve du fait que les peuples est-européens doivent quand même se reconnaître concernés par l’affaire post-communiste, et les Roumains (peuple latin) ne font pas exception, même s’il s’en est fallu de peu, comme on peut le lire plus loin dans le même communiqué du Ministère : « l’aéronef est entré dans l’espace aérien roumain, depuis l’Ukraine, aux alentours de 23h23 et l’a quitté vers 23h26, en direction de la Hongrie. »
Me vient à l’esprit la séquence de montage qui ouvre un film extraordinaire des années quatre-vingt-dix, le film hongrois Bolse vita (Ibolya Fekete, 1995). On y voit, enchaînées frénétiquement, des images d’archive stéréotypées avec la chute du Mur, les files d’attente à la douane « direction Ouest », les hommes qui se rasent la barbe dans leurs vieilles voitures délabrées, suivies par d’autres images, moins prosaïques, des combats fratricides de Yougoslavie et le tourment politique de tout l’espace ex-communiste. Et il devient clair que ce drone-là, toujours non-revendiqué – il appartient à tout le monde, pauvre objet d’exposition d’un musée à ciel ouvert –, portait avec lui les braises de la mémoire récente.
Quoi qu’il en soit, il est légitime de voir en cet « objet aérien » non seulement un symbole, mais aussi un symptôme : celui de la transition vers un armement de guerre qui suppose une présence humaine de plus en plus réduite et de plus en plus distante. Dans sa brillante Théorie du drone, le philosophe Grégoire Chamayou fait et défait les enjeux dangereux de cette invention, parvenant à la conclusion quelque peu désabusée d’une transformation radicale de la guerre, d’une prétendue lutte au nom de l’archaïque jus in bello, en une condamnation unilatérale à mort de la part du combattant plus puissant – et, plus généralement, en un anéantissement des rapports de réciprocité. En Ukraine, pourtant – chose étonnante –, on a vu comment le drone pouvait mobiliser et monopoliser l’actualité guerrière en faveur de l’agressé (voir le Bayraktar, terrible et déjà fameux modèle de drone turc, peu cher et très efficace). Ces « caméscopes volants, de haute résolution, qui portent des bombes », tel qu’ils ont été décrits, n’ont plus rien d’« humanitaire », ainsi que le prétendait initialement les Américains, soucieux d’encourager une « dronification » de la guerre au nom de la protection de leurs propres opérateurs, plus qu’une poignée de gamers blasés devant un écran. Mais c’est comme si cette violence disproportionnée, fondée sur une liaison coupée entre la mort de l’adversaire et la possibilité de ma propre mort, devient tout à coup désirable pour les petites nations. À la tricherie de la guerre on ne peut répondre qu’avec ses propres armes, actualisées pour le XXIème siècle.

Durant les premiers jours du conflit, alors que les lignes de front n’étaient pas encore balisées, une vidéo amateur avait fait sensation. On y voyait notamment un cycliste en combinaison qui était sorti s’entraîner dans les rues de Kyiv, parfaitement imperturbable face à la nouvelle donne de la situation. Le clip donnait lieu à un sketch sensationnel, qui concentrait en lui l’absurde tragicomique (mais plutôt tragique) de la guerre. Ces images montraient le cycliste s’approchant vaillamment de deux véhicules militaires qui bloquaient cette route déserte, pour ensuite lâcher la pédale et faire marche arrière au moment où un des soldats (ukrainiens) qui se trouvaient là levait son fusil – un geste précis, à peine esquissé – et le pointait vers lui. Cette vidéo ne me préoccupe pas en raison de sa « morale », plus concise que n’importe quel conseil de manuel de développement personnel, comme une sorte de discipline poussée à l’extrême ou d’amour pour le sport qui pourrait triompher même dans les instants les plus sombres, mais parce que ses images renvoient, en fin de compte, vers un des horizons décisionnels inattendus de cette guerre, à savoir le sport.
En 2008, le théoricien du cinéma Patrice Blouin consacrait un magnifique essai de sémiologie cinéphile aux Jeux Olympiques de Pékin. À le lire aujourd’hui, on ne peut s’empêcher d’y trouver d’étranges résonances qui nous poussent à voir, au lieu d’un « grand basculement historique » promis tous les quatre ans par les JO, une petite mutation de régime de visibilité aux effets imprévus. En guise de préambule à sa démarche, Blouin déclarait : « On nous dit à la fois qu’on sait déjà ce qu’on va voir et qu’au final, on ne va rien voir du tout. Ce qu’on va voir, c’est évidemment l’assomption de la Chine comme superpuissance internationale, contestant son leadership historique aux États-Unis, et donc, plus largement, le basculement du centre du monde de l’Occident vers l’Orient. Ce qu’on ne va pas voir et qui est, en fait, l’essentiel, c’est le revers obscur de cette prise de pouvoir, qui fait de la scène apparente des Jeux une entreprise réglée de mystification. » En 2022, les Jeux se sont aussi déroulés à Pékin, en hiver cette fois. Et il ne saurait y avoir de doutes quant à la décision de Poutine d’attendre la clôture de l’événement (19 février), en ménageant son homologue partenaire Xi Jinping, maître d’une grande fête sportive à laquelle plus personne n’a voulu y croire (la crise sanitaire, la corruption du pays…), pour déclencher l’invasion de l’Ukraine (24 février). Mais un autre timing paraît encore plus crucial ici : là où Blouin voyait, en 2008, le dernier éclat estival de la grille télévisuelle, la version de 2022 marque, quant à elle, une arrivée hivernale aux premiers rangs du déferlement des clips sur TikTok. Par rapport aux âges de l’image, Poutine – un commandant qui mélange grande pompe cinématique et volonté d’assujettissement du peuple façon télé – court à contretemps.
On a voulu voir dans le sport une chose triviale – et c’est peut-être la seule chose « normale » dans des temps graves comme ceux-ci. Mais on a oublié que le sport fut à peu près le seul élément – du moins, le seul qui garde une trace visible pour le commun des mortels, loin des centres obscurs du pouvoir – qui a retardé Poutine dans son élan impérialiste, et ce pas seulement par calcul géopolitique. Une analyse récente parlait déjà du régime poutiniste en termes de « sportokratura », compte tenu à la fois des sommes massives investies par le Kremlin pour organiser toutes sortes de compétitions mégalomanes, des JO d’Hiver (2014) au Championniat du Monde de Football (2018), mais aussi et surtout de l’exercice d’image favori du leader moscovite, à savoir la pose en homme viril, pris dans une confrontation avec la nature (l’eau glacée fendue, torse nu, avec volupté) ou avec l’adversaire humain en face de lui (on connaît sa passion pour le judo), qu’il parvient toujours à dépasser. Accompagnés par un violent discours hétéro-normatif – si violent qu’il devient paranoïaque –, ces coups de com sont moins des images que du visuel, au sens où l’entendait Serge Daney : un prétexte de vérifier le bon fonctionnement d’un dispositif technique – ou d’un corps qui maîtrise sa propre mise en scène.
Dans le camp d’en face, le sport est parvenu à se mobiliser étonnamment vite, échappant au leitmotiv de l’apolitisme pour prendre une ferme position pro-Ukraine, en même temps que des sportifs en vue à l’international, à l’instar des footballeurs Andryi Yarmolenko ou Ruslan Malinovskiy, ont pu redonner courage au peuple par leurs performances. J’aimerais rester dans le domaine du foot pour conclure – plus précisément, du côté des joueurs de l’équipe roumaine « Poli Iasi », évoluant dans la première division nationale, qui ont à leur tour décidé de montrer leur soutien à travers un message inscrit sur leurs T-shirts. Mais puisqu’il y a eu erreur dans l’ordre de leur sortie des vestiaires, leur message a fini par ne plus demander l’arrêt de la guerre, mais a donné lieu à une inscription involontairement dadaïste : « RAW POTS ». Comme un dernier signe de résistance du politique contre des athlètes égarés dans un jeu dérisoire, sur des stades vides de province, qui déclenchent notre compassion par leur adhérence forcée aux enjeux brûlants du présent.

- dghgfhf
Illustrations : Photographie tirée du compte Instagram de Sasha Burlaka / Vladimir Poutine le 18 mars 2022 (AFP) / Volodymyr Zelensky le 25 février 2022 (Facebook) / Zone de crash d'un drone le 11 mars 2022 (EPA) / Un cycliste à Kyiv le 25 février 2022 (CNN Portugal) / Photographie tirée du compte Instagram de Sasha Burlaka