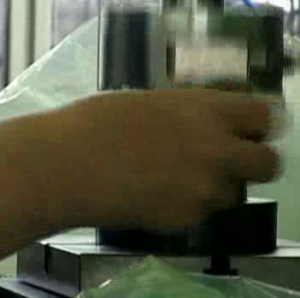Collectiviser le cinéma
Autour de quelques collectifs de cinéma contemporains
Issu d’une conférence donnée il y près de deux ans à la demande de l’association Cinémas 93, ce texte avait été écrit pour une revue universitaire dont la publication est reportée sine die. On le publie ici tel quel, avec son apparat académique[11][11] Depuis l’écriture de cet article est paru le livre de Robert Bonamy, Cinémas en communs, éd. de l’oeil, 2020, sur un sujet identique et avec une plume plus précise..
Le collectif de cinéma, portrait-robot
Si le caractère collectif du travail cinématographique relève des vieilles évidences, l’identification d’une forme comme le « collectif de cinéma » est d’origine plus récente, et inséparable de sa parente politique (le collectif de lutte comme assemblage localisé). La nature collective du travail est un fait, le collectif de cinéma (à distinguer du « film collectif[22][22] Le film collectif étant constitué de plusieurs segments réalisés chacun par un cinéaste différent, quand bien même tous pourraient s’entendre au préalable sur la structure globale de l’œuvre. Il est toutefois significatif que l’un des cas français les plus connus, Loin du Vietnam (1967, avec des contributions de Varda, Godard, Resnais, Ivens, Klein, Lelouch et Marker, qui a supervisé l’ensemble), soit sorti juste avant l’âge d’or des collectifs et ait servi de prélude à la mise en place de Slon/Iskra (voir plus loin). ») un agencement d’énonciation ; son principe même veut qu’il radicalise la collaboration habituelle au point qu’elle mue en collectivisation (des moyens techniques, du paraphe esthétique). Un tel modèle ne pouvait émerger qu’au sein d’une configuration pratique, discursive et financière dans laquelle la recherche d’un autre rapport au travail s’accompagnait du désir d’effacer tout tampon auteuriste, au profit d’une signature de groupe à même de dynamiter la hiérarchie des expertises et de transcender les idiosyncrasies artistiques. En cela, par-delà les déclinaisons de leurs cas et quel que soit le discours que leurs films articulent, les collectifs de cinéma sont intrinsèquement militants, dans la mesure où leur organisation aspirant à l’horizontalité brave le modèle majoritaire de l’équipe qui, lui, distribue les rôles et les tâches d’après un organigramme de subordinations. S’il est possible de le formuler avec une candeur un peu binaire : jamais l’Hexagone n’a hébergé de collectif de cinéma « de droite », en raison d’une incompatibilité principielle ayant pour corollaire le nœud inverse : aujourd’hui comme hier, les collectifs français témoignent d’affinités inaltérables avec les combats de la gauche la moins tempérée.
Hier, d’abord : sans surprise, les premières pousses apparurent au moment où refleurirent les rêves de commun. De la fin des années soixante[33][33] Deux des plus fameux collectifs ont bourgeonné avant Mai 68, même si alors sous une forme encore embryonnaire : A bientôt j’espère de Marker est fini en 1967, et servira de point de départ à l’aventure du groupe Medvedkine de Besançon ; au printemps 1968, Serge Bard termine Détruisez-vous, acte de naissance du groupe Zanzibar. au début de la décennie quatre-vingts[44][44] La deuxième moitié des années soixante-dix aura été le théâtre d’une lente extinction. Excepté le travail de Carole Roussopoulos, qui continue d’animer des collectifs travaillant en vidéo jusque dans le milieu des années quatre-vingt (voir son entretien avec Hélène Fleckinger, « Une révolution du regard. Entretien avec Carole Roussopoulos, réalisatrice féministe », Nouvelles questions féministes, 2009/1 [Vol. 28], p. 98-118, [en ligne], consulté le 12/10/2018), les derniers groupes d’importance disparaissent à l’orée du mitterandisme : ainsi de Cinélutte en 1981, et, la même année, du collectif Mohamed, formé deux ans plus tôt à Vitry-sur-Seine., le rougeoiement du fond de l’air donne aussi bien naissance à nombre de groupuscules d’activistes qu’à une longue de série de collectifs de cinéma[55][55] Un premier bilan de cette expérience avait été fait dans Cinéma d’aujourd’hui, dossier « Cinéma militant : histoire, structures, méthodes, idéologie et esthétique », n° 5-6, mars-avril 1976. Voir aussi, plus tardif, CinémAction, n° 25, 1983, dossier « Vingt ans d’utopie au cinéma »., pour la plupart partisans mais à l’écart de toute orthodoxie (difficile d’étiqueter les positions des groupes Medvedkine ou même du Groupe Dziga Vertov, pourtant proche de Louis Althusser et de certains maoïstes : tous ces films récusent les affiliations doctrinales trop verrouillées, et aucun collectif ne s’est conçu comme l’émanation d’un camp spécifique). Cette séquence historique commence à être bien documentée[66][66] Pour un référencement tout à fait partiel, voir, sur les Groupes Medvedkine et le Groupe Dziga Vertov, Sylvain Dreyer, « Le cinéma militant et le mythe du collectif », Création collective au cinéma, n° 01/2017, p. 29-45, consulté le 10/10/2018, [https://creationcollectiveaucinema.com/revue-01/]. Sur le Groupe Dziga Vertov, voir aussi David Faroult, Godard. Inventions d’un cinéma politique, Paris, Amsterdam, 2018. Sur le groupe Zanzibar, voir Sally Shafto, Les films Zanzibar et les dandys de Mai 1968, Paris, Paris Expérimental, 2006. Sur l’aventure de la vidéo en France, voir les travaux de Hélène Fleckinger, notamment sa thèse, « Cinéma et vidéo saisis par le féminisme (France, 1968-1981) », Paris III, 2011. Romain Lecler a publié en ligne une bonne synthèse de ces années dans un diptyque intitulé « Le cinéma militant français des années 1970 », Critikat, [en ligne ici et ici., même si une légère ironie historiographique a voulu que les collectifs les plus vite reconnus l’ont été en raison de la présence d’un cinéaste célèbre en leur sein, quand bien même celui-ci aurait voulu y perdre son nom et sa marque (ainsi de Chris Marker et de Jean-Luc Godard dans les deux groupes cités plus haut, même s’ils ont organisé différemment leur disparition ; Philippe Garrel a signé certains des films réalisés avec le groupe Zanzibar, mais puisqu’il s’agissait de ses débuts de cinéaste, il n’avait encore qu’une faible notoriété et donc aucun cachet à éclipser). Pour en terminer le rappel, on soulignera qu’elle avait été précédée de longue date par des expériences similaires – celles, par exemple, d’Armand Guerra avec le Cinéma du Peuple ou du Frontier Film Group dans l’Amérique du New Deal[77][77] Voir Federico Rossin, « Collectif de film », Vacarme, n° 62, hiver 2013, p. 85-94. – mais que celles-ci ne disposaient alors pas du modèle du collectif comme groupement mu par un projet plus ou moins unitaire et cohérent.
C’est peut-être là le noyau d’une forme par ailleurs fort plastique : l’idéal-type du collectif réside moins dans des caractéristiques filmiques ou même des méthodes de travail bien précises que dans la conviction que le processus importe autant que son résultat. L’expérience – œuvrer en cœur, décider ensemble – en constitue la finalité première, et l’aventure qu’elle implique consiste aussi bien en l’invention de modes opératoires égalitaires qu’en la fabrication d’un film. C’est là le point commun aux collectifs « classiques » (ceux de la décennie rouge) et à ceux bourgeonnant aujourd’hui[88][88] Pour ce qui touche à l’après-Mai, les scènes d’assemblée générale du Vent d’est du Groupe Dziga Vertov (tourné avec des communistes italiens et quelques Parisiens gravitant autour de Daniel Cohn-Bendit, monté sans eux par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin et diffusé en 1970) ont une double valeur, allégorique et aporétique : si elles radicalisent le principe de la décision collective – le moindre aspect doit être décidé en groupe, le film ayant pour contenu privilégié les débats présidant à sa réalisation –, elles en signalent aussi les limites, non sans amère ironie de la part des monteurs. L’horizontalité est bien sûr un horizon plutôt qu’un fait. Les Scotcheuses elles-mêmes – groupe le plus avancé en la matière – soulignent combien il faut de précautions pour déminer les mécanismes de domination menaçant toujours ce genre d’entreprise : voir leur entretien avec Nicolas Rey dans Jef Klak, « Faire du cinéma comme on occupe des zones à défendre », [en ligne], publié le 16/01/2018, consulté le 22/05/2018 : tous naissent avec la volonté de défaire certains partages, de déspécialiser le travail en dépassant la division entre direction (réalisateur) et assistanat (les fonctions techniques), tout en estompant la ligne qui sépare le « professionnalisme » de l’« amateurisme ». Ces tentatives de repenser les relations de travail au prisme de l’égalité et contre le dogme des expertises de métier s’accompagne généralement d’une position marginale au sein du champ cinématographique, les films circulant le plus souvent hors des canaux habituels de diffusion, soit parce que les collectifs tiennent à s’en excepter, soit parce qu’on les en évince (de là aussi la création de circuits parallèles et l’invention d’autres formes de projection que celles garanties par le circuit des salles agréées – de ce point de vue, l’expérience paradigmatique est celle du collectif de production et de diffusion Slon/Iskra, créé à l’initiative de Marker[99][99] Sur cette aventure, voir Catherine Roudé, Le cinéma militant à l’heure des collectifs. Slon et Iskra dans la France de l’après-1968, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.).
Certes, un tel portrait est bien abstrait. Mais ce préambule n’ambitionnait que de sérier les enjeux inhérents à la constitution d’un collectif, quel qu’il soit. La suite du propos tentera d’articuler quelques groupes contemporains à leurs aînés historiques, afin, d’abord, de saisir ce qui change d’une configuration à une autre en termes de stratégie, et pour ensuite cartographier les positions et les pratiques saillant entre les quatre pôles que forment les collectifs retenus : les Scotcheuses, Comet, le Groupe Boris Barnet et Taranis News.
Quatre collectifs d’aujourd’hui
La genèse et la geste de chacun n’ont bien sûr rien de ponctuel et de rectiligne, et les quelques mots de présentation que voilà sont hélas obligés de schématiser des trajectoires. Les Scotcheuses – le nom vient du scotch utilisé pour coller les bobines de Super 8, format exclusif du collectif – s’est constitué en 2013 à l’occasion du tournage du Bal des absent.e.s, et compte aujourd’hui quatre films à son actif (le dernier, No ouestern, a été réalisé à la Zone à Défendre – ZAD – de Notre-Dame-des-Landes en 2015) et un cinquième en préparation, à Bure, là où l’ANDRA installe un site d’enfouissement de déchets nucléaires (si le film précédent était présenté comme « western post-apolitique », celui-ci, basé sur les cadres génériques de la science-fiction, est décrit comme « film d’anticipation post-catastrophique »[1010][1010] La plupart des films des Scotcheuses s’inscrivent dans des canevas génériques classiques qu’ils ébranlent, tout en profitant de l’impact sur les imaginaires que ces cadres autorisent. Sur ce point, outre l’entretien déjà cité, voir celui réalisé par Romain Lefebvre, « Conversation potentielle avec les Scotcheuses, Mariana Otero et Matthieu Bareyre », Débordements, n° 1, mars 2019, p. 200-237.). Créé en 2010 par des élèves de la classe préparatoire Ciné-Sup au lycée Guist’hau de Nantes (à noter, tous les fondateurs ont quitté le collectif avant ses premiers travaux d’importance), Comet – pour « Court-métrage » – peut paraître aux antipodes du Scotcheuses : les films (au nombre de treize) demeurent signés individuellement et ne s’apparentent pas directement à des œuvres « de lutte », malgré les combats que peuvent mener par ailleurs certains des membres – le style, s’il en est un, s’approche plutôt de quelques modernes portugais (Oliveira et Monteiro planent sur plus d’un film du groupe) et des apôtres du cinéma allégé (Alain Cavalier ou Boris Lehman). S’il est proche de Comet dans sa recherche d’un éclat de la parole – suivant une tendance plus « godardo-straubienne » – le Groupe Boris Barnet est par contre né d’une lutte, celle des intermittents du spectacle ; le seul film réalisé à ce jour, Salaud d’argent (que la langue s’attache à mon palais)[1111][1111] Voir le texte de Robert Bonamy, « Commun brouillon. Salaud d’argent (que ma langue s’attache à ton palais) », Cinétrens n° 3, mai 2017, repris sur Dérives.tv [en ligne]., a été fini en 2016 après un tournage (en 16mm) étalé entre 2008 et 2014, dans un bâtiment occupé par la coordination des Intermittents et précaires d’Île-de-France et avec pour acteurs les protagonistes de ce combat, qui y récitent un texte adapté d’un passage des Palmiers sauvages de William Faulkner. Le dernier groupe, Taranis News, représente un cas à part dans la mesure où, réuni en 2014 à partir d’une structure antérieure, Rennes TV, il a depuis cessé de se présenter comme un collectif pour se constituer en agence de presse gravitant autour d’une figure plus fameuse, Gaspard Glanz[1212][1212] Voir son entretien avec Tomas Statius, « Gaspard Glanz, le journaliste préféré de la génération Nuit Debout », Street Press [en ligne]. Sur Taranis News, voir aussi Gabriel Bortzmeyer, « Révolution, touche replay », Vacarme, n° 77, automne 2016, p. 74-83. – ses méthodes rendent néanmoins un écho tardif aux groupes de vidéastes qui, dans les années soixante-dix, produisaient également des images de luttes censées échapper au filtrage des médiations officielles.
Certes, l’actualité des collectifs ne se limite pas à ces quatre groupes, loin de là[1313][1313] Pour n’en citer que quelques autres : le collectif Synaps, étroitement lié aux Scotcheuses ; le collectif Tribudom, plus ancien – il est né après les présidentielles de 2002 –, davantage intégré aux structurelles officielles et aux réseaux d’éducation populaire ; Street Politics, qui, comme Taranis News, abonde dans le genre récent qu’est le « film de manifestation », tendance guérilla.. Ceux-là présentent toutefois l’intérêt d’une parenté virtuelle avec les quatre collectifs les plus illustres de la séquence antérieure, du moins si l’on accepte de voir dans ces appariements une simple suggestion. Taranis News répète la pratique de Cinéluttes et d’autres groupes ayant travaillé en vidéo pour être plus organiquement et immédiatement liés aux combats d’alors. En se mettant sous le patronage d’un cinéaste soviétique de la première moitié du siècle, le Groupe Boris Barnet rend hommage aux groupes Medvedkine et Dziga Vertov, même si, d’un point de vue plus strictement formel, il ne rappelle les mânes que de ce dernier : principe identique d’un film « en chantier » (des travaux d’aménagement urbain sont d’ailleurs constamment visibles en arrière-plan), semblables plans fixes aux cadrages rigides, mêmes jeux sonores croisant vacarme ambiant et invocation pathético-théorique. Comet pourrait être rapproché du groupe Zanzibar, dans la mesure où s’agit des deux seuls collectifs à avoir maintenu le principe de la signature individuelle et à être resté plus à l’écart de l’activisme ; le plus jeune n’a pour autant rien du dandysme bohème et nihiliste de son aîné, et préfère à son iconoclastie une sorte de piété figurative à l’égard des images d’hier. Enfin, les Scotcheuses ont en commun avec les Groupes Medvedkine le désir d’une ferme inscription locale, impliquant une participation très large et, avec elle, un authentique partage des savoirs et des expériences (ses membres aiment d’ailleurs se présenter comme un « collectif de cinéma-mais-pas-que », leur démarche les amenant à consacrer autant d’énergie à d’autres activités comme la réfection des granges d’un agriculteur ou la plantation de patates, sans compter les manifestations, squats et occupations – le cinéma n’étant que le catalyseur d’une aventure qui le dépasse tout en répétant en chaque aspect les mêmes axiomes d’autonomie et d’égalité).
Bien sûr, ce ne sont là qu’analogies, par ailleurs partielles. Elles permettent néanmoins de dégager les conditions favorisant l’émergence de tels groupes, à savoir la coïncidence d’un réchauffement politique et de la fissuration des circuits habituels du cinéma. Les années ayant suivi Mai 68 ont connu à la fois une ferveur militante inusitée et, à la suite des Etats généraux du cinéma, un désaveu des distributeurs installés ainsi que de la filière des financements (d’où la désertion d’un Godard, ou la création de Slon par Marker). À cette situation répond, avec d’autres maux, la séquence ouverte par la crise de 2008, dont la violence s’aggrave d’enjeux écologiques plus aigus qu’hier : même polarisation de l’échiquier politique, même bourgeonnement des lieux en lutte, et disqualification similaire des guichets « officiels » comme ceux du CNC et des régions, qui ne pourvoient que rarement et à doses limitées les collectifs dont il est fait état ici. En bref, l’appauvrissement des filières et la paupérisation des travailleurs culturels encouragent l’éclosion des collectifs. C’est en 2008 qu’est mis en chantier Salaud d’argent, que son carton final présente comme un « volet existentiel d’une recherche sur la précarité et l’indépendance » et qui fut financé grâce à une dotation de la région Île-de-France en vue d’une enquête intitulée « Intermittence quatre ans après. La précarité de l’emploi et des droits sociaux, enjeux conflictuels ». Le texte qu’il adapte porte justement sur l’abandon des statuts trop installés (le personnage central, Wilbourne, essaie de convaincre son interlocuteur que le confort de son état étouffe son être), en écho à l’érosion contemporaine des cadres de l’existence. Le collectif apparaît justement comme une réponse à cette précarité touchant la plupart des acteurs concernés – le groupe à l’origine de Taranis News était fait de jeunes vidéastes ou aspirants journalistes à qui tout statut solide était refusé, et plusieurs membres des Scotcheuses ou de Comet ne vivent sans autre protection institutionnelle que le Revenu de solidarité active. Dans ce sort partagé gît peut-être la plus grande différence avec les collectifs de la séquence antérieure, pour la plupart nés d’un désir de jonction entre des professionnels de l’audiovisuel et des prolétaires apparaissant comme un voisinage lointain : à ce rêve de convergence par-delà les divisions a succédé un précariat de plus en plus généralisé, qui modifie les dynamiques subjectives (les cinéastes n’ont plus besoin de quitter un état) et les positionnements (ils sont d’emblée dans la marge).
Une telle mutation touche également l’horizon de la lutte et des films : les collectifs d’antan avaient la grève pour objet privilégié, et créditaient encore le mot de « révolution » de bien des pouvoirs ; la nature du commun a changé, et avec elle les actions chantées : auto-réductions en supermarché (séquence d’ouverture de Salaud d’argent), émeutes et débordements de manifestation (l’essentiel de la production de Taranis News tourne autour des heurts avec la police, non sans lyrisme insurrectionnel), zones à défendre, territoires autonomes où cultiver des patates et des possibles (seuls les deux derniers films des Scotcheuses ont été tourné à Notre-Dame-des-Landes, mais les deux premiers avaient également pour terreau des communautés suspendues – fête des morts pour Le bal des absent.e.s, ferme d’éleveurs résistant aux contrôles dans Anomalies). Cet éloignement des théorèmes révolutionnaires au profit des bascules de l’hic et nunc induit des différences de construction et d’énonciation : si l’ancienne génération de films militants avait pour cœur des scènes de discours – prise de parole (voir par exemple Classe de lutte du Groupe Medvedkine de Besançon, 1969, ou les péroraisons apocalyptiques des personnages de Détruisez-vous, le film de Serge Bard constituant l’acte de naissance du collectif Zanzibar en 1968) ou théorie exposée en voix-off (soit l’essentiel de la production du Groupe Dziga Vertov, ou des films coordonnés par René Vautier ou Joris Ivens à la même époque) –, les films des collectifs contemporains se montrent plus laconiques, à l’exception de Salaud d’argent (et encore, les voix qui s’y déploient n’ont que peu de rapport avec les prosopopées marxisantes de jadis). Le problème, aussi, n’est plus d’opposer un discours de classe à un autre, mais plutôt d’inventer une certaine chorégraphie dans laquelle des corps précaires, anonymes et fragiles réinventent leurs conditions d’apparition (c’est tout le scénario du Passant intégral, court-métrage d’un des membres de Comet, Léo Richard ; mais c’est aussi ce que racontent, d’une autre façon, les aventures carnavalesques des films des Scotcheuses ou les danses émeutières que documente Taranis News). Bref, la vitalité des collectifs a valeur de thermostat politique d’une époque ; la nôtre ne s’écarte d’abord de celle de l’après-Mai qu’en raison d’une précarité aggravée, qui politise autrement les sujets et positionne différemment les collectifs par rapport aux structures établies. Il reste à ajouter à ces différences épochales les écarts entre les collectifs contemporains.
Plans de travail
La meilleure mesure de ces divergences serait le sort réservé par chacun aux procédures égalitaires. Les Scotcheuses tiennent ici le rôle de pôle radical : groupement le plus large – constitué d’une dizaine de personnes pour les deux premiers films, il en compte aujourd’hui une trentaine, avec un fort taux de renouvellement –, il a pour règle fondamentale la décision collective de chaque chose (facilitée par la vie en commun sur les lieux en lutte) et s’organise en fonction de trois principes, « l’horizontalité (pas de hiérarchie), l’ouverture (pas de sélection) et la transmission (pas de division du travail)[1414][1414] « Conversation potentielle avec les Scotcheuses, Mariano Otero et Matthieu Bareyre », entretien cité, p. 209. ». Le respect de ces principes est d’ailleurs l’une des raisons avancées pour expliquer le très long temps de réalisation du dernier film. Le groupe Boris Barnet s’appuie sur une organisation similaire, avec le même désir de repenser le partage contre toute forme d’échange asymétrique et autoritaire ; rien d’étonnant, donc, à ce qu’il ait pris six ans pour réaliser son unique court-métrage – mais rien de dommageable non plus, puisque l’importance d’une telle démarche réside d’abord dans l’expérience politique de la délibération. Comet suit une autre optique, moins redistributive : d’une part, au tournage, les postes ne sont pas complètement interchangeables, et si certains membres changent de fonction suivant les films, ce n’est pas le cas de tous (ainsi du producteur ou de la chef-opératrice) ; d’autre part, chaque film est signé par celui occupant le poste de réalisateur, même si le nom de Comet apparaît sur les affiches et en début de générique ; il y a bien des décisions collégiales au sein du groupe, mais rarement une collectivisation du projet esthétique. Les membres eux-mêmes précisent que le collectif n’est pas « une sorte de super-entité, cohérente et programmatique » mais « un outil modulable par chacun » ; l’un d’eux compare d’ailleurs le groupe aux collectifs de graffeurs ou de rappeurs, dans lesquels chacun invente une signature individuelle au sein d’une structure partagée : ainsi, « le collectif est un hybride, un point de jonction entre des désirs individuels, des formations et un groupe[1515][1515] Voir, dans cette même revue, l’entretien « Des plans pour le Comet » », une matrice souple ajustable en fonction des singularités (ce qui le protège contre tout retour de l’auteurisme). En réalité, seul Taranis News tourne autour d’une figure de proue (Gaspard Glanz) éclipsant en partie ses pairs, comme ce fut jadis le cas avec le collectif japonais Ogawa Productions ; c’est aussi que la temporalité (les vidéos sont diffusées peu de temps après les événements) et la logique budgétaire diffèrent largement de celles des autres groupes, et poussent à une verticalisation relative. Mais dans tous les cas, il y a un rapport intrinsèque entre le degré d’horizontalité du collectif, la durée de réalisation de ses films et leur élasticité esthétique (Comet faisant preuve de la plus grande hétérogénéité, comme Zanzibar en son temps).
Taranis News s’excepte aussi du quatuor analysé dans la mesure où il est le seul collectif à employer des caméras numériques d’assez bonne qualité (en témoigne sa devise : « Liberté, égalité, Full HD »). Autrement, la tendance est à l’utilisation de formats plus anciens, parfois tombés en désuétude, voire proches de la disparition : le Super 8 dont font systématiquement usage les Scotcheuses, la mini-DV employée pour plusieurs films de Comet (Le Voleur de Lisbonne, 2016, et Le Passant intégral, 2017, de Léo Richard, Return to Providence, 2016, de Pierre Desprats, Benjamin Hameury et Maxime Martinot), le caméscope VHS (pour Gang, 2016, de Camille Polet) ou, même s’il s’agit d’un format moins raréfié, le 16 mm, avec lequel ont été tournés Trois Contes de Borges (2014) et Salaud d’argent (dans ce dernier cas, l’aide du laboratoire l’Abominable a été décisive). La coïncidence de ces pratiques n’exclue pas l’hétérogénéité des motivations, parfois au sein du même groupe. Les Scotcheuses l’expliquent en partie par un besoin de « remettre un peu d’étrangeté », et par les facilités d’emploi et d’entretien du matériel ; les membres de Comet l’articulent à la recherche d’un grain spécifique, à un désir d’expérimentation ou à un effet de distanciation temporelle. Il est en tout cas intéressant de comparer ce mouvement actuel vers des formats anté-numériques à l’engouement des collectifs de jadis pour la vidéo ou les pellicules à faible résolution. Ces derniers avaient souvent migré vers ces supports pour des raisons de coût, et parce que la pratique fréquente du cinéma direct s’accomodait mieux de la vidéo ou de pellicules rapidement développables et liées à du matériel léger ; en cela, ils avaient anticipé la démocratisation de la fabrique des images dont l’aboutissement est justement ce numérique que récusent les collectifs contemporains. De ce fait, collectifs d’hier et d’aujourd’hui utilisent des moyens de production similaires, mais pour des raisons inverses, les plus récents usant de vieux formats pour échapper aux facilités du numérique et retrouver une économie mesurée, articulée autour d’une relative rareté de moyens (« privilège » de la pellicule, quand l’enregistrement continu et infini du numérique invite à moins de précautions). Les supports mineurs, démodés, deviennent alors l’argument d’une résistance au tout-venant numérique – chose très nette dans le cas de Salaud d’argent, où l’argentique apparaît comme antidote anti-digital en raison même des contraintes qu’il implique.
Toutefois, la plus cruciale des problématiques contemporaines concerne peut-être plus des enjeux de circulation que ceux inhérents à la production, qui, devenue partout si commode, entraîne une inflation audiovisuelle invisibilisant davantage les films. De ce point de vue, les stratégies de chaque collectif diffèrent. Comet s’appuie sur le circuit traditionnel des festivals et des projections ponctuelles, Trois contes de Borges ayant même connu une discrète sortie en salle en 2018 (soit quatre ans après la réalisation du film) ; le Groupe Boris Barnet a fait passer Salaud d’argent par le même canal, après une première au FIDMarseille en 2016. Taranis News et les Scotcheuses présentent en revanche deux polarités complémentaires. Les vidéos du premier habitent YouTube et se diffusent en majeure partie via les réseaux sociaux. Il y a à cela des raisons financières – le groupe a démarré avec aussi peu de moyens que de visibilité, et avait donc besoin d’un support gratuit en même temps que propice à la viralité – ainsi que temporelles – Internet est devenu le média de l’instantanéité, plus encore que la télévision. Mais en dehors de ces motifs pratiques joue peut-être une logique affinitaire plus profonde : il y a un isomorphisme entre la structure réticulaire du Net et les luttes que filme Taranis, elles aussi horizontales et structurées en essaims, obéissant à des formes de groupement dont le réseau internautique offre le meilleur paradigme. À l’inverse, mais selon la même loi de similitude, les Scotcheuses conçoivent leurs projections comme des performances dans un lieu circonscrit, de même que les combats qu’elles accompagnent ont pour base un ancrage dans un espace partagé, fût-il en proie aux dissensions (ainsi de la ZAD). Aucune « séance » (il s’agirait plutôt de fêtes, débordant largement le temps du film) n’est organisée sans le concours de membres du collectif[1616][1616] Ce qui n’a pas empêché le collectif de mettre en circulation une édition Dvd de ses films, diffusée par Potemkine., et le baptême d’un film prend forcément place sur son lieu de naissance, avec les acteurs de la lutte. Les premiers avaient d’ailleurs été tournés et montés en quelques jours, puis immédiatement projetés selon la formule du ciné-concert : loin d’être un simple objet, le film est l’igniteur d’un processus et l’instrument d’un événement, qui valent par la communauté y prenant forme. Bref, si Taranis News apparaît comme l’analogue audiovisuel des groupes amorphes et mouvants favorisés par le Web, les Scotcheuses retrouvent dans leur pratique de diffusion le modèle innervant les communautés autonomes renvoyant à l’ordre du monde son image inversée (d’où, aussi, la prégnance du thème carnavalesque à travers leurs films). Cela ne leur interdit pas pour autant un nomadisme ponctuel. Des projections dans des zones militantes ont lieu de temps à autre et, surtout, le collectif a rejoint une initiative de son homologue Synaps, à l’origine du « Cinéma Voyageur libre et ambulant » (dispositif minimal – un chapiteau, un projecteur, un petit écran et des chaises élémentaires – circulant à travers la France pour partager des films ostracisés par le marché) : après une soirée de lancement/financement le 22 novembre 2018, les deux collectifs ont mis sur pied le « Paname Projo Kit », matériel de projection mutualisé, conçu pour tenir dans une voiture et mis à disposition de tous les groupes également désireux de défendre un cinéma plus bénéfique que profitable. Signe que les collectifs tendent eux-mêmes à se collectiviser.
Les laboratoires du commun
Pour finir, une récollection : de ces fabriques du commun pourraient être extraits quatre problèmes, qui dessinent autant de perspectives émancipatrices sans pour autant accepter de réponse définitive. Le premier est d’ordre financier : comment garantir l’autonomie de la réalisation grâce à une économie de subsistance et, incidemment, comment ces moyens allégés se traduisent-ils dans les formes filmiques ? Le second est indissolublement technique et pédagogique : comment rompre avec l’idéologie du « spécialisme » (et son corollaire, la division de l’expert et de l’amateur) en inventant des formes de transmission ou d’auto-formation qui échappent au discours de la maîtrise ? Le troisième, éthique : comment concevoir la responsabilité d’un film, une fois l’auteurisme neutralisé et dès lors que la participation collective empêche de rabattre l’idée de signature sur le modèle de la monade ? Ces trois axes n’ont de sens qu’au regard du quatrième, politique, qui n’est lui-même concrétisé que par leur entremise : comment articuler une pratique de cinéma à un ordre qui la transcende, en espérant que les manières de travailler qui s’y inventent aient un impact débordant le champ de l’art ? Tout, dans l’expérience collective, converge vers ce vœu d’une conversion plus globale de l’existence, que ce soit dans l’espoir un peu flou que les films préparent les consciences au changement ou dans celui, plus fondé, que leur fabrication permette d’expérimenter d’autres relations sociales. Or, c’est aussi pour cette raison que « l’esthétique » est absente des quatre points listés. Non que les films soient informes ou que les questions de composition n’apparaissent à aucun moment des processus – bien au contraire. Seulement, la somme des désirs agrégés dans ces expériences excède de beaucoup la simple volonté d’art, si bien que la beauté des films tient, à terme, aux solutions partielles qu’ils offrent aux problèmes évoqués. L’esthétique n’est alors plus le sanctuaire des belles formes, mais l’écho des combats.