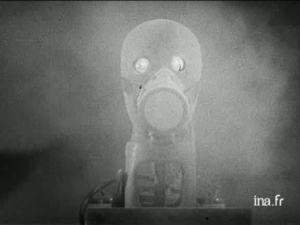Image autiste, parole errante (2/3)
Autour de Fernand Deligny, António Reis et Margarida Cordeiro
Révolution
Deligny et son « ethnie » créée dans une France lointaine et secrète, se situent dans un retrait du monde et en même temps dans une exploration sensible et intellectuelle de ses fondements. Deligny y pratique l’art de l’esquive, qui n’est pas de fuir ni d’oublier, mais bien de regarder, guetter au loin ce qui se trame sourdement au cœur des institutions de l’homme. D’esquives, sa vie en fut remplie, où il eut bien le temps d’arpenter le dehors, comme ce jour de jeunesse où il décida de ne pas passer la porte de l’université :
« une tentative, c’est dehors. Bien sûr il y a des maisons dans les tentatives, mais c’est jamais la rentrée. C’est dedans que le sujet s’élabore, dans toutes les formes d’institutions possibles. Il s’agit d’esquiver la rentrée. »[11] [11] Fernand Deligny, « Le Croire et le craindre » in Œuvres, op.cit., p.1095.
Pour Deligny, le dedans est sujet à être sujet, s’y nouent les tares et les abus du monde moderne. Il nomme « la trilogie du Langage, la Personne, l’État », qui abusent l’humain respectivement dans une « magie du verbe, illusion de la personne, pouvoir de l’état »[22] [22] Fernand Deligny, « Les Cahiers de l’Immuable. 2 » in Œuvres, op.cit., p.939. . Hameaux, chèvres, ruisseaux, pains et vaisselle permettent la circulation au dehors, libèrent le coutumier. Le silence supprime le sujet et l’emprise du verbe, outils souverains de l’éducation. Ici ce n’est pas une alternative, c’est une multiplicité de discrètes soustractions qui ne proposent pas une forme nouvelle d’institution, mais bien un autre mode d’être. Comme dit Straub à l’époque d’Othon :
« en se contentant de s’opposer au système, on risque fort de le consolider. […] Il faudrait supprimer le système […], ses parasites et ses maquereaux. »[33] [33] Jean-Marie Straub, Écrits, Independancia éditions, Paris, 2012, p.65.
Violence, récalcitrance utopique, qui n’agit pas contre mais se bat pour détruire, faire table rase. Esquiver, avec en visée la révolte, mais sans que cela se fasse volontairement : c’est bien la seule solution pour que la révolution advienne. Deligny cite plusieurs fois Engels, pour qui la révolution procède de circonstances complètement indépendantes de la volonté et de l’action. Il fait bien évidemment le parallèle avec l’image qui « n’est pas un acte de volonté »[44] [44] Fernand Deligny, « Acheminement vers l’image » in Œuvres, op.cit., p.1737. . Pensons à cette puissante dernière image du film de Johann van der Keuken, Journal (1972), où l’on voit le gros plan du visage d’un bébé dormant, le fils de l’auteur qui vient de naître, avant que n’apparaisse un carton noir où s’inscrit le mot révolution.

La violence du mot est mêlée à l’insouciance de l’image de l’enfant, simple image, doublement faussée : faussement « domestique » (le cinéaste filme son enfant), faussement propagandiste (cet enfant pourra faire la révolution). Non, l’enfant n’est en rien concerné par la révolution, cela ne le regarde pas : le mot, figé, ne regarde pas l’image, insouciante, autiste. Mais dans la collure s’immisce ce qui ne se voit pas, l’invoulu, l’inchangé qui est la puissance de la pensée bressonnienne : « sans rien changer, que tout soit différent »[55] [55] Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Gallimard, Paris, 1975, p.136. . Révolution, dont l’étymologie signifie exactement : revenir au point de départ, au point de naissance.
Point(s) de départ : nombreux sont-ils chez Deligny, et les lignes qui les lient s’y entremêlent aussi bien. D’où son intérêt pour les ethnologues et anthropologues de son époque, comme le révèle cet étonnant témoignage de Jean Houssaye :
« Ce n’est pas pour rien que nous venons de rencontrer Lévi-Strauss, car Deligny au fur et à mesure va faire des ethnologues ses interlocuteurs privilégiés. L’ouvrage Singulière ethnie est très significatif sur ce point. De quoi ? Du fait que le mode d’existence de la « tribu Deligny » dans les Cévennes ressemble étrangement à ce que Clastres, un ethnologue spécialiste des Indiens d’Amérique, décrit de ces sociétés dites archaïques. En quoi ? En ce que ces sociétés dites a-historiques ont évacué le pouvoir. Elles ne l’ont pas laissé se produire, par intuition que le pouvoir est ce qu’il y a de pire. […] Elles l’ont évacué par drainage du langage et de ses effets de pouvoir, tout en concevant une personne à part dont le rôle semble être de parler, comme dépourvu d’avoir autre chose à faire que parler. »[66] [66] Jean Houssaye, Deligny, éducateur de l’extrême, Éditions Érès, 1998, p.53.
L’opération inédite des Indiens a été d’isoler le langage dans un corps spécifique, de le contenir pour qu’il ne puisse pas s’épancher sur le groupe. Acte politique radical qu’a tenté de reproduire, à sa manière, Deligny.
Le personnage d’Yves dans Le Moindre geste serait peut-être l’indigène malchanceux que l’on aurait assigné à la marge du groupe, condamné à parler la parole qui lui vient d’un autre monde, d’un autre lieu. Le Moindre geste, dans cette optique, serait l’accolade du Yves condamné à la parole, et du Yves libéré au geste.
Certains ont pu voir dans le monologue d’Yves un délire proche d’un Antonin Artaud, celui exprimé dans sa « maladie » :
« Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de phrases, directions intérieures de la pensée, réactions simples de l’esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j’en souffre, mais j’y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. »[77] [77] Antonin Artaud, « correspondance avec J. Rivière » in L’Ombilic des Limbes, Gallimard, Paris, 1927, p.20.
Recherche effrénée, solitaire, dévouée à la persistance d’un élan vital. Cette condition de l’art, présente chez lui comme chez Vincent van Gogh, ramène le corps de l’artiste , avec son implication douloureuse mais inévitable, dans son travail. Deligny, qui tenait le peintre pour un maître (il faut ajouter aussi Rimbaud), dût voir en lui la figure de l’artiste rejeté par la conscience morale du monde, bourgeois et religieux, tout comme peuvent être rejetés les fous, les débiles, les illuminés. La rencontre, à travers les années, de van Gogh avec Artaud, peut ressembler à celle de Deligny avec les enfants difficiles ou autistes : il y parle d’un lieu qui ne leur donne pas tant la parole qu’il pointe ce qui ne peut se dire de leur condition. Artaud, dans sa vie tourmentée, a écrit la douleur du peintre parce qu’il l’a vécue, expérimentée lui-même :
« Je ne cherche pas à me justifier à vos yeux, il m’importe peu d’avoir l’air d’exister en face de qui que ce soit. J’ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi. »[88] [88] Ibid., p.24.
Après avoir été lui-même interné, il accuse violemment la société et la psychiatrie :
« C’est ainsi qu’une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient. »[99] [99] A. Artaud, Van Gogh ou le suicidé de la société, 1947, in Oeuvres complètes, Gallimard, Paris, 1974, p.14. … « Et c’est ainsi que van Gogh est mort suicidé, parce que c’est le concert de la conscience entière qui n’a plus pu le supporter. »[1010] [1010] Ibid., p.52.
Créer la distance qui Nous sépare du moi, voilà sans doute le trajet produit de l’esquive delignienne.
Camérer
Révolution et image n’étant pas actes de volonté, Deligny propose le terme invouloir :
« Et il me faut esquiver l’inconscient qui alors se propose, mot devenu d’usage courant en langue de psychanalyse.
C’est invouloir qu’il faudrait dire, ni bon vouloir, ni mauvais. »[1111] [1111] Fernand Deligny, « Acheminement vers l’image » in Œuvres, op.cit., p.1722.
Verbe non pas négatif, mais créatif, faisant place à ce qui fuit de l’inconscient ou du conscient, termes écartés du vocabulaire de l’auteur. Invouloir fait advenir ce qui naturellement se propose à l’humain, sans interaction ou surgissement de la conscience. Afin d’accueillir au maximum ce qui advient alors, une discipline de patience et une position de guetteur sont de mise.
« Tout est prévu et prévu de longue date, minutieusement, scrupuleusement, et c’est cette minutie même qui va permettre aux images d’apparaître comme à l’improviste et vous pouvez effacer le « comme », elles surgissent à l’improviste, à vrai dire imprévues par qui voit le film. Et il ne s’agit pas de ce que les événements peuvent avoir d’imprévu ; ce dont je veux parler, c’est de l’envol des images qui répond à l’attente de tout un chacun, attente tacite et qui n’attend rien de personne. »[1212] [1212] Ibid., p.1681-1682.
Ne rien attendre : là encore nous pouvons nous permettre d’effacer la négation « ne », et « rien attendre » serait l’état d’ouïr et de voir propice aux envols des images. À l’improviste, dans un rien du monde, ricochent images autistes et oies sauvages, où s’exacerbent les lois du hasard :
« Tout le monde s’efforce d’atténuer le hasard. […] et si jamais – dans un film – pouvait s’entrevoir le hasard ? Il faudrait « désintentionnaliser », ôter l’intention. »[1313] [1313] Fernand Deligny, « Deligny et les enfants sauvages », op. cit., p.50-51.
Ici tangue un fil indicible, une manière de dire ce qui est d’espèce dans « l’entrevue » du hasard, lié à ce qui dans un geste ne se voit pas. Invisible et indicible sont-ils pour autant de même nature ? Comme le martèle Deligny, mot et image n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Mais, une fois rendus in-dicibles et in-visibles, ne se rejoignent-ils pas dans un silence commun ? Peut-être touchons-nous là un nœud sensible et indémêlable, qui aurait à voir avec ce qui nous touche, ce qui vole dans l’image autiste.
Le hasard fait son œuvre en solitaire, obstinément, précisément. C’est notre travail de savoir l’entrevoir, non de le créer ou de le provoquer. Tout comme le travail des cartes n’avait d’autre intention initiale que de simplement voir : le hasard a su s’y immiscer pour révéler de nombreuses « merveilleuses » coïncidences.
La vie de Fernand Deligny aura donc bien été d’explorer ce quoi d’image, il y avait encore en nous. Sa définition si particulière de l’image « autiste », qui n’est pas une appropriation extérieure pour mieux parler de sa tentative, trouve sa place dans le champ éducatif, anthropologique, autant que dans celui du cinématographe, et c’est cette ouverture, ce point de rencontre qui est essentiel. Son projet est étrange, immense :
« être humain, image ; c’est la même chose, tout à fait la même chose. »[1414] [1414] Ibid., p.1690.
Si Nous avons d’espèce l’humain et l’image en commun, affirmation des plus déconcertantes à bien y regarder, s’agit-il de voir dans l’art ce qui nous anime, nous (é)meut, nous regarde depuis le tréfonds des âges, du monde ? Il y va alors sans doute d’une perpétuelle création muette inscrite dans nos gènes, nos pensées et nos gestes, création non pas ascensionnelle mais stationnaire, itérative. L’écrivain Deligny, au cours si dense de ses milliers de pages d’écriture, n’aura fait que réitérer les mêmes choses, elles-mêmes focalisées sur d’autres objets réitérants :
« l’art étant d’effacer – au dire de Giacometti – lorsqu’il s’agit d’écrire, le seul moyen d’effacer est d’écrire encore – à propos de la même chose ; le lecteur s’y habituera. »[1515] [1515] Fernand Deligny, Œuvres, op.cit., p.1754.
Réitérer a ceci de différent au répéter qu’il revient à la source, à la même fréquence. Étymologiquement lié au thème latin de Y – qui a engendré aussi le même (idem), le déjà, le celui, ce, cet, l’ici et l’ailleurs – réitérer fait en quelque sorte la révolution là où répéter ne fait que la copie. Cette distinction nécessaire peut nous aider à mieux comprendre ce qui, inévitablement, revient faire son œuvre dans l’image.
Avant de revenir à Yves, il est utile de citer deux exemples essentiels d’images propres perçues par Deligny dans les gestes de Janmari. Tout d’abord, un morceau de bois et sa situation dans l’espace, alors que Janmari faisait le pain :
« la prestesse, la dextérité, la précision de ses gestes nous laissent pantois. Aussi innocent qu’il puisse être, du moindre faire, il paraît avoir cinq mains tant l’agir prolifère. Où apparaît l’image d’origine car il faut bien quelque réitération de ce qui a eu lieu hier ou avant-hier ou ce jour d’hiver d’il y a cinq ans ; ce morceau de bois qui a servi une fois, par hasard, il y a cinq ans et qui a été posé là, au hasard – dans tel coin où il n’est pas resté, utilisé à nouveau tout à l’heure et reposé n’importe où – prestement la main de Janmari s’en saisit pour le replacer scrupuleusement là où il a été posé, une seule fois, il y a cinq ans. »[1616] [1616] Fernand Deligny, « Acheminement vers l’image » in Œuvres, op.cit., p.1686.
Persistance génétique de l’image dans le corps de l’humain, mémoire précise d’une situation d’objet dans un espace particulier. Janmari remet une chose qui lui semble naturellement à sa place, à son image ; non pas rangée dans un coin, puis oubliée, mais posée là, pour être maintes fois ré-utilisée.
La deuxième histoire est l’une de celles qui a été le plus racontée par Deligny, sous des versions appuyant chaque fois un aspect infime et différent de la situation.
« Une nuit, deux heures du matin ; Janmari couché ; soudain, sa tête, sa nuque devenues mailloche contre les pierres du mur, derrière son lit ; main tendue, une des nôtres, main prise et la présence proche entraînée vers le lieu où, douze heures auparavant, l’une d’entre elles nous avait scié du bois sur une chèvre mal calée ; elle avait pris un caillou, dans la murette, utilisée comme cale, Janmari métronome proche de la chèvre ; retour à la maison, la journée allant vers le soir et la nuit ; et puis, la nuit venue, mailloche ; Janmari tracte l’une de nous autres par la main jusqu’à la chèvre de bois, attrape la cale qu’il remet dans la murette ; retour, nuit paisible.
Preuve évidente de l’existence de l’image. Et là où les croyances coïncident, celles de l’Inde avec d’autres, croyances ou connaissances, c’est dans le fait que le corps de l’homme respire dans le même souffle que celui de la nature ; les chemins du corps et les chemins des alentours ; étrange acupuncture que celle-là ; trouver le point sensible ; le mal venait de cette petite cale de pierre qui se trouve où ? Dans l’image. »[1717] [1717] Ibid., p.1689.
Cette preuve à l’appui, presque dérivée des pensées transcendantalistes, Deligny la tient comme une évidence, mais évidence qu’il faudrait toujours approfondir, fouiller dans sa complexité et (pour) trouver le « point sensible ». Janmari s’y dirige, vers la cale, ses « mains d’aveugle » tendues dans le noir. Comme le fil de l’eau, l’enfant reste intranquille tant que les choses n’ont pas repris leur cours dans le fil du temps ; et il suffit de peu pour que l’image, à une pierre près, en soit contrariée. Peut-on en déduire que Janmari a su lire les images, l’humain, comme avec l’œil d’un cinéaste ? C’est qu’il y a « coïncidence parfaite entre voir et imager »[1818] [1818] Ibid., p.1732. . Comme Schefer, Daney ou Godard, Deligny suppose aussi que les images ont l’œil posé sur le spectateur – l’humain.
Où vient la majeure invention delignienne : camérer, qui naît des cartes et lignes d’erre pour arriver aux films. Il existe quatre textes différents de Camérer, écrits entre les années 70 et 80. Nous en citerons deux, l’un, plus tardif, publié dans les Œuvres, l’autre, dans la revue Trafic en 2005. Deligny a alors l’intuition géniale de replacer non seulement l’action de filmer vers son outil initial, la caméra, mais aussi de proposer l’acte de camérer comme quelque chose de plus complexe et universel :
« Si j’accroche ces propos au clou d’un infinitif qui surprend, c’est peut-être pour indiquer que la caméra peut faire tout autre chose qu’un film, de même qu’écrire peut se faire sans ce complément d’objet qui se dit : un livre. »[1919] [1919] Fernand Deligny, « Camérer » in Œuvres, op.cit., p.1742.
Il écrit ces précédentes lignes en parlant du projet de film « La Grande Cordée », où les adolescents et lui-même filmaient, parfois sans pellicule. Cette proposition riche et son analogie pragmatique avec l’écriture nous permet de concevoir une pratique d’imager : si écrire ne génère pas que des livres, qu’est-ce ? Du texte, sans doute, le texte est commode en ce sens qu’on le retrouve dans la forme du théâtre, de la poésie, du discours, de la lettre, du monologue, du conte oral, et même de la radio et du cinéma. Quel serait alors l’homologue textuel du cinéma ? Bien difficile à dire pour l’époque ; pourrait-on tout de même le formuler aujourd’hui, à l’heure des images numériques et de leur prolifération ? Nous ne le pensons sûrement pas.
Mais Deligny ne parle sans doute pas de l’enregistrement physique des images, et de leur reproduction sur quelconque support ; c’est bien de camérer, avec les yeux, avec les mains, avec les jambes, dont il est question.
« Camérer consisterait à respecter ce qui ne veut rien dire, ne dit rien, ne s’adresse pas, autrement dit échappe à la domestication symbolique sans laquelle, d’histoire, il n’y en aurait pas, faute de conscience, qu’elle soit individuelle ou collective. »[2020] [2020] Ibid., p.1744.
L’éducateur a trouvé dans la caméra l’outil « pédagogique » qui fait annuler les pratiques de la psychiatrie basées sur le langage. La caméra « ne s’adresse pas », n’apostrophe pas, comme il aime le dire du pronom personnel « s’ », elle est chose dans l’espace qui permet de lire l’espace et le temps sans créer du langage. Comme ses expérimentations d’écrivain, l’art n’a ici pas de but, pas d’histoire, il libère les choses de leur environnement symbolique, leur donne forme dans un mouvement de réflexion : une forme qui pense, une pensée qui forme.
Marcher autour et avec la caméra, ce fut sans doute l’objet de l’atelier cinématographique de La Grande Cordée :
« Puisque j’ai parlé d’un détour par la caméra, celle-ci apparaît comme un lieu, ce qui est déjà tout autre chose que de n’être que cette boîte d’où vont se projeter les malices d’un camerlingue. »[2121] [2121] « Camérer » (1977) paru dans Trafic n°53, printemps 2005, p.54-59.
La caméra-lieu peut alors être vue comme chevêtre (terme utilisé par Deligny pour désigner un élément autour duquel se retrouvent, sans raison prédéfinie, les enfants autistes), dont les branches d’un trépied ou les bras d’un « caméreur » soutiennent le point de voir. Point autour duquel se retrouveraient, idéalement, les racines profondes et naturelles du lieu arpenté. Camérer serait donc bien cette action de sillonner puis de s’ancrer, non pas forcément lors du tournage, mais avant, après, dès lors qu’une caméra-lieu nous est échue, serait-ce notre propre œil. D’où l’importance des repérages, du montage préhistorique de la caméra-œil chère à Dziga Vertov.
Si préhistoire du film il y a, l’archéologue à la caméra, patient, part à la recherche purement intuitive de quelque chose d’enfoui, qui ne lui appartient pas, mais dont il connaît intimement la préciosité. Ces moindres gestes innombrables enfouis dans l’image, se révèlent seulement par la patience et l’acte itératif de camérer :
« Or cette trouvaille qui surgit des images, j’espère qu’on me croira sur parole si je dis qu’elle n’était pas préconçue. Je le répète : nous avions le temps, les gestes du héros suivaient leur cours comme pousse le chiendent. Il faut du temps pour filmer la pousse du chiendent. »[2222] [2222] Ibid.
La métaphore du chiendent, herbe récalcitrante et anarchique – aux valeurs nutritives très fortes, comme aime à le rappeler Deligny – convient parfaitement à Yves et à ses gestes : imprévus, irréguliers et pourtant mus par une force intarissable de « poussée » vers le dehors, prenant souvent trop de place. Le temps dont parle ici l’auteur est bien ce qui, dans cette multiplicité exponentielle de gestes, ne se révèle qu’à force d’être multiple, évasif. Le chiendent lui-même pousse sans pré-détermination de naissance : il naît (en) errant. La caméra, chevêtre et lieu de voir, s’impose alors comme un perfectionnement des cartes révélant dans le temps et dans l’espace les lignes d’erre. Si nous avons commencé par tracer pour finir à (par) camérer, c’est aussi parce que le parcours de pensée delignienne nous l’a indiqué si brillamment, comme l’appuie cette dernière intuition :
« Camérer, il y va d’autre chose qui peut s’écrire camerrer, comme si un certain point de voir errait dans une tentative. »[2323] [2323] Ibid.
Dans Le Moindre geste, après la scène des essais de chapeaux de Marie-Rose, commence la dernière séquence de l’errance d’Yves, qui se terminera par ses retrouvailles avec Any, sous le son tonitruant des cornemuses. Entre deux laborieuses tentatives de démêlage de câbles, la caméra le filme en gros plan (rares sont les gros plans de visage d’Yves dans le film), dans un état de repos, de non-action. C’est alors qu’une mouche, moustique ou moucheron, qu’on ne voit pas, semble tourner autour de lui. Il tape sur son épaule, fort, puis doucement, et entre deux gestes, repose sa main tandis que son regard fuit un instant vers le hors-champ, tel un chat peu intéressé, ayant entendu un bruit très lointain ; sa main, qui est restée au cœur de notre attention depuis le tout premier plan, se situe alors dans un état incontrôlé, un vide d’action la faisant suspendre un court moment dans ce que l’on pourrait concrètement appeler image autiste. De ces instants de suspension, le film regorge, subtilement. Un peu plus tard, dans un seul plan, Yves s’arrête de remuer en tout sens un sac de nœuds contre le sol, pour se diriger, de manière presque hypnotique, vers le ruisseau. Celui-ci, resté alors hors-champ, était présent au fond du tapis sonore dès le début de la longue séquence. Yves, lors de son arrêt, dirige d’abord son regard vers le ruisseau, pour ensuite marcher à sa rencontre ; la caméra découvre le paysage, le ruisseau en bas du cadre pour laisser de l’air à la forêt ; Yves, arrivé au fond du plan, se tend de tout son long sur le sol, afin d’y plonger sa bouche dans le ruisseau. Il se fond alors dans le décor, entre les cailloux, l’eau et les feuillages. Il se relève, et écoute encore une fois autour de lui.
D’autres plans, laissant toujours couler le son de l’eau et un lointain brouhaha (que l’on devine être un chantier), montrent Yves dans la rivière, plus large cette fois, claquant violemment son câble dans l’eau à plusieurs reprises ; assis sur le sol il jette des cailloux ; un zoom vient chercher ses mains et ses chaussures, dont les lacets sont, pour une fois, faits.
Cet emmêlement de lignes, de roches et d’eau, autant à l’image qu’au son, culmine dans cette séquence conclusive. Le travail sans but d’Yves – trimbaler un câble dont on ne connaîtra pas l’utilité – est inscrit dans un environnement qui semble comme travailler avec lui : il y a sa place. Les éléments résonnent les uns contre les autres, dans un rythme précis et implacable, comme le sont les gestes imprévus du « héros ».
Où l’on voit que l’image autiste tient en secret l’imprévu qu’elle recèle, laissant se déployer le milieu naturel dont elle est issue, et les autres images ou éléments qui lui sont fraternels. Ce vol d’images sauvages, en formation unie, libère le geste moindre. On pourrait y lire une version renouvelée et épaissie, dans cet extrait du texte Notes sur le geste où Giorgio Agamben voit dans l’image, de peinture ou de cinéma, un fragment du geste (paru dans le premier numéro de Trafic) :
« Même la Joconde, même les Ménines peuvent être envisagées non pas comme des formes immobiles et éternelles, mais comme des fragments d’un geste ou comme des photogrammes d’un film perdu, qui seul pourrait leur restituer leur véritable sens. Car toujours, en toute image, est à l’oeuvre une sorte de ligatio, un pouvoir paralysant qu’il faut exorciser ; et c’est comme si de toute l’histoire de l’art s’élevait un appel muet à rendre l’image à la liberté du geste. […] Le cinéma reconduit les images à la partie du geste. Traum und Nacht, de Beckett, en propose implicitement une belle définition : il est le rêve d’un geste. »[2424] [2424] Giorgio Agamben, Notes sur le geste, n°1 de Trafic, P.O.L., Paris, 1992, p.34. (trad. D Loayza)
Si le titre du chapitre d’Agamben a pour nom « le cinéma a pour élément le geste et non l’image », ce n’est pas tant en contradiction avec l’idée de l’image autiste : car Agamben a bien ici une conception pragmatique, physique de l’image, non essentielle comme celle de Deligny. Si les deux auteurs se rejoignent, c’est bien dans l’idée que le geste est le nerf de l’image, son rythme propre et sa qualité à la fois indicible et invisible. Ce que soulevait par ailleurs Serge Daney : « c’est sans doute ça l’image : ce qui va sans dire »[2525] [2525] Serge Daney, Persévérance, P.O.L., Paris, 1994, p. 54. .