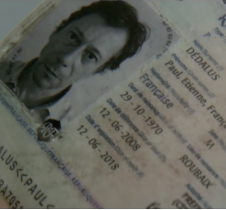Un jeune poète, Damien Manivel
Rimes plates

Dans un article publié récemment sur le site du New Yorker, « The Enemy of Youth », Richard Brody s’attaquait au dernier long-métrage d’Olivier Assayas. Sous sa plume, Sils Maria devenait davantage qu’un film laborieux, aussi pontifiant que gorgé de fausses audaces : l’emblème d’un cinéma français pétrifié par un système de production empêchant toute indépendance, une véritable pierre tombale posée sur les velléités de la jeunesse. La charge était d’autant plus violente que l’auteur ne pouvait être accusé d’une détestation sans nuance du cinéma français, ou plus largement européen. Francophone, auteur d’un livre sur Jean-Luc Godard, il est même de ces rares critiques américains à se soucier de ce qui s’écrit ici. Aussi la surprise était-t-elle grande de ce texte s’achevant sur ces mots : « Il n’y a presque aucun cinéaste indépendant en France, car il n’est pas censé y en avoir. Leur existence en effet menacerait le système qui, par effets d’habitude, d’attraction et de contrainte, est la source de ce confort que le film [d’Assayas] montre et dont il est lui-même l’image. La médiocrité est étouffante. »
Cette déclaration est sans doute pour partie le fruit d’une perspective biaisée par la mauvaise distribution des films français aux Etats-Unis – New York y compris, semble-t-il. D’une part, parce qu’il existe bien des films de « jeunes » cinéastes français (pour ne s’en tenir qu’à eux) réalisés en toute « indépendance ». Ne citons, du côté de la fiction, que La BM du Seigneur et Mange tes morts, de Jean-Charles Hue, ou Trois contes de Borgès, de Maxime Martinot. D’autre part, parce que l’opposition système / indépendance est trop schématique pour être opérante : le système ne saurait être si puissant ou attractif qu’il empêche toute indépendance. L’un ne va pas sans son revers, et les ruses de production ne manquent pas qui brouillent le partage trop hâtif établi par Brody. Les aides du CNC ou des régions permettent les tournages à petit budget plutôt qu’elles ne les empêchent, et leur absence, si elle complique les choses, ne marque pas nécessairement la fin d’un projet (comme le prouve Un jeune poète). Qu’Assayas représente aujourd’hui l’Auteur Officiel, cela est évident. Qu’il puisse être l’incarnation d’un système économique asphyxiant la jeunesse, cela est plus douteux. Il faudra donc mettre sur le compte de la méconnaissance et d’une vision libérale quelque peu primaire la diatribe de Brody. Visible au festival de Brive, d’Angers ou du Réel, célébré en une des Cahiers du Cinéma, le « Jeune Cinéma Français » (JCF) existe bel et bien. Et l’indépendance, qui n’est pas une affaire d’âge, se découvre aussi bien, si ce n’est mieux, en Philippe Grandrieux, Rabah Ameur-Zaïmeche, Jean-Claude Rousseau, Pierre Léon et une dizaine d’autres au moins, qu’en n’importe quel cinéaste américain.
Le problème du JCF, pour se situer ailleurs, n’en est pas moins réel. Il tient, d’un côté, à des effets de standardisation liés, comme le sous-entend Brody, à la recherche de subventions et à l’ensemble des normes qu’imposent les commissions ; de l’autre, à l’état de saturation du marché, les écrans hexagonaux devant recevoir entre quinze ou vingt sorties hebdomadaires. Tourner un (premier) film est donc toujours possible, voire même encouragé sous certaines conditions. Le distribuer est plus délicat. Dès lors, ce problème affecte aussi la réception critique. Dans un tel contexte, le “premier film” devient cet enfant fragile, trop longtemps resté dans la couveuse des festivals, qu’il faut à tout prix protéger de la violence du marché. Le double saut, du court au long, et du circuit festivalier à celui des salles, est si périlleux que, par complaisance, lâcheté, prudence ou commisération, la critique préfère alors abdiquer toute exigence. Des films (au mieux) anecdotiques se trouvent portés par un enthousiasme souvent difficile à comprendre – citons aussi bien Vandal, La Bataille de Solférino, Les Combattants, Artémis, coeur d’artichaut, Les Rencontres d’après minuit que Vincent n’a pas d’écailles. Sans se risquer là encore à un état des lieux trop péremptoire, il est possible d’avancer quelques facteurs : le mythe de la Nouvelle Vague, le désir critique bien légitime de défendre et d’accompagner chaque bourgeonnement, les effets de promiscuité générés par les innombrables festivals, la qualité souvent médiocre de ceux-ci qui produit, par comparaison, un enthousiasme excessif face à la moindre lueur de singularité. A cela, il faudra encore ajouter une mythification stérile de la jeunesse, qui s’étale en particulier à longueur de numéros dans les Cahiers du Cinéma. D’une intention louable naît un résultat désastreux, puisque c’est la légitimité, et surtout la fonction de la critique, qui s’épuisent ainsi à tout défendre du JCF. Il ne faudrait pas oublier ce qu’André Bazin écrivait en 1958 : “la principale satisfaction que me donne ce métier réside dans sa quasi-inutilité.”[11] [11] Dans “Réflexions sur la critique”, texte repris dans Le cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague, Cahiers du Cinéma, Paris, 1998. Qu’entendre là ? Peut-être qu’il faut cesser de limiter l’horizon d’un texte au fait de vouloir convaincre une poignée de personnes, de moins en moins bien disposées, d’aller voir des films traversés par aucun désir, aucune invention, sous le prétexte de les défendre. La critique est moins un art de la prescription, que de la description – des manières dont chaque oeuvre se constitue et travaille au sein du présent, et dans l’histoire. L’exercice est délicat, qui consiste à suspendre (ne serait-ce que d’une phrase) le temps du jugement, sans pour autant se faire examen clinique, désaffecté. La critique ne prescrit que le cinéma à venir – ou plutôt l’appelle, depuis les lueurs ou les éblouissements actuels qu’elle perçoit. Cessant de se croire utile, elle devient nécessaire. Mais arrêtons là cet interminable préambule.
Comme La Dame au chien, court-métrage de 2010 présenté en ouverture de séance, Un jeune poète met en scène Rémi Taffanel, échalas d’une petite vingtaine d’années que Damien Manivel fait ici déambuler un carnet à la main dans les rues de Sète. Le premier plan pourrait bien avoir vocation de programme, si le film s’attachait à en déployer les virtualités plutôt qu’à le répéter sans fin. Tandis que deux autochtones discutent, assis sur le châssis d’une fenêtre, Rémi déboule du hors-champ non sans s’être auparavant accroché les tongs à une plaque d’égout. Maladresse, surgissement, désir de passer outre toute séparation d’avec l’autre – matérialisée en l’occurrence par un piquet qui coupe le plan en son centre. Légère bizarrerie, aussi, tant dans l’allure que dans l’élocution ou le propos, de ce jeune poète qui demande, sans autre forme de procès, où se trouve le cimetière. Par bien des aspects, Manivel semble viser à un cinéma de la rencontre. Figure par avance chargée d’imaginaire, le jeune poète est un vecteur ou un aimant, un appât jeté dans les eaux du réel. Le tournage n’avait d’ailleurs pas d’autre méthode que de susciter à partir des déambulations de Rémi des points de cristallisation, des départs de fiction[22] [22] Je renvoie à l’entretien avec le cinéaste mené par Arnaud Hée pour Critikat. . Ainsi, l’un des autochtones, à qui n’était promis nulle autre scène que la première, est-il devenu en cours de route un personnage récurrent. Ce principe de capitalisation du hasard a son revers dans ces rencontres sans suite, au résultat neutre ou insignifiant – comme lorsque le poète s’assoit à côté d’un pêcheur, qui finit par évoquer brièvement le manque de poissons.
Là se situe à la fois la particularité et la limite du film. Le poète aurait pu être un personnage-vérité, au sens où Jean Rouch parlait de cinéma-vérité à propos notamment de Chronique d’un été. Ainsi se serait-il effacé de la situation créée par sa présence pour la laisser, incontrôlable, suivre son cours, ou l’aurait-il au contraire intensifiée en relançant les dés, en lui injectant de son énergie. Cela, Manivel ne semble pas le souhaiter. D’une part, sans doute, parce qu’il cherche une sorte de comique à froid. Il consiste en un léger décalage du corps de Rémi, une manière de le présenter comme jamais tout à fait adapté à son environnement. Au premier rang d’un spectacle de danse, il dépasse la foule d’une tête ; marchant en claquettes dans la rue ou sur les chemins escarpés bordant la ville, il ne manque jamais de trébucher – il semble même s’évertuer à cela, comme lorsqu’il choisit de s’avancer sur le plan le plus incliné de la berge. Dans Jauja, les bottes trop lourdes de Mortensen, comme un signe soudain malvenu de son prestige social et culturel, plaçaient aussi constamment le personnage au bord de la chute. Mais Alonso visait, par l’épuisement, à une expérience d’estrangement ; c’est ici une affaire plus modeste, et quelque peu répétitive, de maladresse. Etranger, Rémi l’est en réalité d’emblée, et il le restera. Ce n’est pas une goutte d’agent révélateur, mais d’huile. Il glisse, et ne se mêle pas à l’eau.
Alors que Rémi est installé dans l’embrasure de fenêtre d’une maison en construction, la jeune fille qu’il passera son temps à chercher lui demande, surprise de le trouver en pareil endroit : « Qu’est-ce tu fais là, perché ? ». Rémi est « perché », oui, et c’est bien toute la lourdeur d’une mise en scène qui se veut économique que de consacrer un plan à cette réplique, la laissant en outre résonner comme si son double-sens n’était pas transparent. Rémi, c’est-à-dire à la fois l’acteur et le personnage. Là encore, Manivel joue moins avec les clichés qu’il ne les embrasse paresseusement. Choisi pour sa manière d’ « être au monde », Taffanel ne peut évidemment être que poète, soit une figure communément définie comme lunaire – Enzo le marin-pêcheur, homme du peuple au solide bon sens et à l’humour graveleux, et la muse toujours en fuite, sont d’ailleurs aussi pris dans les rets du poncif, comme si même du réel, Manivel n’avait réussi à extraire que le plus attendu. C’est la grande naïveté du cinéaste, que d’avoir cru qu’il fallait redoubler le personnage par l’acteur, ou l’acteur par le personnage. Le burlesque, c’est justement la contrainte et les débordements qu’elle provoque, le personnage qui tente par tous les moyens de s’adapter à la situation à travers le corps élastique de l’acteur – Charlot essayant d’être un bon ouvrier et se retrouvant dans les rouages de la machine, Hulot essayant de filer à toute allure sur son vélo malgré sa distraction. À trop coïncider, Rémi-Rémi s’annulent mutuellement, l’inspiration aléatoire du poète est rabattue sur le manque d’inventivité de l’acteur et la fiction, plutôt que de troubler le réel, s’écrase dans la littéralité ou la redondance. Pas de trouble, à peine un bégaiement – une simple et stricte répétition. N’ayant la plupart du temps rien à jouer, Taffanel se contente d’être, ou plutôt d’occuper le plan comme il peut – c’est-à-dire en débitant des banalités, ou en commentant le moindre évènement (« Oh, un oiseau vient de me frôler ! »).
L’échec du film tient de fait à son double-jeu d’adhérence et de détachement, de contact et de distance, sa petite ironie mal assumée qui lui permet de faire croire qu’il joue avec les clichés quand il leur laisse libre cours. Il faut le dire : rarement un acteur présent dans chaque plan aura été si peu aimé par la caméra. Non seulement Taffanel semble la plupart du temps livré à lui-même, oscillant entre la logorrhée (la visite au musée) et la phrase improvisée et bien vite suspendue, mais encore est-il toujours filmé à distance, en plan fixe, avec cette neutralité faussement bienveillante qui est en réalité une manière de lui retirer tout point d’appui. Cette distance de la caméra est associée à des effets de proximité sonore, produits à la fois par l’enregistrement du son direct grâce à des micros HF et par le mixage. Aucun battement d’ailes ne manque, aucun cri de mouette. Surtout, le spectateur ne perd rien des bégaiements, raclements de gorge, bruits de vomissure ou platitudes de Taffanel, même en plan d’ensemble. Position de malin, qui ne veut pas s’engager dans la situation, mais ne veut rien perdre non plus. Position de lâche, qui laisse à son jeune acteur la responsabilité de chaque rencontre et situation, alors même que le montage enchaîne les scènes sans relief, sans accroc. De ce point de vue, il n’y a guère qu’un plan à sauver (et il faut le sauver, car il est beau) : lorsque face à la tombe de Paul Valéry, Rémi est visité par le fantôme du poète, ou peut-être par un simple vieillard de passage. Pour la seule fois, grâce au visage mutique et ridé qui lui fait face, Rémi échappe à la sur-exposition littérale pour trouver son opacité de personnage – une réserve de mystère, une manière de se retirer au moment même où il semble le plus présent dans le plan.
Une chose est évidente : quand bien même Manivel échoue à filmer son jeune poète, il n’y a que lui qui l’intéresse. L’autre ne compte pas. Soit que la rencontre s’essouffle dans l’anecdote, soit qu’elle n’a d’autre effet que de valider le dispositif de création de la fiction. Dans un bar, le poète s’essaiera à rimailler pour satisfaire des femmes plus âgées, avant de se retrouver avec elles sur la piste de danse. La scène n’est rien de plus qu’un test : les clients mettent Rémi à l’épreuve pour vérifier qu’il est bien poète. Pour ce faire, il doit traduire avec des métaphores quelques phrases ordinaires. La question de la poésie s’arrête là. Surtout, à ne se concentrer que sur la « validation » du poète, la séquence finit par faire le même usage de la caméra et du personnage qu’un numéro de « Surprise sur prise ! ». On pourrait supposer que ce qui intéresse Manivel, comme d’ailleurs dans La Dame au chien, c’est la rencontre ratée, le rapprochement esquissé, l’errance et l’indétermination, le malentendu ou le dialogue sans horizon. Ou, pour le dire autrement, la rencontre en tant qu’elle ne peut qu’échouer – lorsque Rémi essaie d’embrasser sa muse, il en fait trop et la perd définitivement. Mais le problème vient bien de là : les rencontres sont moins ratées qu’inexistantes, sans joie ni douleur sensibles, parce que les rencontres entre l’acteur et son personnage, le cinéaste et les situations, le film et l’autre, auront par prudence, maladresse ou volonté, en tout point échoué. À la fin, il ne reste donc au cinéaste que son acteur. Les intertitres, qui annonçaient la fiction, se muent alors en lignes de dialogue. Rémi fixe la caméra. Le film parle à son personnage, le réalisateur à son acteur. Le constat d’échec du poète a pour miroir la réussite du film. Le film aura bien raconté, d’une certaine manière, l’histoire de son tournage. Mais faute de transitivité, rien d’autre, rien de plus. Cette accumulation vaine de prises de vue peut s’achever dans un pur solipsisme. Pour qui croirait encore que la Jeunesse est une bénédiction en soi, il faudra bien l’admettre : un jeune cinéaste n’a pas besoin d’Assayas pour faire des films sans vie, sans ouverture, sans désir de créer du commun.
Scénario : Damien Manivel, avec Isabel Pagliai et Suzana Pedro / Photographie : Isabel Pagliai et Julien Guillery / Montage : Suzana Pedro / Son : Jérôme Petit et Daniel Capeille / Mixage : Simon Apostolou
Durée : 71 mn
Sortie : 29 avril 2015