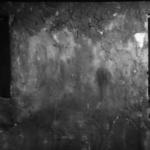Les anti-corps
Occurrences du corps classique chez Jean Genet, Rainer Werner Fassbinder et Gus Van Sant
S’il arrive parfois qu’un artiste pour faire une autre image
représente lui-même dans la pierre livide et cadavéreuse,
je fais souvent ainsi, moi qui suis tel par elle ;
et il semble que je prenne toujours mon image quand je pense faire la sienne.
Je pourrais bien dire que la pierre dont elle est le modèle lui ressemble ;
mais je ne saurais jamais sculpter autre chose que mes membres affligés.
Michel-Ange, Madrigal XXI.
Les liens factuels entre Jean Genet, Rainer Werner Fassbinder et Gus Van Sant sont connus. En 1982, Fassbinder adapte Querelle de Brest de Jean Genet ; en 1991, faisant appel à Udo Kier pour jouer dans My Own Private Idaho, Gus Van Sant fait revenir dans son cinéma certaines des scènes les plus fascinantes de l’œuvre de Fassbinder, non pas seulement les moments de drague homosexuelle et de prostitution mais les séquences de danse et de music-hall qui, chaque fois, transformaient le corps en pure énigme à proportion même de son immersion dans la lumière et les apparences.
Parmi d’autres, un problème commun semble déterminer de telles rencontres et filiations : celui de l’apparition et de l’usage d’un corps classique dans le contexte de cinématographies modernes. Que signifie, pour ces écritures réfractaires et polémiques, le recours soudain à une figure masculine qui renvoie immédiatement à Phidias, Praxitèle ou Michel-Ange ? S’agit-il d’une simple iconographie érotique, s’agit-il de laisser place à une figure du corps perdu, de la beauté idéale disparue, s’agit-il d’un jeu avec la convention néoclassique, à la manière de Roland Barthes choisissant l’Endymion de Girodet pour couverture d’une réédition de S/Z ?
Tout cela et bien plus : l’occurrence d’une anatomie attique chez Genet, Fassbinder et Van Sant est, profondément, une figure de l’ouverture du corps à l’image. D’une part bien sûr, parce que le corps idéal est une image in se ou, comme l’écrivait Winckelmann résumant la tradition, une beauté produite « par des images que trace le seul entendement [11][11] J. – J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture, 1755, tr. Léon Mis, Paris, Aubier-Montaigne, 1954, p. 99. Sur les différentes valeurs symboliques à l’œuvre dans la représentation du nu chez Michel-Ange, cf Max Dvorák, « Greco et le maniérisme », 1924, tr. Bertrand Badiou, in Avant-guerre, Sur l’art, etc, n°1, 2° trimestre 1980, p. 64. ». D’autre part et surtout, parce que la présence d’une belle anatomie s’avère dans les trois cas l’occasion et la radicalisation d’un renversement. Panofsky a montré comment la théorie des proportions corporelles révélait, dans l’histoire des styles, l’organisation des rapports entre l’anatomie, l’espace et le monde intellectuel. Les normes concernant l’homo bene figuratus (Vitruve) résument et affermissent l’ensemble des liens qui unissent l’homme et le système symbolique propre à une civilisation[22][22] Erwin Panofsky, « L’évolution d’un schème structural. L’histoire de la théorie des proportions humaines conçue comme un miroir de l’histoire des styles », 1955, in L’œuvre d’art et ses significations, tr. Marthe et Bernard Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1982, p. 54-99.. Dans le cas des films qui nous occupent, le retour de la belle forme corporelle conserve une fonction euristique : son apparition permet d’observer l’organisation, à l’échelle plus modeste d’un film ou d’une œuvre, des rapports entre le corps et l’image. Le corps classique n’ouvre plus sur un extérieur, l’espace concret et l’univers symbolique, mais sur un monde intérieur, celui des images mentales, des rêves, des souvenirs et des affects.
Le problème ici abordé est donc extrêmement vaste ; pourtant, nous l’élaborons à partir de trois occurrences précises. Celle du prisonnier nu de Un chant d’amour (Jean Genet, 1950) qui reproduit fidèlement la pose de l’Esclave mourant de Michel-Ange. Celle, tout aussi anonyme, du giton de Max (Karlheinz Böhm) dans la séquence des Thermes de Faustrecht der Freiheit (le Droit du plus fort, R. W. Fassbinder, 1974). Celle, démultipliée, des cover boys de magazines érotiques dans My Own Private Idaho (1991). Trois plans de nus : unique, travesti et monumental chez Genet ; contradictoire et critique chez Fassbinder (le contour corporel classique du giton s’oppose au corps problématique de Fox, interprété par Fassbinder lui-même) ; multiples, bariolés, factices et euphoriques chez Gus Van Sant. Trois plans bien différents plastiquement, mais qui réengagent de la même façon sur le terrain le plus traditionnel qui soit — le nu —, la question du corps. Que, pour rendre vraiment compte de ces plans, il faille décrire l’ensemble d’une économie figurative, donne une indication sur la nature nécessairement relationnelle du corps au cinéma : il n’y a de corps que tressé de liens ou couturé de faux raccords avec d’autres physiologies, avec d’autres modèles, avec ses propres parties ou son mouvement singulier.
Exhaustion de l’apparaître, érotique de la disparition
Jean Genet, Un Chant d’amour
Un chant d’amour relève de principes éminemment classiques de création, principes prolongés jusqu’au renversement. Le premier, critère crucial pour Cicéron par exemple, concerne l’unité de la composition, unité ici garantie et soulignée par le caractère apparent de la construction (mesure ternaire, rythme en leitmotiv, effets de symétrie…). Mais l’unité s’achève et s’intensifie au moyen d’un travail spécifique sur la clôture : clôture iconographique et narrative (la guirlande est saisie, le gardien repart) mais surtout fusion des trois régimes d’image qui structurent le film. On se souvient qu’Un Chant d’amour entrelace trois types de plans : plans intérieurs réalistes du réel carcéral, plans extérieurs agrestes du rêve du prisonnier, plans délocalisés et abstraits du fantasme du gardien. Or, ces trois plastiques soigneusement différenciées fusionnent à la faveur d’une crise de montage, le passage mystérieux du prisonnier âgé dans le fantasme du gardien lors de la scène du revolver. En principe, le gardien n’était plus dans la cellule du prisonnier ; et le prisonnier ne faisait pas partie de son rêve. Mais leur réunion dans un même champ permet aux trois circuits de plans de se confondre et de donner lieu à un dernier état de l’image, simultanément externe et mentale, subjective (point de vue dominant du gardien) et objective (seul le circuit d’ensemble autorise l’advenue de ce plan), carcérale et libre, semi-réaliste (intérieur cellule, modelé des corps) et semi-abstraite (effacement du fond, accentuation des contours anatomiques comme dans les fantasmes du gardien). Or, cette image traite d’un événement qui contredit les autres plans, le mouvement lent de l’expulsion d’un corps, pénétré par la bouche, hors du cadre. Se parachève ainsi le procès figuratif du film, c’est-à-dire les modes d’apparition du corps au plan de l’image, par la description complémentaire d’un repli qui devient le lieu radical de l’érotisation. Dans ce transfert, la miraculeuse, transgressive et précaire co-présence de deux corps dans un même champ, se dévoile la communauté de désirs entre victime et bourreau ; ce qui, précisément, deviendra inadmissible pour le Genet militant qui reniera son film : pareille élaboration en effet assure qu’Un chant d’amour n’est pas un film politique. Mais dans la complexité figurative mise au service de l’émergence de cette image, aussi abjecte que sublime, s’annoncent les recherches cinématographiques ultérieures de Fassbinder ou Van Sant sur les propriétés abstraites des images figuratives.
Le deuxième principe classique auquel obéit Un chant d’amour est celui de la varietas. Il concerne la variété des régimes d’image, différenciées tout à la fois du point de vue de leur origine subjective et de leurs caractères plastiques (images modelées à motifs simples pour la prison, images planes réduisant le motif à son contour pour les fantasmes du gardien, images à profondeur de champ accentuée jusqu’à la déformation anatomique et restitution des détails pour le rêve du prisonnier). Or, cette variété à trois termes est intensifiée et diversifiée par la recherche sur le sculptural dans le traitement visuel du corps. Au registre du sculptural, on trouvera le travail du relief, effets volumétriques particuliers dus à la lumière, détourage de la figure sur le fond des murs de la cellule (par exemple à la faveur des danses et tournoiements) ; la monumentalisation du rebut, poussière, mie de pain, celle de l’impondérable et du frémissement (les narines ou la glotte de Lucien, le jeune prisonnier) ; les effets de découpe violente qui fétichisent le fragment anatomique (pied, épaules, gorge…) et transforment la partie physique en étude anatomique. En ce sens, Genet récupère en cinéma les valeurs classiques de la sculpture devenues inopérantes dans le champ de la statuaire contemporaine du film : que l’on songe, par exemple, au travail d’Alberto Giacometti, auteur d’un portrait de Jean Genet en 1955. Ces procédés plastiques convergent vers le même effet : la variété classique devient récupération du divers, intégration au champ des belles formes des plus humbles rebuts de la représentation.
Le troisième principe est celui de la reprise et du remploi, conçu classiquement sur le mode de l’attachement au modèle ou au schème iconographique. Ici, un tel principe s’avère dans la figuration néoclassique du corps, l’évidence du modèle attique et le privilège accordé à la posture, qui héroïse le mouvement et hiératise le geste. Mais ce principe se trouve intensifié par un effet de reprise si littérale qu’il devient dévoiement ludique : c’est le travestissement hilare de l’Esclave mourant de Michel-Ange en Prisonnier se savonnant et masturbant dans la cinquième cellule épiée par le gardien. Le pastiche n’attente pourtant pas au modèle : il assure, bien plutôt, qu’en tout corps on peut déceler la beauté d’un Praxitèle.
Optique et haptique, réaliste et fantasmatique, traité dans sa concrétude matérielle comme dans l’abstraction de son contour idéal, idole et blasphème visuel : Un chant d’amour entreprend ainsi de totaliser les modes d’apparition du corps dans le champ de la cinématographie. « Quand tu dessines un nu », prescrivait Léonard de Vinci, « aies soin de le faire tout entier.[33][33] Léonard de Vinci, Carnets, tr. Louise Servicen, Paris, Gallimard, p. 279. » Genet, lui, travaille sur l’entièreté des registres de la présence corporelle à l’écran, projet qui s’achève dans une érotisation intense de la disparition. Ici s’affirme le caractère expérimental d’Un chant d’amour, dans ce projet d’épuiser les propriétés de l’image cinématographique rapportée au désir figuratif.
Les allégories impures
Techniques de la dissonance selon Rainer Werner Fassbinder
Comme Jean Genet, Rainer Werner Fassbinder n’a cessé d’approfondir la notion de vie criminelle. En 1969, ses quatre premiers longs métrages balisent la question du crime, qui détermine et structure la représentation des corps.
L’amour est plus froid que la mort et Les dieux de la peste utilisent le gangstérisme sur le mode du répertoire iconographique et de la métaphore existentielle, à la manière de Melville et de Godard. Le Bouc inaugure les films sur l’exclusion où le crime ne relève plus de l’initiative privée mais de la société elle-même, coupable de bêtise et d’indifférence. Avec Pourquoi Monsieur R. est-il atteint de folie meurtrière ? commence le travail sur le crime dans l’État, qui associera de plus en plus étroitement terrorisme et terreur étatique, un problème politique traité frontalement dans La Troisième Génération. Intérêt particulier, société criminelle, état terroriste : comme chez Fritz Lang, il n’existe plus de différence entre la criminalité et l’ordre social[44][44] Sur ce point, voir Nicole Brenez, Symptôme, exhibition, angoisse. Représentation de la terreur dans l’œuvre allemande de Fritz Lang (1919-1933 / 1959-1960), texte publié dans Cinémathèque, n° 3, printemps-été 1993, puis repris dans De la figure en général et du Corps en particulier. L’invention figurative au cinéma, Collection Arts et Cinéma, Paris/Bruxelles, De Boeck Université, 1998. (NDLR), le travail de Fassbinder s’inscrit dans la grande tradition allemande de la critique de l’état et, dans son cas, de la démocratie. Dans les mêmes termes que Theodor Adorno[55][55] Cf. par exemple la conférence de 1959, « Que signifie : repenser le passé ? », in Modèles critiques, Paris, Payot, 1984 (pp. 97-112), où Adorno développe l’idée que « la survie du nazisme dans la démocratie présente plus de dangers potentiels que la survie des tendances fascistes dirigées contre la démocratie. », Fassbinder s’interroge sur une démocratie imposée et tout juste consentie, « donnée en cadeau » par l’Amérique après la guerre, masque nouveau d’un capitalisme supra-national qui s’accommode de n’importe quel régime politique. Survie du nazisme dans la démocratie autoritaire, faux-semblants progressistes (Lola, par exemple, est un manifeste contre « l’économie sociale de marché »), rôle idéologique de l’industrie culturelle : le travail de Fassbinder pourrait être résumé à l’aide du sous-titre des Minima Moralia d’Adorno, « Réflexions sur la vie mutilée ».
Position critique
Si, en tant qu’artiste, Fassbinder travaille volontiers dans le cadre de la télévision d’État ou de la production industrielle, c’est parce qu’on n’y verra jamais mieux, au cœur même d’un film, passer la ligne brisée des interdits ainsi que le travail des dissonances mises au point par l’auteur pour échapper aux formes de la critique intégrée (« les fictions de gauche », disait-on alors en France) comme à celle de la critique d’intégration. « Une sorte de critique immanente au système, qui rend triste et fait peur, a été élaborée par des artistes allemands.[66][66] « Le film allemand s’enrichit », avril 1977, in Les Films libèrent la tête, tr. Jean-François Poirier, Paris, éd. de L’Arche, 1989, p. 52. » Comment, à l’inverse, maintenir une forme à ce point exogène à l’idéologie qu’en toute ironie elle peut être produite à l’intérieur même de ce à quoi elle s’oppose, l’appareil culturel d’État ? Fassbinder a mis au point au moins trois techniques de la discorde, caractéristiques de son œuvre.
D’abord, la sprezzatura, auto-dépassement de la maîtrise par la désinvolture, une sûreté de ton et de fabrique qui tient ici sa légitimité de certains parti-pris politiques et dont la forme la plus avancée devient la possibilité d’exprimer un peu de doute à l’état pur, comme dans L’Allemagne en automne, commentaire charnel par Fassbinder des événements liés à la mort des membres de la Fraction Armée Rouge. Fermeté du geste artistique, rapidité d’exécution (jusqu’à sept films en une année, 1970), beautés imparables de l’imperfection : la sprezzatura contredit naturellement aux idéaux bourgeois du travail de l’art comme souffrance, achèvement du sens et accomplissement de soi.
La seconde dissension ne tient pas à la production mais à la fonction de l’œuvre. Travail critique, le film relève peu ou prou de la démonstration. Or, Fassbinder ne recule jamais devant les formes les plus élémentaires de la démonstrativité, pas plus qu’il ne triche face aux difficultés de l’argumentation : scénarios sans détours sur des situations sociales complexes (Tous les autres s’appellent Ali, le Droit du plus fort….), mises en scène complexes sur des moments historiques déjà jugés par l’Histoire (Lili Marleen), propositions violentes sur des consensus quasiment intouchables (par exemple, à propos des épisodes censurés de Huit heures ne font pas un jour : il s’agissait « d’expliquer aux téléspectateurs allemands que le syndicat n’est rien d’autre qu’un partenaire du patronat et du gouvernement »). L’une des occurrences les plus brillantes d’une telle crudité démonstrative, qui va à l’encontre de toutes les rhétoriques de connivence, se trouve dans Lola. « Notables. Spéculation. Magouille. Rapaces », note consciencieusement le héros, von Bohm (Armin Müller-Stahl), à l’écoute du discours que lui tient un opposant légaliste aux projets immobiliers typiques de la reconstruction sous Adenauer, tandis que la caméra filme ces quatre mots en très gros plan et que von Bohm les chuchote encore une fois pour ne pas oublier la leçon. « Notables. Spéculation. Magouille. Rapaces ». On ne saurait être plus direct, indécent d’immédiateté polémique.
Les personnages des films de Fassbinder ne sont donc pas des individus mais des figures logiques, emblèmes d’un problème social ou d’un trajet de l’histoire. Bien loin de chercher à accréditer leur existence singulière (solution du cinéma hollywoodien), Fassbinder en démultiplie les effets d’artefacts. D’abord, en rééditant toujours les mêmes figures. Effi, Maria Braun, la femme du chef de gare, la Karin de Petra von Kant, Lydia dans Despair… traversent chacune à leur manière l’épreuve de l’infidélité. Lola, Willie, Mieze, Fox, Joanna, les actrices de la Sainte putain… sont autant d’effigies de la prostitution, et celle-ci n’a rien à voir avec la déchéance, elle assure un passage entre les positions politiques, c’est-à-dire entre les intérêts de classe. Face à ces personnages, l’Anton Seitz de L’année des treize lunes ou le Schukert de Lola objectivent, sur un mode burlesque (Anton) ou comique (Schukert), l’intégralité du mal économique, ils sont à la fois industriel, promoteur, force politique occulte, patron de bordel, chef de camp de concentration (modèle de gestion allemande). L’ancrage autobiographique de tels personnages (le père de Fassbinder louait des chambres à des travailleurs immigrés) n’en compense pas la démonstrativité, au contraire, c’est comme si la touche existentielle venait confirmer et parachever la synthèse figurative. L’existence de l’auteur s’ordonne à l’Histoire, la figure n’en devient pas plus vraie mais plus exacte .
Déréalisation des corps
Fassbinder a développé successivement trois sortes d’effets d’artifice : sous l’influence de Straub et de Godard, la stylisation plastique, qui règne sur L’amour est plus froid que la mort et fait retour dans Effi Briest ; la démonstrativité narrative propre aux chefs-d’œuvre sociologiques (le Droit du plus fort, Tous les autres s’appellent Ali, Huit heures ne font pas un jour…) ; et l’emphatisation scénographique, qui déréalise les personnages et sature les relations entre les corps (Prenez garde à la sainte putain, Les larmes amères de Petra von Kant, Despair, Querelle…). Ces trois solutions se superposent avec force dans Lili Marleen, la superproduction underground, où s’élaborent à vue les règles de fonctionnement de l’allégorie si caractéristique de Fassbinder.
Comme Fox entre les classes ou Elvira entre les sexes, Willie est une figure de passage mais elle en radicalise la nature : le passage n’est ni franchissement ni parcours, c’est un tournoiement sans fin, une oscillation sur soi-même vouée à l’échec ; cependant, au contraire de Fox ou Elvira, Willie ne meurt pas d’un tel vertige parce que, sur un mode logique et non plus narratif, elle en épuise le concept. Ce qui disparaît en fin de film n’est pas le personnage mais ce qui l’anime, c’est-à-dire la puissance d’allégorisation : car Fassbinder, au rebours de la tradition iconographique, n’allégorise pas des entités mais des questions.
Comment un peuple peut-il être fasciste, comment le peuple allemand, contre tout intérêt vital, s’est-il livré au nazisme ? « Lili Marleen », la chanson de Lale Andersen, représente une réponse. Elle est un pur point de confusion, le passage saisi au principe même de son efficacité, là où les phénomènes basculent, versent dans leur autre : le point critique, aurait dit Godard. Elle se confond d’abord avec son interprète, Willie (Hannah Schygulla), qui signe du titre de sa chanson les photos que ses admirateurs lui tendent et que tout le monde appelle Lili Marleen. Elle relie le corps et le refrain, le front et l’arrière, l’Allemand et l’ennemi (l’accompagnateur de Willie entraîne son escadron à la mort en entendant sa chanson, que des Russes écoutaient), l’arrêt et la reprise des combats, la parenthèse et la continuité, la scénographie du music-hall fasciste en intérieur-stade et l’iconographie onirique des combats en extérieurs-studio. La figure de Lili Marleen comble l’intervalle entre le peuple et les dignitaires nazis, entre les auditeurs (« 6 millions de soldats allemands ») et les victimes (6 millions de Juifs), entre les musiques juives interdites qu’elle remplace et l’interdit auquel à son tour elle est soumise, entre la collaboration populaire avec le nazisme et la Résistance (Willie commence la lutte au moment où son amant, le résistant Robert Mendelsohn, est arrêté), entre le repos du guerrier et son supplice (Robert forcé d’écouter un extrait de « Lili Marleen » en boucle pendant des jours et des nuits), entre l’insignifiance de la complainte et la violence historique (lors de sa modeste première à Munich,« Lili Marleen » déchaîne une rixe entre les Anglais qui exigent de l’écouter et les soldats nazis qui la méprisent). Exactement comme le couple paradigmatique de Marianne et Ferdinand dans Pierrot le fou, Willie représente la culture populaire et le mal, Robert l’art classique et le bien : ils s’aiment passionnément et ils ne peuvent pas vivre ensemble, ils peuvent faire la même chose mais jamais au même moment. C’est ici que la question se pose avec précision, c’est-à-dire, chez Fassbinder, de façon pratique : le nazisme n’a pas eu la possibilité d’anéantir ses vedettes populaires (Henkel, le sous-secrétaire nazi à la Culture, ne peut supprimer Lili Marleen) ; pourquoi le peuple allemand n’a-t-il pas défendu ses grands musiciens, ses écrivains, et les valeurs qui accompagnent la liberté d’expression, puisqu’il en gardait la puissance ? Lorsque, revenue de la résistance, revenue du soupçon, de l’anéantissement politique, du suicide, Lili Marleen blême et transparente vient chanter pour la 212e fois dans le Palais des Sports lors de la grand-messe hitlérienne, c’est l’Histoire effective qui s’avance sur la scène, définitivement mauvaise, absolument ignorante d’elle-même : elle sait tout (elle a transporté le film sur les camps d’extermination) mais elle n’a rien appris, elle est condamnée à la répétition, non pas à l’Éternel retour mais à la ritournelle.
Le corps contre l’identité
Lili Marleen entre nazisme et résistance. Lola entre les trois pouvoirs (le promoteur, le fonctionnaire et le militant, qui échangent souvent leurs places). Elvira entre Anton Seitz (le capital), sa famille (la bourgeoisie) et la prostitution (Zora-la-rouge, le sous-prolétariat). Maria Braun entre les deux versions du sentiment de culpabilité, Oswald (l’exil) et Hermann (l’expiation) : ces figures logiques n’existent presque pas, elles condensent et intensifient une abstraction. De tels films s’affilient à un genre hollywoodien majeur, le Woman’s Film (John M. Stahl, Sternberg, Clarence Brown ou Cukor), dont Fassbinder, à la suite de Douglas Sirk, développe le potentiel problématique et dénude le fonctionnement en réduisant ses héroïnes à de purs opérateurs de conflits. Pourtant, elles consistent tout de même : en tant qu’elles se dérobent à l’identité, là où il reste une marge pour l’indéterminé. C’est ici que le cinéma n’est plus seulement illustration ironique ou approfondissement critique, mais qu’il fait retour sur l’Histoire, en proposant d’autres rapports entre la personne et l’identité, d’autres sujets, d’autres corps.
L’économie du nom, chez Fassbinder, annonce cette aspiration à un divers qui ne permettrait plus la totalisation, cette aspiration à l’irrécupérable. Fox/Franz : d’un monde à l’autre, du cirque à la bourgeoisie, le protagoniste du Droit du plus fort change de nom et en change encore au gré de ses interlocuteurs. Erwin/Elvira : d’un sexe à l’autre, la figure des Treize lunes tournoie sans repos entre son enfance affreuse et son absence de présent. Lili, Marleen, ce sont deux prénoms, deux femmes que le compositeur de la chanson aurait aimées : deux prénoms qui en recouvrent un troisième, Willie. Ici Fassbinder invente une autre solution, plus complexe qu’un dédoublement de nom, pour marquer la plasticité des corps : la chanson ne cesse de changer, d’humble chansonnette, elle devient rengaine, chant, hymne, scie (lorsqu’elle sert d’instrument de torture), monument ; l’interprète, elle, ne change jamais, elle reste toujours tout à la fois, Willie, Lili et Marleen, l’alliée objective de la catastrophe historique et la bonne volonté individuelle qui, au même moment, contredit faiblement l’horreur. Les entrelacements sonores de Peer Raben la dissipe dans toutes sortes d’autres musiques, tandis qu’elle-même recouvre le son, c’est-à-dire le fracas des combats : parce qu’elle est intotalisable, l’héroïne c’est la chanson (d’ailleurs communément rapportée à la résistante Marlene Dietrich), Willie n’en constitue qu’un moment, le support provisoire et sans puissance.
Vertus théoriques de l’homosexualité
Plus profondément, certains films scénarisent la façon dont les désirs du corps pulvérisent les intérêts de classe voire les exigences de la survie. Les larmes amères de Petra von Kant et le Droit du plus fort, diptyque sur le couple homosexuel, l’un masculin l’autre féminin, décrivent la même chose : la domestication d’un corps par l’amour. Chez Fassbinder, le sentiment est une force mauvaise, il livre l’individu, pieds et poings liés, à l’exploitation : voir les chaînes qui ligotent Petra dans sa robe, les bracelets et colliers qui scellent Karin à sa panoplie d’esclave. Mais, au-delà des choix stylistiques opposés (théâtralisation intemporelle pour le supplice affectif de Petra, réalisme contemporain pour le calvaire sentimental de Fox), d’un film à l’autre le traitement figuratif s’inverse. Dans Petra von Kant règne une logique d’épuisement du même. Sur le modèle de The Women de Cukor, hormis une immense reproduction de Poussin qui remet au fond du champ un sexe masculin à la manière d’un point d’exclamation autour duquel tourne la scénographie, ici, apparemment, il n’y a que des femmes. Les six personnages, Petra, Karin, Marlene, l’amie, la mère et la fille se croisent, échangent leurs positions, leurs perruques, empruntent des trajets symétriques et trouvent des poses similaires pour attester leur appartenance commune à une figure primordiale, celle du mannequin. Cernées par ces silhouettes cadavériques de plastique blanc, appuyées encore sur une multiciplité de figurines — l’esquisse, la poupée, la photographie — les femmes chacune à leur tour retournent au mannequin en passant par le geste ou la couleur. Le mannequin, sorte de squelette affectif, objective leur désir dément de réification, désir que la secrétaire masochiste réussit à élever au statut de mode existentiel. Ainsi, il n’y a que des femmes mais rien de féminin : au fond de n’importe quelle créature (et le Bacchus et Midas, bien sûr, reconvertit en garçons les filles transparentes qui passent devant lui), on peut déceler ce fantôme blanchâtre, la passion de l’assujettissement. Le reste, l’enveloppe, est accessoire, panoplie, cosmétique. Le jeu de Margit Cartensen, qui s’éveille en corps sans chair et encore privé d’apparence, agit en silhouette impériale et se recouche deux heures plus tard en spectre délaissé, invente avec génie la corporalité nécessaire à l’élaboration d’une telle effigie intérieure.
Eugen (Peter Chatel) à Fox (R. W. Fassbinder) : « On verra qui de nous deux est ‘elle’, chérie ». Chez Fassbinder, l’homosexualité acquiert un statut théorique : avec elle, grâce à elle, à chaque nouvelle rencontre, toutes les relations restent à définir. Genre, statut sexuel, rapports de force, rôle économique et place dans la famille, rien n’est encore établi en avant de la rencontre singulière, qui de ce fait retrouve un caractère d’événement (Pasolini en avait déployé la force métaphysique dans Théorème). Démuni, trop riche, irrésistible et grotesque, subtil et vulgaire, dominant puis dominé (comme la protagoniste de Martha), tantôt Fox et tantôt Franz, « tête qui parle » sans corps et inusables bras d’ouvrier, voyou invétéré et aspirant à la bourgeoisie, le personnage joué par Fassbinder dans le Droit du plus fort endosse toutes les antinomies, jusqu’au suicide. Cette fois, la figure meurt de trop de diversité. Une scène anthologique aux Thermes, dans les bains de boue, observe la contradiction sur le terrain de l’anatomie. Franz confronte sa nudité à celle d’un giton néoclassique, sous le regard intéressé de Max, son premier amant bourgeois. Qu’est-ce qui est beau ? Franz est-il « juste bien », comme il l’affirme lui-même, ou trop gros, trop mou, toujours au seuil d’un informe que la représentation classique voue, au mieux, au grotesque et, au pire, aux ténèbres de l’interdit figuratif ? Qu’est-ce qui est désirable ? Il faut choisir, dans le face à face, qui des deux représente le contre-modèle. Le nu expérimental mis en scène par Fassbinder nous renvoie aux propriétés problématiques du corps, principal bien que transgressif, inédit parce qu’évident.
Alors, en-deçà du feuilletage social que représente Fox, la figure des Treize lunes prend le relais et permet de poser la question ultime : qu’est-ce qu’un corps ? qu’est-ce qu’un sexe ? Erwin/Elvira (Volker Spengler) est une ahurissante fragmentation sexuelle, le masculin et le féminin alternent sur tous les sites du corps, dessus contre dessous, le haut en dépit du bas, de dos, de face, jusqu’à la triple surimpression finale : un ex-homme, mué en femme, se déguise en homme pour rejoindre sa femme. « Elvira ! tu es devenue folle ? » Son crâne éclate de terreur, elle a des tuyaux bouchés dans la tête, pauvre “viande gonflée” complètement aliénée par la demande d’amour, Elvira l’ancien boucher est un massacre de chair, elle est n’importe laquelle de ces vaches égorgées qui pendent dans l’abattoir où elle raconte sa vie en hurlant comme Peter Lorre à la fin de M. le Maudit. Et pourtant, parce qu’elle est un véritable chantier humain, aucune figure ne semble plus étroitement liée à l’entreprise même de Fassbinder. Le geste artistique consiste à repartir du lien social primaire, la peur, qui tord affreusement les visages (Franz Biberkopf sortant de prison au début de Berlin Alexanderplatz, Veronika Voss, Martha ou Effi Briest), en pétrir la figure et, à partir de cette effectivité anthropologique à laquelle l’analyse de l’histoire des hommes exige de conclure, à partir de ce réel enfin dévisagé, recommencer le corps, quitte à ne pas pouvoir aller au-delà de la destruction.
Au-delà du négatif
Gus Van Sant, My Own Private Idaho
En changeant, il se repose.
Héraclite.
Punctum caecum
Sur la route, il est seul, il ne fait rien, il tousse, se tourne et retourne, le havresac s’effondre, effet très spécial : pour montrer ce rien, l’impondérable montée du mal, il faut à Gus Van Sant un, deux, trois, beaucoup de plans et surtout plusieurs raccords. La générosité de l’insistance descriptive, l’élégance du montage bouleversent, mais qu’est-ce qui est décrit ? Pas le mouvement du corps, soigneusement tenu à l’écart de toute expressivité, pas encore le pays, l’effet de portrait est trop puissant, ni la maladie, traitée un peu plus tard ; peut-être le désir descriptif lui-même, ici raconté dans ses puissances sensibles. Et ce qu’il convient de décrire, selon l’ouverture de My Own Private Idaho, concerne le débordement irrésistible du corps humain par ce qui le hante, le traverse en le laissant faible, désemparé et heureux (en-deçà de la douleur) : une nature cosmique en chaque plan, qu’elle advienne comme ciel, plaine, route ou bien champ, un paysage naturellement vierge et absolument confondu avec l’image, avec ce que c’est qu’une image ou au moins, ce qui en elle importe.
Les eaux coulent et en elles vacillent et vibrent l’image des choses.
Ce paysage serein et dévorant n’équivaut pas à une image intérieure ; dire qu’il est paysage mental, c’est le réduire a minima, le soustraire à son génie propre qui consiste à ravager la représentation, en commençant bien sûr par le lieu le plus sensible : le point de vue.
L’air, dès que point le jour, est rempli d’innombrables images auxquelles l’œil sert d’aimant.
Depuis l’œil aimant de Léonard, une moitié d’orbe a été parcourue, My Own Private Idaho commence sur le contre-champ, à présent en tous ses sites la nature ouvre un œil, une phénoménalité susceptible d’absorber l’esprit juvénile incapable de se supporter. Mike voit le visage de la route, un paysage plissé par le sourire et nous, nous voyons le punctum caecum, le point de cécité que Mike représente. Comme le prévoyait Merleau-Ponty : Faire une psychanalyse de la Nature. Il n’existe au monde plus d’autre sujet.
La capacité d’évanouissement de Mike (River Phoenix), sous le nom de narcolepsie, manifeste quelque chose de l’imperception dans la perception, de la non-vision dans la vision, qui conditionne l’appréhension des choses et surtout détermine la question de l’image : ici, l’image est rarement ce que l’on voit mais presque toujours ce qui affecte. Elle abat, elle fait rire, elle stupéfie, elle ordonne : elle touche, bien plutôt qu’elle ne montre. Sous forme de rêve, de souvenirs, d’hallucinations ; sous forme de virtualités, d’interprétations, de puissances ; sous forme de tableaux (vivants et morts), de chansons, de récits proférés ou mimés ; sous forme de citations, de collages et de déchirures, il n’est question que d’affects de vision.
Ce qui vaut pour les personnages délirants et charmants de My Own Private Idaho vaut aussi bien pour nous : à la faveur d’un geste final de Mike (accompagné de son premier sourire), un bras replié derrière la tête, un bras tendu vers la butte où l’on enterre le père de Scott — et de fait, tendu vers nous, nous reconnaissons l’un des gestes d’acteur les plus fameux qui soit, celui de James Dean dans Rebel Without a Cause, geste de malédiction en même temps que de demande, devenu la posture américaine par excellence. David Lynch dans Wild at Heart venait de l’attribuer à Nicolas Cage. Mais où Lynch place le geste américain à l’orée de son film pour évider la figure en la subordonnant au cliché, Gus Van Sant le fait affleurer très fugitivement en fin de parcours, ramenant au visible une image que, depuis le début du film, nous avions sous les yeux.
De même que Jean-Luc Godard dans Grandeur et Décadence d’un petit commerce de cinéma avait choisi de faire tomber sur une photographie de James Dean la chute terrible et inattendue d’une phrase de Faulkner jusqu’alors fragmentée, désordonnée par une longue théorie de figurants – l’angoisse, et la douleur, et l’inhumanité de la race humaine – de même pour Gus Van Sant la forme profilée de l’acteur protège les morts contre les vivants, protège l’aura de ce qui a disparu (la mère, l’enfance, Bob Pigeon, l’amour, la maison) contre l’insoutenable clarté du visible : exemplairement, la lampe dont se sert Udo Kier pour s’éclairer lui-même, menant Mike au bord du malaise, et qui reprend sur un mode adouci le grotesque microphone–projecteur de Dean Stockwell dans Blue Velvet. Nous aussi nous sommes soumis au régime de l’hallucination, plongés dans des images que nous ne savions pas voir, reconnaissant des figures que nous n’avons pas vraiment vues, émus aux larmes par des ellipses que nous ne vivrons jamais.
La matière de My Own Private Idaho, c’est une économie des images qui, à quelques êtres démunis, tendres et politiques, fait hommage de leur fragilité.
Le peigne de Léonard
Dans My Own Private Idaho, l’image se fait ultra-figurative : d’abord parce qu’elle ne cesse de varier, convoque les schèmes figuratifs les plus anciens (les piétas), les plus antiques, les plus camp (couvertures des magazines) pour renouveler en chaque occurrence le traitement du motif ; le corps masculin, de se voir recommencé par cette diversité euphorique, en redevient inépuisable. Confrontées les unes aux autres, ces images plastiques avouent et développent leur plasticité même : elles sont les éclats miroitants d’un grand modèle qui les a toutes générées et en supportera bien d’autres, de Michel-Ange à Honcho et jusqu’à cette silhouette déformée qui s’éloigne en dansant sur un mur.
À moins de cette invention, de cette efflorescence, ne s’esquisserait pas la première des propriétés corporelles selon Gus Van Sant : le caractère insondable de l’anatomie, l’infini de ce qui se manifeste, la beauté prolixe du plus simple contour corporel. Il n’existe pas de différence entre la surface et l’opacité du corps, entre la figure pleine qui emmène le plan vers la sculpture et la découpe colorée qui le ramène à la planitude. En cela d’ailleurs, My Own Private Idaho reprend bien les procédures du pastiche, de la parodie et du mélange réinventées en cinéma par Jean Genet et Pasolini mais il les prolonge aussi : où Pasolini hiérarchisait encore l’économie des emprunts selon une structure somme toute classique (sa théorie de la contamination affirme les privilèges expressifs de la picturalité), Van Sant n’admet ni ordre ni prérogative et, qu’il s’agisse d’un montage wellesien ou du split-screen des magazines érotiques, d’une lumière inédite ou d’une imitation de Mapplethorpe, une même énergie traverse chaque image, celle de la célébration.
Cette diversité garantit évidemment l’éloignement du modèle, mais sur un mode qui n’est pas celui de la déception : inépuisable, le corps l’est aussi de s’éprouver comme un organisme hanté par toutes sortes d’images mentales, souvenirs, pressentiments, fables et mensonges, qui le traversent et l’ouvrent indéfiniment. Les monologues extérieurs des ragazzi américains, la mise en scène par Scott (Keanu Reeves) de toute créature — ses pères, ses complices, ses clients —, les images primitives dont Mike se trouve assailli adviennent avec tant de force, de prégnance et de régularité qu’elles abolissent tout sentiment d’intériorité. La hantise n’appartient pas à l’intime, n’en constitue plus la preuve, au contraire, elle retourne le sujet sur lui-même, le déplie, expose au jour les phantasma, les rêves, les traumatismes : c’est Mike, figure de l’imagerie onirique — ; impose à l’autre les comédies, les scénographies et les semblants : c’est Scott, figure de l’imagerie politique. La hantise vient et revient comme un flux qui emporte et dissout la conscience de soi.
Ainsi, l’image règne, elle impose un régime de discontinuité et d’illimitation capable d’abolir le sujet à force de démultiplier ses puissances, en revenant tour à tour ou en même temps à titre d’image psychique, invention plastique et néantisation. Le visible apparaît comme le lieu d’indétermination du sensible, ce qui rend obscur le rapport au monde, au corps, à la sensation, à force de le manifester tout à fait. Et le sujet devient ici l’intotalisable fracturé par tout le reste, un être doux et absolument accueillant, avec pour seule vigueur celle de la projection.
Maintes fois, la chose désunie devient cause de plus grande union ; ainsi le peigne, fait de joncs fragmentés, unit les fils de soie.
Dénuement
Reprenons alors les choses là où Pasolini les avait laissées, lorsqu’il commentait si admirablement la cinématographie d’Andy Warhol ou de Jean-Luc Godard et lorsque le montage se devait de provoquer blessure, déchirure irraccordable.
Porcherie représentait la liquidation du sujet telle qu’alors penser Auschwitz l’avait rendue nécessaire : le personnage y faisait lacune, il accumulait les preuves inutiles de son inexistence — ni mort ni vivant, il ne lui restait plus qu’à s’abandonner à la catalepsie —, il s’y montrait irrécupérable – ni consentant ni contestaire –, indescriptible par les autres (sa mère, son père, sa fausse fiancée) comme par lui-même – Parler de moi me fait mal. Quel mal ? Un mal que tu ne peux imaginer. Le montage alternait le Barbare intemporel dévorant (Pierre Clémenti : J’ai tué mon père, j’ai mangé de la chair humaine, et je pleure de joie) et le Malade contemporain dévoré (Jean-Pierre Léaud : ma seule qualité, c’est d’être inaliénable) que tout opposait sauf un principe : se soustraire à la conservation.
Ce que Pasolini élabore dans Porcherie et rédige dans Le cinéma impopulaire, cette idée que seules ivresse suicidaire, vitalité défaitiste, auto-exclusion didactique peuvent manifester, dans la négation formelle, l’amour pour la vie, Adorno le développe au même moment et dans les mêmes termes. Il s’agit d’abandonner la conservation de soi, de faire procès à la cohérence artistique donc à l’individu qu’elle engage et, pour atteindre enfin à une pure expérience qui ne présupposerait rien de l’existence d’un sujet possible, de travailler le montage dans ses capacités dissonantes, en tant que mise en échec passionné du principe d’identité, scarification, irruption du déchet inappropriable.
Le montage est la capitulation intra-esthétique de l’art devant ce qui lui est hétérogène.
Pasolini, Adorno, les esthétiques de la défection sublime, au fond, conservaient intacte la vénération de ce qui n’était plus possible, substituaient au règne de l’aplomb la souveraineté de la défaillance. Mais de Jean-Pierre Léaud à River Phoenix, de la catalepsie à la narcolepsie, du faux-raccord comme destruction au faux-raccord comme soustraction, du montage hétérogène exprimant la défaite à la brassée d’images hétéroclites (une guirlande, à la manière de celle qui se balance entre les plans actuels et virtuels du Chant d’amour), on est passé, avec Gus Van Sant, dans un au-delà de la suppression du sujet.
Dans les mêmes fleuves, nous entrons et nous n’entrons pas, nous sommes et nous ne sommes pas.
Les créatures douces, non-thétiques de My Own Private Idaho — les ragazzi américains, les teenagers romains, ceux des enfants de Bob Pigeon qui ne l’ont pas renié, Mike qui les représente tous lorsque, revenu d’Italie, abandonné, absolument démuni, il s’effondre lentement de détresse sur l’asphalte de Portland, elles figurent ce point aveugle du sujet, cette réserve d’indétermination où se confondent encore et s’échangeront toujours extérieur et intérieur, perte et possession, l’intime conscience de l’autre et l’exclusive indifférence à soi.
Comme une même chose, c’est en nous le vivant et le mort, l’éveillé et l’endormi, le jeune et le vieux ; car en s’échangeant ceci devient cela et cela de nouveau ceci. La route qui monte, qui descend : une et même.
Les nuages défilent, les poissons bondissent dans les torrents, la maison vole, les images ont forme d’affects : si, dans My Own Private Idaho, les paysages sont du temps, c’est que dans l’évanouissement quelque chose se réactive, qui n’esquisse nulle promesse, n’esquive en rien le désespoir, appelle le vol autant que la compassion mais, inexorablement, sauvegarde le vulnérable.
Non pas certes les rêveries
Obscures de l’intériorité,
Et le mensonge de préférence
À l’imitation des classiques.
Cet âge exigeait son masque de plâtre,
Non d’albâtre, en prise rapide,
Une prose de cinéma,
Non la sculpture des rimes.
Ode pour l’élection du sépulcre d’E.P.
On y retourne pour mourir de douleur et pour avouer son amour. Don’t laugh at the natives. Ezra Pound aussi est né en Idaho[77][77] 6 Textes additionnels :
• Héraclite, Fragments, traduits par Roger Munier, Fata Morgana, 1991.
• Rainer Maria Rilke, Worpswede, in Œuvres I – Prose, traduit par Paul de Man, Seuil, 1966.
• Léonard de Vinci, Philosophie et Prophéties, in Carnets, traduits par Louise Servicen, Gallimard, 1942.
• Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, texte établi par Claude Lefort, Gallimard, 1964.
• Jean Damascène, Discours apologétique contre ceux qui abolissent les saintes images, traduit par Philippe-Alain Michaud, inédit.
• Pier Paolo Pasolini, Le cinéma impopulaire (1970), in L’Expérience hérétique,
traduit par Anna Rocchi Pullberg, Payot, 1976.
• Theodor W. Adorno, Théorie esthétique (1970), traduit par Marc Jimenez, Klincksieck, 1989.
• Ezra Pound, Hugh Selwyn Mauberley (Vie et relations), in Poèmes,
traduits par Ghislain Sartoris, Gallimard, 1985..
Épilogue
Il fait nuit. Né de courants électriques, un corps nu et athlétique surgit soudain sur le bitume sinistre d’une rue dévastée de Los Angeles. Accroupi, enroulé sur lui-même, le corps est vu de profil, sa pose ovoïde évoque aussi bien un gymnaste sur une amphore attique que les études géométriques de Léonard sur les fœtus ou encore l’adolescent accroupi que Michel-Ange avait prévu de placer sur la corniche supérieure du tombeau de Laurent de Médicis à Florence. Il vient du futur mais il revient du fond de l’histoire iconographique. Tout le monde l’a reconnu, c’est le Terminator, cette belle forme customisée, elle aussi habitée, mais par la machine au détriment des affects. Il répand la terreur et la mort, pourtant la seule vraie destruction du film est formelle : cet intérieur électronique tout-puissant n’a, en vérité, aucun besoin des muscles épais de son enveloppe corporelle. (James Cameron prendra acte du contresens en inventant le corps du T1000 dans Terminator 2 – Judgement Day : cette fois le caractère invicible de la machine trouve sa juste forme, une apparence agile, frêle et inexpressive jusqu’à la neutralité qui se prête souplement à toutes les métamorphoses). Le Terminator, personnage inédit du solécisme figuratif, nous réapprend bien malgré lui à aimer les apparences humaines.
Images : Introduction : Un Chant d'amour (Jean Genet, 1950), Le droit du plus fort (Faustrecht Der Freiheit, Rainer Werner Fassbinder, 1975), My Own Private Idaho (Gus Van Sant, 1991) / Exhaustion de l'apparaître, érotique de la disparition : Un Chant d'amour / Les allégories impures : Le droit du plus fort, Lili Marleen (1981), Les Larmes amères de Petra von Kant (Die Bitteren Tränen der Petra von Kant, 1972), Le droit du plus fort de Rainer Werner Fassbinder / Au-delà du négatif : My Own Private Idaho / Épilogue : Terminator (The Terminator, James Cameron, 1984).
Nous remercions, amicalement cela va de soi, Nicole Brenez de nous l'avoir confié.