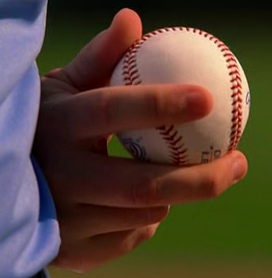Emmanuel Burdeau
Prières pour la comédie américaine
En 2010, Emmanuel Burdeau publiait Comédie, mode d’emploi, un livre d’entretien avec le scénariste-producteur-cinéaste dont le nom, à l’évidence trop commodément, est devenu celui là même de la comédie américaine contemporaine, Judd Apatow. En préambule, une « introduction à la vie comique » théorisait les acquis d’un travail critique entrepris au temps des Cahiers du Cinéma, dont Burdeau fut le rédacteur en chef entre 2004 et 2009, et dont les développements purent se lire dans Mediapart. Y était notamment développée l’idée de l’integrated comedy, soit une manière d’appréhender les mutations d’un genre à l’heure de sa dispersion dans un rire devenu général. La comédie depuis n’a cessé de gagner du terrain, au cinéma comme ailleurs, au point que les super-héros, désormais incarnés par Chris Pratt ou Paul Rudd, se taillent dans l’humour le costume de leur puissance, ou que culmine à quelques millions de vues le dernier sketch de Barack Obama.
Cette longue passion critique trouve dans Comédie américaine, années 2000 le loisir de s’épanouir. L’essai pourtant ne vise pas à faire somme. À la respiration profonde de qui cerne avec de plus en plus d’acuité un territoire, se mêle d’ailleurs le souffle court de la commande (un cycle est actuellement en cours au Centre Pompidou de Paris sur le stand up et la comédie contemporaine, auquel l’auteur est associé). Le livre varie ainsi les rythmes, les approches, les objets, remontant ici à Billy Wilder ou Woody Allen vu par Serge Daney, s’attardant là sur les imprécations de Will Ferrell. Trouées, incomplètes, ces années 2000 ? Emmanuel Burdeau est le premier à le reconnaître. Mais précises, oui, toujours. Et inattendues, comme en ce bref chapitre, marginal et essentiel, « Comédie blanche, comédie noire », qui pose la question des rapports de race au sein d’une comédie essentiellement blanche, et pourtant profondément travaillée par la culture afro-américaine. S’impose ainsi l’idée que si « l’histoire de la comédie reste à écrire », comme le note Burdeau au terme de sa réflexion, il sera désormais difficile de ne pas en passer par cet opuscule, d’une rare fertilité, généreux jusque dans sa concision.
Débordements : Quelle nécessité vous a poussé à remettre sur le métier la question de la comédie américaine contemporaine après Comédie, mode d’emploi, et alors même que le paysage a a priori peu changé depuis 2010 ?
Emmanuel Burdeau : Comédie, mode d’emploi a été lu, notamment par des cinéastes, et je crois pouvoir dire que c’est un livre qui compte, qui aura été pionnier, si peu que ce soit. Mais l’introduction que j’avais faite était brouillonne, un peu étouffe-chrétien (je me souviens d’un compte-rendu disant que le livre commençait « incroyablement mal » : l’affront passé, j’ai trouvé la formule assez forte.). Et surtout est arrivé à Beaubourg le projet d’une riche programmation sur la « nouvelle comédié américaine ». J’ai travaillé à l’établir aux côtés d’Amélie Galli et de Sylvie Pras, et dans le même temps — mais sans superposition —, j’ai repris et mis en ordre des notes accumulées sur le sujet. Avec l’idée (on va y revenir) d’un livre qui prendrait le contre-pied de l’« Introduction à la vie comique » : économie des exemples, chapitres brefs, notations à la fois simples et un peu énigmatiques, volonté d’indiquer des directions plutôt que de boucler des boucles, décrochages du contemporain vers l’Histoire, etc. Tout cela pour mieux développer mille choses que cette intro écrasait un peu sur son passage, et pour en ajouter d’autres, sur Wilder, sur Daney, sur la métaphore, sur Ben Stiller, sur Louis CK, etc.
D. : Votre livre sur Minnelli appartenait à la grande tradition des monographies amoureuses de leur objet. Celui sur la comédie américaine semble plutôt porté par une certaine ambivalence à l’égard des films évoqués. Ce décalage affectif est relayé par un déplacement théorique, puisque vous expliquez dans un passage central que la critique qui sied à ces films doit se délester des canons de la cinéphilie. Que chercher alors dans ces œuvres, si ce n’est l’écriture d’une expérience esthétique ? Et qu’est-ce qui change dans l’écriture critique dès lors qu’elle se penche non sur l’Art, mais sur des produits culturels au statut de plus en plus indéfini ?
E.B. : L’exercice est très différent, et c’est précisément ce que je voulais : un livre dans lequel l’« évaluation critique » n’apparaisse jamais directement, ne soit sensible que par des voies détournées. Cette ambition-là était présente dans le Minnelli, mais le lecteur voyait bien combien j’étais admiratif de ses films, ce que je n’entendais d’ailleurs évidemment pas dissimuler. Ici c’est différent : il fallait une écriture non-mimétique ; un livre pas drôle sur des films et des séries cherchant à l’être ; un ton d’ascèse pour évoquer le délire… Dans un corpus très voire trop riche, il fallait ne retenir que quelques cas, et qu’on se demande — parfois — pourquoi ceux-là et pas d’autres. Ce n’est qu’à moitié réussi. Mais la tentative demeure, et je lui donne volontiers valeur de méthode. Sinon de manifeste critique.
Non pas qu’il s’agisse de faire des livres dénués d’admiration et d’amour, surtout pas dans le cas de Minnelli. Mais il s’agit de faire en sorte que l’amour et l’admiration viennent de la réflexion, et non pas des adjectifs ou de préférences trop nettement affichées. Quiconque écrit sur les films (pareil pour les livres, je suppose) sait bien que l’adjectif ou la formule laudatifs viennent sous la plume — hum — pour relancer une phrase ou un passage qui boîte. Le compliment n’est en général qu’une béquille, pas une nécessité. Tout le monde sait ça.
Cela étant dit, la différence reste énorme entre Minnelli et comédie. J’ai fait un livre imposant sur le premier pour montrer — sans avoir à le dire — que je le tiens pour un des cinéastes essentiels de l’histoire. Et j’ai fait un livre plus modeste sur la seconde afin de prendre quelques vacances par rapport à la question de l’« évaluation ». J’eusse voulu que parfois on ne sache pas si j’aime tel film, tel acteur, pourquoi je m’attarde sur lui… Et j’espère qu’en effet il arrive qu’on s’interroge. Des lecteurs me disent souvent ne pas savoir, à la fin d’un article, si j’aime ou pas un film. C’est vexant, parce que c’est une manière de dire : “ oh la la, j’ai rien compris dis donc “. Mais c’est aussi et plus profondément un bon signe. Ceux qui écrivent en continuant de croire qu’il s’agit d’émettre des jugements — positifs ou négatifs — me font l’effet d’aveugles qui voudraient être rois au royaume des borgnes. Dans la situation d’absence de la critique où nous sommes, le besoin d’intelligence des films surpasse de beaucoup celui de statuer à leur égard.
D. : Vous expliquez que la politique des images ne s’exprime nulle part plus directement qu’à travers la comédie. Ce qui implique que le genre le plus populaire est toujours le plus révélateur. Pourriez-vous expliquer ce postulat ? On est loin de l’idée critique d’antan qui pensait trouver la vérité de l’époque dans des œuvres rares et exigeantes.
E.B. : Non. Je ne crois pas que le genre le plus populaire soit toujours le plus révélateur. Et je ne crois pas non plus que ce postulat soit loin de l’idée critique d’antan. Au contraire il s’autorise des conquêtes de la critique sur Hitchcock et quelques autres : en dépit d’une naïveté affichée, il est en vérité tout à fait fondé en Histoire. (Je sais bien que je vais trop vite, et qu’ici se pose une question qui me dépasse : que devient l’opération « hitchcockienne » — dire que tel « technicien » est en fait un artiste de première importance — à l’heure où ce « dandysme » — là aussi, mot rapide — est devenu monnaie courante ? Je n’ai pas la réponse mais je sais de quoi je parle : je rentre tout juste de Cannes).
Je crois juste qu’il y a un privilège de la comédie, en tant qu’elle s’intéresse à la vie dès lors qu’y entre un second degré (qui n’a rien à voir avec ce qu’on entend ordinairement par là) : images, paroles, objets venus d’ailleurs et repris. C’est ce que j’appelle, faute de mieux, la circulation. La comédie prend tout ce qui passe. Elle ne choisit pas. J’ai parlé à l’instant d’écriture non-mimétique. C’est vrai et c’est faux. Le mimétisme existe mais il est ailleurs : sur un genre qui ne choisit pas, essayer une critique qui fasse pareil. Sans verser dans l’inconséquence pour autant.
D. : Nombre des raisonnements au cœur de ce livre – sur le nouveau maniérisme « documentariste », le rapport du cinéma à la terreur, le devenir-image de notre être, l’omniprésence des caméras –, vous les aviez élaborés en écrivant sur le cinéma d’action. Cela voudrait-il dire qu’il s’agit d’un devenir frappant tout le cinéma, ou le cinéma hollywoodien tout du moins ? Quelle spécificité pour la comédie dans cette mutation ?
E.B. : Là-dessus au moins il me semble que ce livre troué de partout et bancal est assez clair. C’est un livre sur le cinéma d’aujourd’hui, les années 2000, 2010. Il a donc sa place à côté d’autres travaux en cours : sur le numérique dans le feuilleton de Trafic « Record du Monde », sur les séries ici et là. Quant à la spécificité de la comédie, elle apparaît dans le livre, mais c’est vrai qu’il aurait fallu y insister davantage : c’est un peu un genre-poubelle, surtout aujourd’hui, un genre-déchet — aspect qui ne se manifeste jamais mieux que chez Ben Stiller —, et à ce titre elle a une place à part, un point de vue imprenable sur le contemporain. Ou qui serait imprenable s’il ne s’agissait pas précisément pour elle de proposer autre chose qu’un point de vue. On peut le dire d’une formule facile : la comédie est dans l’image, le nez dedans. Elle ne sait pas ce qu’elle fait. Elle n’en a pas besoin.
D. : Les acteurs, qui sont aussi souvent les scénaristes de ces films, occupent tout le champ de l’analyse, au détriment des réalisateurs. Est-ce à dire qu’il s’agit d’un cinéma qui pourrait (enfin) congédier les interrogations sur la « mise en scène », et dire adieu à l’auteurisme qui va avec, pour déplacer la critique vers d’autres questionnements ?
E.B. : Je ne veux congédier rien ni personne. Je prends un corpus et je regarde les noms et les forces qui le traversent et le font exister. Certains sont des cinéastes, d’autres des acteurs, d’autres encore des figures, des scénarios-types… Je suis par ailleurs très auteuriste, j’y crois dur comme fer, au moins en un sens : il y a dans le cinéma des œuvres, qu’il faut décrire, avec leurs continuités et leurs discontinuités. (Procéder ainsi est en vérité un peu différent de l’auteurisme classique, qui privilégie surtout les régularités et l’« univers » d’un auteur, mais qu’importe). Je m’y efforce assez régulièrement sur Mediapart, au sujet d’Eastwood ou des Dardenne, de Kechiche ou de Dumont, de Cronenberg ou de Beauvois. Des cinéastes que j’admire, d’autres que j’admire moins. La question n’est pas là. Rien ne remplace le travail, et rien ne remplace la description d’un travail. Je m’étonne parfois d’être un peu le seul à faire cet effort. Ici c’est autre chose. La tentative d’objectiver une autre passion. De me saisir d’un « objet culturel » qui passe par le cinéma tout en le dépassant.
D. : Vous avancez l’idée, centrale, d’une alliance nouvelle de la comédie, ou du rire, avec le pouvoir. Or, il semble que vous confondiez parfois la cause et les effets. David Brent, ou les personnages de Will Ferrell, sont toujours les objets du rire. Avec toute leur splendeur ridicule, ils prennent la honte sur eux, comme vous le dites très bien. Le génie de ces acteurs est bien d’avoir composé des monstres de narcissisme usant, parfois, de l’humiliation envers leurs proches, sans pour autant que nous riions de ces derniers. La chose est plus ambigüe dans ce que l’on pourrait nommer la « comédie tyrannique », où il s’agit là de rire avec celui qui offense et humilie. La comédie tyrannique n’est pas un genre, mais il existe, par exemple dans 21 Jump street ou Voisins du troisième type, des « effets comiques de tyrannie » qui font basculer le rire véritablement du côté du pouvoir. N’y aurait-il pas, plutôt qu’une rupture historique qui ferait passer dans un nouvel âge de la comédie, des dynamiques comiques concurrentielles plus ou moins sensibles, repérables, à tel ou tel moment ?
E.B. : Je reconnais en effet dans votre question la trace d’articles publiés sur Débordements et ayant justement trait à ce que vous appelez « comédie tyrannique ». Vous avez raison. Je suis allé trop vite en besogne. Ou plutôt j’ai rencontré une difficulté. Mon projet n’était pas de dire pourquoi telle chose est drôle, ou comment le comique circule entre un sujet et un objet. Je voulais me contenter de répondre à une question : quels sont aujourd’hui les nouveaux territoires de la comédie ? de quoi parle-t-elle ? de quoi se nourrit-elle ? si c’est une force, comment se déplace-t-elle ? où s’exerce-t-elle désormais ?
Sur mon chemin j’ai tout de même été obligé de rencontrer quand même des sujets, d’un côté David Brent (début du livre), de l’autre George Simmons et Andy Kaufman (fin du livre ou presque). C’est un des paradoxes de cet essai : il parle de la comédie comme force autonome en un temps où celle-ci concerne plus que jamais l’invention d’une certaine subjectivité. Que je le veuille ou non, j’ai donc quand même été amené à demander : qui fait rire, de quoi et aux dépens de qui ? Et c’est vrai que je ne suis pas allé assez loin dans cette investigation-là. Parce que j’ai redouté de devoir alors être obligé de reconduire le moralisme facile qui prévaut en la matière comme presque partout : untel ne fait pas rire contre mais avec, etc., nous pouvons donc l’aimer sans problème. Ce discours de scouts qui commence par poser un problème pour mieux ensuite nous dire que tout va bien. Ces articles qui ne servent qu’à dire et à faire dire ouf, on a senti le vent du boulet, mais en fait non, ça roule.
(J’ai entendu avant Cannes l’historien Patrick Boucheron à la radio dire qu’il avait essayé de faire un livre — sur les événements de janvier, co-signé avec Mathieu Riboulet — qui ne fasse plaisir (ou du bien, je ne sais plus) à personne. Ça m’a plu ![11][11] Il s’agit de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet, Prendre dates – Paris, 6-14 janvier 2015, Verdier, 2015 (ndlr).).
Il n’en reste pas moins que vous soulignez, incontestablement, une lacune du livre. Lacune toutefois excusable : je ne voulais pas qu’on puisse croire que je plaçais la réflexion sous le thème : comédie & humanisme, ou comment le rire nous rend meilleurs.
D. : Vous semblez poser que la comédie demeure un genre critique. Pourriez-vous revenir sur cette idée, qui n’a rien d’évident – après tout, le geste transgressif tend lui-même à être récupéré par la norme ?
E.B. : Cela fait partie des choses qu’il ne me gêne pas tant que ça d’avoir laissées en suspens. Enfin si, ça m’ennuie quand même un peu : il y a décidément trop de béements dans ce livre. Parmi les développements prévus et abandonnés en cours de route, il en était un qui essayait de montrer combien est courte l’approche consistant à critiquer ces films pour leur aspect souvent conventionnel, traditionnaliste. La presse parle souvent des comédies contemporaines en ces termes : ça part bien, quel dommage que cela finisse de façon unanimiste ! C’est vrai que le parcours est souvent celui-là. Il me semble pourtant qu’en prendre prétexte pour rejeter un film a moins à voir avec une louable attention au contenu politique du cinéma qu’avec une sorte d’aubaine consistant à utiliser un motif éprouvé à propos d’« œuvres » en vérité moins situables que cela. Le progressisme sans souci de la critique m’effarera toujours. On sait bien pourtant que tous les grands comiques ont été dits à la fois de droite et de gauche, Tati le premier, tantôt regardé comme passéiste, tantôt au contraire comme visionnaire dans sa description du progrès. J’ai essayé de sortir de l’alternative. Et bien sûr il n’était surtout pas question de tomber dans la crétinerie à la mode consistant à montrer que ce qui semble de droite est en vérité de gauche : ça fait plaisir — on n’en sort pas —, mais à part ça, l’opération est nulle.
D. : Votre refus du moralisme, ou d’une conception idéologique de la critique fonctionnant sur un binarisme droite / gauche peu approprié, est bien légitime. Mais il semble qu’il y a aussi chez vous une méfiance plus profonde à l’égard de la morale cinématographique dont Godard et Rivette auront fourni les maximes les plus marquantes, et dont Daney sentait déjà l’épuisement, ou l’inadéquation aux images nouvelles de son époque. Qu’en est-il de la morale à l’heure numérique, où la question de l’image de l’autre et de ses circulations, se pose très différemment ? Quelle place, de manière plus générale, une telle réflexion peut-elle avoir dans votre approche critique ?
E.B. : Amis de la légèreté bonsoir… Je préférerais mourir sur place plutôt que laisser accroire que les acquis de Godard, Rivette, Daney et quelques autres ne n’importent pas. Je remarque seulement que ceux-ci sont plus souvent utilisés pour mettre fin à un débat que pour l’alimenter. J’énonce là un truisme, je pense que vous n’en disconviendrez pas. Et pour en énoncer un second, j’ajouterais que l’histoire de ce souci moral, de son apparition et de sa pérennité, reste à faire. D’une certaine manière, j’en donne quelques éléments dans le chapitre sur comédie et cinéphilie, sous-titré « Avec Daney ». J’en donne d’autres dans le feuilleton de Trafic, où de façon répétée je reviens au fait que la morale de Bazin était inséparable d’un certain appareillage technique (rendant par exemple délicat de filmer de très près, ou dans des conditions extrêmes) qui n’existe plus aujourd’hui.
Je ne prétends pas pour autant avoir la réponse à votre question. Je continue d’avoir la plus grande admiration pour Bazin, et je n’appelle pas Daney autrement que le « maître ». Le chapitre que je lui consacre dans ce livre n’est d’ailleurs qu’une première fois. Un autre du même genre figurera dans un essai, à paraître chez Yellow Now, consacré à Palombella Rossa, film « moral » s’il en est. Les questions que vous soulevez me semblent donc tout à fait nécessaires et urgentes. Je refuse toutefois de me croire du bon côté — et de m’en trouver bien —, au simple motif que j’écris sur des films dignes de ce nom ou me croirais capable de distinguer une image convenable d’une mauvaise. La bonne conscience cinéphile reste une des choses les plus sinistres qui soient.
D. : Vous évoquez souvent le rôle matriciel qu’ont pu avoir d’une part le stand-up, d’autre part le Saturday Night Live, en montrant leur influence quant à la spectacularisation de la puissance, la mise en scène de l’ego, etc. Mais est-ce qu’il n’y a pas eu aussi des contaminations touchant à la scénographie, la composition visuelle, bref une refonte des cadres de la mise en scène, au-delà du jeu ?
E.B. : Sans doute. Mais vous aurez remarqué que je décris cette histoire à très gros traits. Je la méconnais trop dans ses détails pour proposer l’analyse que vous suggérez et qui est en effet nécessaire. Au fond je ne parle pas du stand up, je parle de Saturday Night Live et de celui qui apparaît dans les mêmes années 1975, Woody Allen. Pour cela, comme je viens de le dire, j’invoque et appelle à mon secours le maître, Serge Daney, dont je livre une lecture qui nous repose des habituelles. Fût-ce seulement parce qu’elle s’attache aux textes plutôt qu’à la posture.
D. : Wilder apparaît comme l’ancêtre de cette comédie. Chose étrange, surtout qu’il s’agit d’un cinéaste appartenant encore au régime classique de l’Auteur que mettent en pièces les figures contemporaines que vous évoquez.
E.B. : Pas du tout. Relisez le chapitre « Le majeur et le mineur » ou « Fragment pour une Histoire de la comédie ». Dans le premier, pour m’en tenir à celui-là, j’explique qu’il y a chez Wilder la combinaison de deux devenirs, mineur et majeur. Transgression de la loi mais aussi retour à une loi plus originaire, travestissement mais aussi « uniformisation » générale. Je le fais à propos de son premier film américain, justement intitulé The major and the minor et dont le comique, dans le double contexte de l’armée et de l’adolescence, repose sur le croisement de ces deux motifs : le déguisement et l’uniforme. Je lie cela à l’obsession que Wilder avait de décrire les Etats-Unis comme territoire procédant d’une profanation, d’un viol qui n’eut pas lieu une seule fois mais se répéta tout au long de l’histoire américaine. Pour le dire vite, le comique selon Wilder doit profaner, mais il doit aussi réparer la profanation. Je connais mal la littérature anglo-saxonne sur son œuvre, mais en français je n’ai rien lu d’approchant.
Wilder fait partie de ces cinéastes — ils sont nombreux — sur lesquels très peu de choses solides ont été écrites. Ces deux forces, devenir-majeur et devenir-mineur, j’explique ensuite — trop vite, j’en ai bien conscience — qu’on peut les retrouver à l’œuvre à toutes les époques de la comédie, et notamment l’actuelle. Wilder m’offre donc un schéma, un paradigme. Mais pas un modèle. Je suis tout à fait prêt à concéder qu’entre lui et, disons, Ferrell ou Carrey, les ressemblances sont minimes.
D. : Malgré son titre, le livre ne se propose pas d’être une « histoire » de la comédie américaine des années 2000. Il y a néanmoins, essaimées, des esquisses généalogiques. C’est même tout l’objet du dernier chapitre. Pourquoi ce titre, et pourquoi cette « histoire » par fragments, ou ces fragments d’histoire ?
E.B. : Le mot histoire n’est pas dans le titre. Le titre est encore plus neutre que ça : “Comédie américaine, années 2000”. C’était d’abord un sous-titre, et puis l’éditeur (Nicolas Vieillescazes) et moi avons jugé que cela allait bien : pas sexy mais honnête, adéquat à un projet se voulant avant tout descriptif. J’aurais aimé que ce livre fonctionne encore bien davantage par touches, avec davantage de chapitres, mais plus courts. Le temps, le manque de temps en ont décidé autrement, ainsi que la nécessité, malgré tout, de développer certaines choses, afin de ne pas être trop obscur ou touffu (je n’ai pas dit « profus »). J’avais envie d’un truc qui, sur un sujet ne s’y prêtant a priori pas du tout, ressemblerait presque à un livre d’heures, ou de prières. Ou au moins l’idée que je m’en fais. Le premier titre était d’ailleurs « Prières pour la comédie américaine ».
D. : Vous finissez le livre sur l’idée que l’histoire de la comédie a été figurée par les films eux-mêmes, mais qu’elle n’a pas encore été écrite. Si quelqu’un avait la bravoure d’initier un tel chantier, à partir de quoi l’écrirait-il ? Quelles charnières prendrait-il ? Et quelles unités, quels outils pourraient servir à cette histoire, puisqu’elle semble être d’un autre genre que la classique histoire du cinéma telle que la cinéphilie l’a inventée, avec son enfilade d’auteurs s’enfantant les uns les autres ?
E.B. : Je ne sais pas. Et puis pour l’instant j’ai envie de passer à autre chose. Je regrette d’avoir dû laisser de côté Preston Sturges, qui est grand parmi les grands, que le maigre livre de Marc Cerisuelo est loin d’avoir épuisé, et qui a notamment mis en lumière les rapports entre comédie et fortune (au sens de l’argent mais aussi du destin). Je voulais placer Sturges en exergue d’un chapitre sur la « comédie de l’autre vie » : tout ce sous-genre qui touche au fantastique, aux vers et aux revers de fortune, comme dans The 50 First Dates, Yes Man, The Hot Chick… Le grand texte de Manny Farber sur Sturges s’appelle “Success in the movies”. J’aurais parlé de ça : le rapport entre comédie et succès, comédie et réussite, sous un autre angle que l’arrogance ferrello-stillerienne. Là aussi, manque de temps.
Une histoire de la sitcom serait bienvenue, mais mon petit doigt me dit que c’est dans les tuyaux, et que vous en savez plus que moi à ce sujet. Et j’ai en projet un essai : « Lubitsch, Wilder et les politiques de la comédie ». Parution prévue en 2022. J’en profite pour dire que mon rêve du moment est là : réussir à écrire un vrai essai, un long texte avec de longues coulées, tout en nuances et en accélérations…
D. : Au début des années 2000, vous coordonniez dans les Cahiers du Cinéma un dossier consacré au DVD, avec l’idée de saisir ce que ce support change dans la réception critique des films. Il est ici quelques notations qui semblent provenir directement des recherches que l’on ne manque jamais de faire sur Internet au moment d’écrire. Avez-vous l’impression que les outils informatiques, dans leurs manières de disloquer, citer, référencer ou « détourner » les films, ont pu travailler votre manière d’écrire ou de construire le livre ?
E.B. : Oui oui oui. Internet change tout. En ligne on trouve tout, le moindre détail, tout. C’est génial. Cela a eu sur moi un effet qui semblera peut-être paradoxal. Cela m’a conduit à être moins fétichiste dans la description, à laisser flotter un peu les détails, à laisser la porte entrouverte… Si tout est disponible et à portée de main, à quoi bon s’escrimer à pallier un manque qui n’existe plus ? C’est pourquoi me font rire les livres où la description maniaque des images semble à la fois confirmée et comme ruinée par les centaines de captures DVD proposées en illustration. Quand il y a surabondance, c’est la rareté qu’il faut réinventer. Dans ce livre il y a beaucoup de béances que je déplore, mais il y en aussi un bon nombre qui sont là dessein.
D. : Quelles comparaisons pourrait-on faire entre les comédies américaine et française ?
E.B. : En France, la comédie est nulle, à l’exception de Pierre Salvadori et de rares autres. La vraie question c’est : pourquoi Alain Chabat et Jamel Debbouze, pourtant géniaux, ne font pas — comme réalisateurs ou comme producteurs — des films géniaux ? C’est quoi le problème ?
Images : Moi, député (The Campaign, Jay Roach, 2012) / Tonnerres sous les tropiques (Tropic Thunder, Ben Stiller, 2008) et Disjoncté (The Cable guy, Ben Stiller, 1996) [détails] / Uniformes et jupons courts (The Major and the minor, Billy Wilder, 1942) et Kenny Powers (Eastbound and down, Ben Best, Jody Hill et Danny McBride, 2009-2013) / Délire express (Pineapple express, David Gordon Green, 2008).