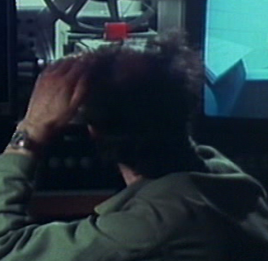Du cinéma au cinéma exposé : un détour par la télévision
Ou comment éventuellement revisiter Fellini dans l’espace
Dans un texte qui examine le devenir du spectateur de cinéma à la fin des années 1980, Serge Daney avance une hypothèse forte qui engage notre perception des images animées et de leur enchaînement : selon l’auteur de La Rampe, l’art du montage cinématographique n’aurait pu être apprécié à sa juste mesure si le spectateur ne se trouvait assis, dans une salle obscure, en posture d’immobilité[11] [11] Serge Daney, « Du défilement au défilé », La Recherche photographique, n°7, 1989, p. 49. . Cette thèse est énoncée dans le cadre plus global d’une réflexion sur les relations contrariées entre cinéma et télévision, avec un constat de départ qui se formule en ces termes : le spectateur de films cherche de plus en plus à s’émanciper de sa «vision bloquée» en salle ; il paraît probablement moins attentif, plus dissipé – il tend dans tous les cas à une plus grande mobilité physique, ce qui a pour conséquence de mettre en péril l’idée première avancée par Daney sur nos conditions d’appréhension du montage. L’explication causale de ce phénomène d’émancipation, comme sortie de la position immobile, s’élabore suivant deux usages des images : à travers la télévision d’une part, à travers les installations vidéo et les « choses de ce genre » d’autre part. Il va de soi que le téléspectateur est moins discipliné que le spectateur de cinéma : l’obscurité moindre d’un salon privé favorise une attention plus volatile qu’en salle ; la taille réduite de l’écran accompagne aussi un recueillement moins aisé qu’au cinéma ; les déplacements devant l’écran y sont potentiellement plus élevés – littéralement, le téléspectateur « défile » devant les images que diffuse son poste. Ce qui justifie le titre de ce texte décisif de Daney : schématiquement, nous passons d’un âge du défilement des images à un autre où c’est nous qui défilons devant elles.
Si le premier axe télévisuel est convoqué par Daney pour étayer son propos, la référence aux installations n’est qu’à peine signalée, alors même qu’un approfondissement du côté des images exposées au musée aurait permis de mettre en perspective l’hypothèse première sur la corrélation entre montage au cinéma et immobilité du spectateur. Avec le questionnement qui suit : que devient le montage dès lors que le spectateur – en fait, le visiteur – se déplace devant des images disposées dans un espace où une mobilité est requise en vue du passage de l’une à l’autre ? Daney semblait promis à soulever un problème de ce type, à la croisée des médiums et de la réception que nous en faisons (cinéma, télévision, vidéo). Au lieu de cela, il se limite dans la suite de son développement à la seule expérience filmique en salle, énumérant les cinéastes qui ont su prévoir ou répondre aux transformations du spectateur contemporain. Autrement dit, tout se passe comme si le constat de nature sociologique qui inaugurait l’analyse – le spectateur comme individu toujours plus mobile devant les images – était repris au niveau de la plastique interne des films, où les personnages de la trame narrative se substituent aux spectateurs que nous sommes. C’est alors que le nom de Fellini est cité, comme un réalisateur qui a su, très tôt, porter des défilés en tous genres à l’écran : « On a beaucoup ri aux défilés de Fellini Roma [1972], surtout les nonnes en patins à roulettes du Vatican. Mais dès La Dolce Vita [1960], Fellini demande à ses personnages de n’être pas beaucoup plus que des figurants, de passer un moment devant ce personnage supplémentaire : la caméra […]. Jusqu’à Ginger et Fred [1985], il multiplie les défilés qui sont autant de parodies de moins en moins affectueuses de ce que la télévision fait ».
La mobilité précédemment évoquée se retrouve ainsi circonscrite dans la fable des films de Fellini ; elle n’est plus agencée à un dehors des pratiques qui éclairerait en retour la situation actuelle des images, dont l’exposition des images en mouvement à l’intérieur du musée fait partie. Nous voudrions effectuer le saut dans l’espace que Daney ne fait pas, et considérer les opérations fondamentales du cinéma – le montage, mais aussi le cadrage ou le mixage – dès lors qu’elles sont investies hors des entours de la salle obscure. Nous ne quittons pas pour autant le cinéma, au contraire, puisque c’est à partir des composantes de l’image que ce passage vers le cinéma exposé aimerait se dessiner. Il s’agirait plus exactement d’étudier la mise en espace des images mouvantes depuis la représentation des images dans l’espace du film lui-même. En d’autres termes, il ne s’agirait pas uniquement de songer aux modalités de spatialisation de l’image dans l’exposition du cinéma, mais de puiser dans le cinéma les manières dont cette spatialisation se fait : par exemple, la manière dont un réalisateur place savamment un écran de télévision dans un endroit donné (une chambre d’hôtel, un plateau audiovisuel, un poste de contrôle, etc.) nous instruit potentiellement sur la façon dont il serait envisageable d’opérer une mise en espace des images dans le musée ou la galerie. Les dimensions de l’écran, et l’acte de cadrage qui l’accompagne, ne sont bien sûr pas les seuls concernés par cette traversée de la représentation de l’espace dans l’image vers la présentation de l’image dans l’espace. La composante sonore d’un film, dans les jeux d’orientation et de désorientation qu’elle entretient avec l’espace représenté, doit également compter dans une réflexion sur les parcours possibles d’une exposition du cinéma, où le son peut se révéler être un élément déterminant dans l’élaboration d’une impression spatiale.
Ce saut vers le cinéma exposé, nous tenterons donc de le réaliser en fonction des formes filmiques elles-mêmes, et depuis le cinéma de Fellini, justement, qui possède virtuellement plusieurs vecteurs de spatialisation au sens où nous l’avons indiqué : voici en effet un réalisateur qui pense avec la plus grande acuité la taille de l’écran où des images sont projetées, la lumière et les couleurs qui en émanent et la façon dont elles contaminent son environnement, les bruits qui proviennent d’une séquence télévisuelle et interagissent avec d’autres sources sonores (conversation ou vie urbaine), etc. Nous procéderons à partir d’études de cas issus de la dernière partie de la filmographie de Fellini, où la lucarne télévisuelle est omniprésente ; idéalement, l’analyse de films obtenue devrait laisser entrevoir des pistes d’instructions pratiques pour une exposition de l’œuvre de Fellini, à condition d’estimer nécessaire un déploiement de son travail entre les murs d’une institution muséale à laquelle il n’est pas originellement destiné. L’un des aspects de cette nécessité, c’est sans doute le renouvellement de la compréhension que nous pouvons avoir de l’une des cinématographies majeures de l’histoire. Corrélativement, ce passage de la salle vers le musée aiderait à saisir l’âge de l’image qui est le nôtre, dans la mesure où il s’accomplirait avec un metteur en scène qui n’a cessé de concevoir le cinéma dans un rapport, contrarié ou pas, aux autres images – une tâche critique qui engage la vie des formes filmiques et qu’il nous appartient de reprendre à chaque époque.
NB : Un mot encore, avant de pénétrer dans l’art de Fellini et d’esquisser quelques instructions qui déplieraient les composantes de ses images dans l’espace du musée. Il porte sur la notion de spectateur, avec laquelle cette étude a débuté, et plus particulièrement sa place dans le cinéma exposé ou étendu. Il va de soi que, dans ce dernier contexte, le spectateur est mobile, contrairement au visionnage en salle, et que son trajet au sein du lieu d’exposition est virtuellement indéterminé. Il ne faudrait toutefois pas conclure de cette indétermination à l’impossibilité d’une scénographie qui organiserait les différentes étapes d’une déambulation sciemment pensée par l’artiste, le cinéaste ou le commissaire ; cette scénographie, quand elle existe, implique bien l’établissement d’un parcours que le spectateur, dans sa mobilité, doit s’efforcer de suivre s’il veut appréhender le sens aussi bien que la totalité de l’exposition qu’il arpente. Un plan de l’ensemble, peut-être une numérotation de salles, ou assurément mieux, une sensation non linéaire de progression dans l’espace : autant d’éléments qui renvoient à un travail de spatialisation qui ne saurait en appeler à la figure aujourd’hui stéréotypée du visiteur d’exposition : un spectateur devenu co-créateur, qui fabrique ou édifie les œuvres qu’il rencontre en fonction de son déplacement dans l’espace. Une phrase de Gilles Deleuze sur le spectateur de cinéma devrait nous guider pour échapper à cette figure consacrée, faussement émancipatoire, qui nous empêche d’apprécier les images du cinéma exposé autant que leur distribution spatiale raisonnée : « rien ne se passe dans la tête du spectateur qui ne provienne du caractère de l’image »[22] [22] Gilles Deleuze, L’image-temps. Cinéma 2, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985, p. 136. . Dans le cinéma exposé ou élargi (expanded cinema), l’image est plurielle, puisque le spectateur est confronté le plus souvent à plusieurs écrans ; cependant, même cette expérience de polyvision, dès lors qu’elle offre un ordre de juxtaposition des images, doit primer sur l’éventuelle participation d’un spectateur supposé en fournir la signification ultime. En fait, la reprise de la phrase de Deleuze au niveau de l’exposition du cinéma devrait se constituer parallèlement à une topographie des images en mouvement, que celle-ci soit à l’œuvre à l’intérieur des films ou qu’elle s’en inspire, comme nous souhaiterions le proposer maintenant avec Fellini.

Commençons par une évidence : Fellini n’est pas tendre avec le médium télévisuel. Au moment de la préparation de Ginger et Fred – le récit d’une émission de télévision entièrement composée de sosies, comme Clark Gable, Marcel Proust, mais aussi Ginger Rogers et Fred Astaire, respectivement interprétés par Giulietta Masina et Marcello Mastroianni – le cinéaste multiplie les entretiens où il s’inquiète du devenir de cette singulière lucarne, « cet océan d’images indistinctes, enchevêtrées, dans un magma qui se substitue, même quantitativement, à la réalité ». Ailleurs, il condamne « le flux incessant d’images que la télévision nous déverse dessus chaque jour et qui finit par s’auto-effacer, s’auto-annuler »[33] [33] Federico Fellini, Fellini par Fellini, Paris, Flammarion (coll. Champs), 2007 (original publié 1984), p. 169 et Conversation avec Federico Fellini, Paris, Denoël, 1995, p. 219. . Agent de substitution ou facteur d’effacement du réel, la télévision est dénoncée sans relâche par Fellini vers le milieu des années 1980, en partie parce qu’elle attente au « mystère » ou à la « magie » du cinéma, termes généraux utilisés par le réalisateur italien lors d’interviews et qui possèdent pourtant une portée rigoureuse dans ses films. Car Fellini continue à tourner et à faire des films, et à y intégrer de plus en plus la télévision, pourtant présentée comme son ennemie intime ; de fait, Ginger et Fred en est parsemé, comme le prouve le bâtiment de l’hôtel où sont regroupés les futurs participants d’Ed Ecco a Voi, l’émission de variétés où les divers sosies se retrouveront. Cet hôtel est conçu comme « [débordant] de téléviseurs, toujours aux aguets derrière les personnages », ou encore : « tout le film est constellé de téléviseurs, qui bombardent des spots publicitaires […] [des] bavardages sur bavardages, jusqu’à l’étourdissement, jusqu’à l’abrutissement »[44] [44] Conversation avec Federico Fellini, op. cit. .
Il convient toutefois de dépasser la plainte qui s’exprime dans ces phrases, et suivre de près la transformation que subit une critique de ce genre dans le passage à la réalisation ; c’est d’ailleurs au niveau de la composition des images, et à ce niveau seulement, qu’une esthétique véritable se profile, et que derrière le caractère convenu de certaines déclarations négatives sur la télévision transparaît une position de metteur en scène subtilement constructive. Constructive en quel sens ? Au sens où cette mise en scène se situe sur le terrain même de ce qu’elle combat, évitant par là toute posture réactive au regard d’une production médiocre, et faisant transparaître dans la situation la plus navrante, une voie de salut à laquelle Fellini donne un nom : la « procadence », c’est-à-dire, comme le note Deleuze cité sur ce point par Daney, cette capacité à « épouser même la décadence […] être complice de la décadence, et même la précipiter, pour sauver quelque chose, peut-être, autant qu’il est possible ». Ce qui permet de comprendre le mot de Fellini pour qualifier Ginger et Fred : « Un film sur la télévision, ou mieux, interne à la télévision »[55] [55] Respectivement, L’image-temps. Cinéma 2, op. cit., p. 14 et Conversation avec Federico Fellini, op. cit., p. 208. À propos de la phrase de Deleuze, Daney remarque : « S’il y a une morale fellinienne, c’est de ce côté-là qu’il faut la chercher et si elle est souvent passée inaperçue, c’est qu’elle est modeste » (souligné par Daney), dans Ciné journal, Paris, Cahiers du Cinéma, 1986, p. 312. La procadence renvoie en ce sens à une esthétique de l’indiscernable, dont la dimension critique, en raison de sa « modestie », se révèle d’autant plus saillante qu’elle ne cherche pas à faire la leçon. . Une question dès lors se pose : comment rendre à l’écran ce « magma d’images » de la télévision, ce « bombardement » dont nous sommes quotidiennement sujets ? C’est là que la dimension spatiale de la mise en scène fellinienne entre en jeu, et qu’un embryon d’instructions en vue d’exposer son cinéma apparaît. De quoi s’agit-il ? Trois aspects complémentaires surgissent d’une scène qui se déroule dans l’hôtel des sosies, déjà mentionné ; elle correspond au moment où Ginger se rend pour la première fois dans sa chambre, accompagnée d’un préposé de l’établissement qui lui porte ses bagages et que l’on avait entraperçu au début de la séquence dans le hall du même hôtel en train de regarder un match de foot avec plusieurs collègues regroupés autour de la réception.
Premièrement, il faut prêter attention au mobilier qui compose cette chambre : outre le poste de télévision, que le préposé allume dès qu’il y pénètre pour reprendre le fil du match, il importe de noter que la principale armoire se confond tout du long dans sa partie extérieure avec un miroir, et qu’un autre, plus étroit, se situe près du lit. La combinaison des jeux de miroirs fait que la télévision apparaît pratiquement à chaque plan : soit comme un élément du décor, soit plein écran lorsque les programmes télévisuels se substituent à l’action du personnage dans sa chambre, soit dans un reflet de l’un des miroirs de la pièce, qui accentue l’effet de présence de la télévision dans le champ. Ainsi est mis en espace son déferlement d’images, auquel il faut ajouter la variété des émissions, toutes réalisées par Fellini, qui se succèdent au rythme du zapping de Ginger : fragment de série TV, aperçu d’une chaîne culinaire, séance de gym, clip vidéo. Une exposition du cinéma de Fellini pourrait rejouer sur une scène muséale ces croisements et réflexions de miroir qui font proliférer l’objet télévisuel et l’image qu’il diffuse, sans nécessairement chercher à projeter la séquence de Ginger et Fred en question, encore moins à reconstituer à l’identique l’espace de la chambre d’hôtel où elle se déroule.


Ginger et Fred, Federico Fellini, 1985
Le « flux incessant » de la télévision est ainsi spatialisé sans que la mise en scène tombe dans les facilités d’un montage heurté ou frénétique, qui feindrait d’assommer les personnages du film autant que ses spectateurs. Une autre fonction spatiale est opératoire dans Ginger et Fred, qui serait susceptible d’être réemployée dans un projet d’exposition ; elle a trait à la dimension chromatique de l’image télévisuelle, et à son interaction avec le dehors de la scène : non seulement le dehors de l’écran (la chambre d’hôtel), mais l’extériorité de ce dehors qui se trouve elle-même imprégnée des couleurs qui émanent du spectacle audiovisuel. En l’occurrence, il s’agit de l’étrange vidéo clip sur lequel tombe Ginger lors de ses changements de chaîne : un homme dans une sorte de scaphandre aux teintes bleues est en train de suffoquer au milieu d’un paysage désertique, peut-être post-nucléaire, sur fond d’un ciel lourd, sombre et marron. Or ces dominantes de couleurs épousent plusieurs éléments de l’espace représenté dans le film : le bleu du scaphandre rencontre celui qui enveloppe la semi-obscurité du lieu où se trouve Ginger, en même temps que la tonalité marron du vidéo-clip correspond exactement à la couleur du ciel qu’elle contemple à travers les stores de sa chambre (tandis que son regard suit de bas en haut une imposante antenne de télévision). Nous avons là un geste cinématographique récurrent chez Fellini, qui consiste à réduire la distance qui sépare le réel du spectacle ; le critique et théoricien du cinéma Barthélemy Amengual a bien perçu ce trait chez l’auteur de La Dolce vita ou de Luci di varietà : soit on « sort du spectacle pour retourner au réel », soit « le réel se fait spectacle ou spectaculaire et fascine pour de vrai »[66] [66] Barthélemy Amengual, « Itinéraire de Fellini : du spectacle au spectaculaire » (1963), dans Du réalisme au cinéma, Paris, Nathan, 1997, p. 381 (souligné par Amengual). . Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, quand il s’agit des mondes du cirque ou de la variété, pour lesquels Fellini a une profonde affection ; pour le pire, lorsqu’il s’agit du spectacle télévisuel, qui lui inspire, on l’a vu, les plus grandes craintes. Ces sentiments divergents quant au mélange entre vie et spectacle mériteraient certainement une étude à part entière ; nous insisterons plutôt sur la solution plastique adoptée dans Ginger et Fred, à savoir que cette continuité entre deux mondes hétérogènes est obtenue grâce à un élément chromatique qui se retrouve d’un plan à l’autre, du dedans de l’écran au dehors de la chambre.
Après la place occupée par la télévision dans le champ, c’est au tour de la couleur qui en émane d’offrir des indications potentielles en vue d’un investissement spatial du cinéma de Fellini hors de sa projection en salle, toujours, donc, à partir de ce qui survient à l’intérieur de ses propres images. Si nous devions résumer les paramètres qui définissent ce second cas, il y aurait à prendre en compte au moins trois points : le chromatisme qui caractérise dans son ensemble comme dans ses parties une séquence filmique ; la couleur des objets qui se trouveraient dans l’espace du musée où cette séquence serait projetée, espace qui pourrait lui-même être coloré (artificiellement ou pas) ; enfin, les teintes qui proviendraient d’un autre espace, mitoyen ou extérieur au précédent, et avec lesquelles les autres couleurs se mêleraient dans une relation de correspondance, comme c’est le cas dans la scène de l’hôtel de Ginger et Fred. Tous ces paramètres formeraient la base scénographique d’une exposition de Fellini dont les combinaisons prendraient de plus en considération les éléments architecturaux du lieu d’exposition : la couleur des murs, l’intensité lumineuse qui les baigne, le paysage urbain ou naturel que ses ouvertures – portes, fenêtres, verrière au plafond – donneraient à voir, etc. Il y aurait un autre paramètre encore à ne pas négliger dans cette perspective scénographique : le son, composante essentielle de la mise en scène fellinienne, dont il s’agit d’établir en quoi il se rapporte à la dimension spatiale, point de conjonction entre les films et leurs modalités d’exposition.
Reprenons suivant ce biais la séquence de la chambre d’hôtel ; celle-ci suit le moment où Ginger s’informe à la réception du numéro de sa chambre, information qu’elle a le plus grand mal à obtenir pour au moins deux raisons : d’une part, l’attention des employés de l’hôtel se concentre presque exclusivement sur ce match de football qu’ils suivent à plusieurs en commentant ce qu’ils voient ; d’autre part, le volume de la télévision est si élevé que tout le hall de l’hôtel est enveloppé d’un brouhaha crescendo qui culminera avec la clameur du public et des téléspectateurs lors d’un but dans le match visionné. Ginger parvient finalement à son étage et, suite à une rencontre impromptue sur le palier avec d’autres sosies d’Ed Ecco a Voi, elle pénètre dans sa chambre déjà ouverte par ce porteur de valises qui vient de s’y engouffrer précipitamment pour allumer la télé et reprendre le direct du match de foot. Cette dernière information n’est pas fournie par l’image, mais par le son, précisément. Un plan est éloquent à cet égard : tandis que Ginger quitte les deux sosies avec qui elle a échangé quelques mots, nous la voyons dans le couloir, la porte de sa chambre grande ouverte ; juste avant qu’elle y pénètre, nous ré-entendons pendant une poignée de secondes ce même chaos sonore provenant de la transmission du match, qui se représentera l’instant d’après à notre regard. Autrement dit, l’indication de la présence du spectacle sportif est sonore avant d’être visuelle, et là encore, Fellini use d’un crescendo significatif dans le volume : manière de créer la sensation d’un envahissement progressif et irrémédiable de l’espace par le son de la télévision, comme si la contamination par le bruit du couloir de l’hôtel était le prélude à la prolifération des images dont nous ferons l’expérience dans la chambre de Ginger. S’établit en ce sens un montage entre les composantes sonore et visuelle de ce fragment filmique, en même temps qu’une continuité initiée par le son de la TV se dessine qui relie deux espaces connectés mais séparés – le couloir et la chambre. Montage sonore et effet de continuité spatiale qui peuvent, une nouvelle fois, trouver un prolongement au musée, à condition de maîtriser l’acoustique des lieux, d’être aux aguets à la manière dont les sons qui émanent d’un ou plusieurs moniteurs « meublent » l’espace (comme il existe une « musique d’ameublement » chez Satie), en fonction, aussi, de la façon dont ils interfèrent entre eux dans un environnement de visiteurs.
Les films que Fellini a réalisés dans les années 1980 et où la télévision est si prégnante – Ginger et Fred, donc, Intervista (1987) puis La Voce della luna (tourné en 1989) – présentent ainsi implicitement une multitude d’instructions pour qui éprouverait la nécessité d’exposer son œuvre sans tomber dans les facilités d’un biographisme navrant (comme ce fut malheureusement le cas pour La Grande Parade, l’exposition consacrée au réalisateur italien présentée au Jeu de Paume en 2009). D’autres paramètres que ceux que nous avons essayé d’extraire de cet unique extrait de Ginger et Fred seraient mobilisés. Comme la taille des écrans, motif cher à Fellini, lié pour le cinéma à son « autorité, mystère, prestige, magie », avec son « écran gigantesque qui domine une salle amoureusement rassemblée devant lui, remplie de tout petits hommes qui regardent, charmés, d’immenses faces, d’immenses lèvres, d’immenses yeux vivant et respirant dans une autre, une inatteignable dimension, fantastique et à la fois réelle ». Tandis que la télévision a « un tout petit écran, petit comme un coussin, entre la bibliothèque et le pot de fleurs, parfois on le met même dans la cuisine, près du réfrigérateur »[77] [77] Fellini par Fellini, op. cit., p. 167. . De ce contraste entre supports d’images animées peuvent naître toutes sortes d’expérimentations dans un espace d’exposition, suivant que l’on explore une échelle des représentations visuelles, ou que l’on interroge les proportions actuelles de notre expérience des images, par exemple à travers la mode du home cinéma aujourd’hui. Home cinéma que Fellini avait d’ailleurs anticipé dans Intervista, dans la fameuse scène où Fellini décide de projeter sur un drap blanc la danse entre Marcello Mastroianni et Anita Ekberg réalisée pour La Dolce vita ; la scène se déroule vingt-sept ans plus tard dans le salon de la villa romaine d’Anita, en sa présence et celle de Marcello déguisé pour l’occasion en Mandrake[88] [88] Pour une analyse de cette scène où la « magie » du cinéma est approfondie au regard de la coexistence des temps qu’elle favorise, voir notre recension dans la revue May de l’exposition Federico Fellini – La Grande Parade, mentionnée plus haut. .

Intervista, Federico Fellini, 1987
Se trouve de surcroît questionné ici le dispositif de projection du cinéma, puisque le drap renvoie à un équipement qui a très tôt marqué le jeune Fellini : « Qu’était naguère pour moi le cinéma ? C’était une salle obscure avec à l’arrière un mur où se trouvait un tout petit carré d’où partait un faisceau lumineux qui s’élargissait sur un grand drap blanc », source du « pouvoir hypnotique » et de « sa silencieuse fascination »[99] [99] Conversation avec Federico Fellini, op. cit., p. 224. . Jean-Luc Godard avait questionné le dispositif du cinéma au regard de son histoire dans ses Voyage(s) en utopie, son exposition au Centre Pompidou en 2006 ; l’œuvre de Fellini revisitée spatialement pourrait relancer ce questionnement au niveau des effets que les éléments de la projection (le faisceau, la surface de l’écran, etc.), ensemble avec le film projeté, sont censés engendrer dans l’esprit du spectateur. Cette recherche inclurait d’autres supports qui serviraient d’écran et qui ne servent habituellement pas à la diffusion des images en mouvement : nous pensons en particulier à la transformation en télévision de la fenêtre du train que l’on suit dans la publicité pour Campari réalisée en 1984 par Fellini ; visiblement lassée d’un voyage qu’elle fait avec une personne qui ressemble à son compagnon, une femme s’empare d’une télécommande qu’elle dirige vers la fenêtre de son compartiment en zappant ostensiblement : défilent alors de multiples paysages qui se confondent avec des visions archaïquement reconstituées de sites touristiques archi-connus : les tombes de Pétra, les pyramides d’Égypte, quelques ruines romaines. Jusqu’au dernier changement de « chaîne » effectué par l’homme où, pour la plus grande joie de sa compagne auparavant exaspérée, surgit une bouteille de Campari illuminée devant le baptistère et la tour penchée de Pise en miniature. Si Fellini remet en scène le geste du zapping qu’il honnit – « un coup de pouce et nous réduisons au silence n’importe qui, nous effaçons les images qui ne nous intéressent pas » –, cette publicité propose aussi, à partir d’un changement de fonction de la vitre d’un wagon en TV, ce que l’on pourrait nommer une « fenêtre sur le dedans », autre façon encore de réduire l’écart entre notre monde intérieur, composé de clichés de toutes espèces, et ces mêmes clichés qui finissent par remplacer « pour de vrai » le monde réel. Fellini utilise dans cette forme brève publicitaire la fenêtre d’un train : pourquoi ne pas faire usage de la fenêtre d’un musée, pour accompagner avec Fellini, suivant un mouvement « procadent », d’autres stéréotypes qui traversent sa filmographie (toutes les idées reçues liées au bonheur conjugal, à l’information, au développement économique, etc.), ou d’autres encore qui nous concernent plus directement dans l’histoire présente ?

Publicité pour Campari, Federico Fellini, 1984
La nature de l’écran – sa matière, ses dimensions, sa place dans le foyer domestique ou l’espace urbain – est également auscultée par Fellini dans son dernier film, où c’est notamment le panneau publicitaire qui sert de support à la diffusion d’images en mouvement, comme le montre la séquence finale de La Voce della luna : sur la place principale d’un village où la lune vient de s’échouer, plusieurs écrans vastes comme des panneaux de type 4 x 3 (on en aperçoit beaucoup tout au long du film) transmettent l’émission télé qui suit en direct cet étrange événement d’une lune immobilisée près d’une grange perdue. La télévision se déploie maintenant en plein dehors et en polyvision, comme si c’était le village lui-même qui était devenu une gigantesque TV. C’est dans La Voce della luna, par ailleurs, que Fellini s’attache à scruter la manière dont la lumière produite par un téléviseur se diffuse dans l’espace d’un appartement ; dans une séquence terrible où deux petites jumelles s’agitent comme des automates devant ce qui semble être un téléfilm de science-fiction, il apparaît que le halo de lumière crue issu de ce qu’elles regardent dans la pénombre (et que nous ne voyons pas) les isole complètement de la salle à manger voisine éclairée par une lampe où se trouvent les parents. Si tout à l’heure nous avions une continuité entre des espaces distincts créée par un jeu sur les couleurs (la scène de l’hôtel dans Ginger et Fred), nous avons cette fois, à l’intérieur d’un lieu non cloisonné (un double séjour), un phénomène de rupture spatiale provoqué par la lumière blanchâtre d’une télévision qui opère cet inquiétant partage des générations dont le dernier Fellini était si soucieux.

La Voce della luna, Federico Fellini, 1989
Les entretiens de Fellini où transparaissent ses affects quant au devenir du cinéma sont certes indispensables pour comprendre la relation contrastée qu’il entretient au médium télévisuel ; nous les avons mentionnés à chaque fois qu’ils nous semblaient nécessaires au développement de notre hypothèse de départ : à savoir que ces affects sont inséparables de procédés filmiques où cinéma et télévision se rencontrent, et que ces procédés surviennent à chaque fois en traçant au fil des films une topographie fellinienne que nous avons cherché à mettre au jour de manière évidemment non exhaustive. L’exemple privilégié de Ginger et Fred et les quelques mentions faites aux réalisations qui ont suivi avaient surtout pour but de montrer que cette topographie – indissociable des motifs liés à la couleur, à la lumière, à la taille des écrans, aux dispositifs de projection, aux positionnements du poste de TV dans tel ou tel plan, etc. – contient en puissance des instructions pratiques pour que cette topographie puisse se déplier de manière neuve hors des films dont elle dépend pourtant.