Détournement de regards
Le téléspectateur de cinéma : Totally F***ed Up, Gregg Araki, 1993
« Tout changement en histoire du cinéma implique un changement dans la façon dont le cinéma s’adresse à son spectateur, et chaque période construit son spectateur d’une nouvelle manière.[11] [11] Tom Gunning, « Le Cinéma d’attraction : le film des premiers temps, son spectateur, et l’avant-garde », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 50 | 2006, mis en ligne le 01 décembre 2009, consulté le 04 janvier 2013. »
Tom Gunning
En 1993, le cinéaste indépendant américain Gregg Araki réalise un film en hommage à Masculin Féminin (Jean-Luc Godard, 1966), intitulé Totally F***ed Up. Volet inaugural de la Teen Apocalypse Trilogy, tourné sans budget, ce film « neo-underground » est présenté par son réalisateur comme « un regard honnête sur la vie d’adolescents gays, en lutte avec leurs identités émergentes, dans une décennie dominée par l’homophobie[22] [22] Cette citation et les informations qui l’entourent sont extraites du livret accompagnant l’édition DVD du film chez Strand Releasing en 2005 (je traduis). ». Influencé à la fois par la Nouvelle Vague française et la chaîne musicale MTV, TFU entrecroise les trajectoires de six amis dans un style pour le moins radical. Plusieurs régimes d’images alliés à des stratégies énonciatives diverses composent, en effet, un objet singulier, questionnant de manière aiguë la place du spectateur. Cet article voudrait interroger plus particulièrement les rapports entre cinéma et télévision qui semblent s’y jouer.
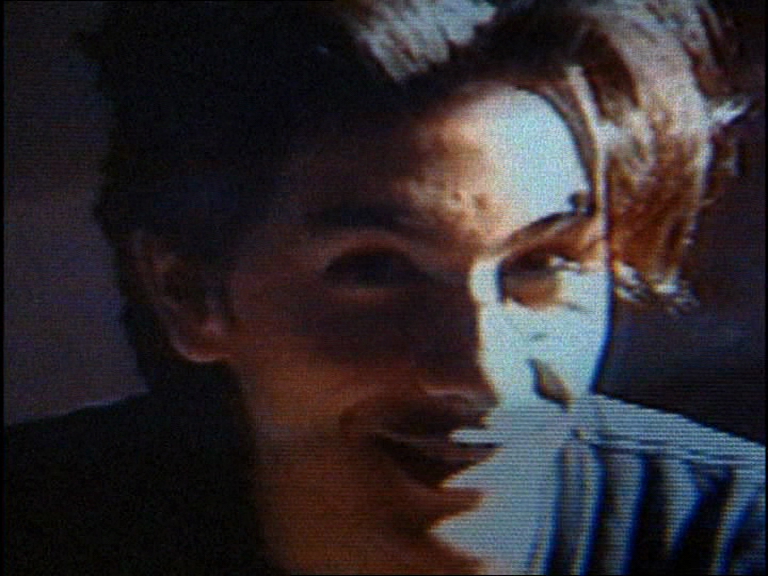
1. Le dispersion massive des écrans de télévision à l’intérieur de TFU conditionne tout d’abord le champ d’action des personnages. Araki surligne cette évidence : les écrans sont là pour être regardés, activement. Si les petites images cathodiques enclavées dans le cadre peuvent s’appréhender comme des indices, voire des indicateurs herméneutiques (c’est l’une des thèses – toujours fécondes – de Jean-Paul Fargier[33] [33] Voir par exemple « La Télévision pure », Ciné et TV vont en vidéo [avis de tempête], Lille, De l’incidence éditeur, 2010, pp. 17-32. ), la conséquence la plus directe s’exprime ici structurellement : les personnages du film d’Araki apparaissent régulièrement dans la position du téléspectateur, face caméra.
Âgés d’à peine vingt ans, ils partagent leur quotidien entre sexe, télévision, soirées oisives, concerts, errances urbaines, et la réalisation d’un documentaire. Steven, étudiant en cinéma et lecteur d’André Bazin[44] [44] Il possède un exemplaire de What is cinema ? Essays selected and translated by Hugh Gray. Volume 1, édité en 1968 par Berkeley University Of California Press. , réalise, en effet, une vidéo à partir d’un dispositif d’interviews croisées, dans le but de « montrer les choses telles qu’elles sont vraiment ». Ses amis passent donc, chacun leur tour, devant l’objectif et répondent à une série de questions sur l’amour, la masturbation, le sida, etc. Le résultat vise à proposer un instantané de la jeunesse homosexuelle de Los Angeles au début des années 1990.
De manière récurrente, les personnages de TFU apparaissent dans des postures liées à la part de passivité qu’impliquent leurs occupations : regarder la télévision, répondre au téléphone, écouter le répondeur, prendre le soleil, répondre à une interview, visionner des rushes, etc. Ces stations assises ou couchées sont, par ailleurs, entrecoupées de longues balades nocturnes. Il s’agit donc de personnages généralement pris dans des « situations optiques et sonore pures », pour reprendre les analyses de Gilles Deleuze sur le néo-réalisme italien, des personnages spectateurs, qui « enregistrent plus qu’il ne réagissent »[55] [55] Gilles Deleuze, « Au-delà de l’image-mouvement », Cinéma 2. L’Image-temps, Paris, Éditions de Minuit, « Critique », 1985, pp. 7-37. .
Bien que ces personnages ne soient pas constamment rivés au petit écran, le spectateur note facilement sa présence insistante, dans la chambre, le salon, la salle de bain, etc. Il la note d’autant mieux que la caméra d’Araki occupe souvent la même place que le poste, ce « meuble spécialisé[66] [66] Vito Acconci, « Télévision, meuble et sculpture : chambre avec vue américaine » [1984-90], in Nathalie Magnan (dir.), La vidéo entre art et communication, Paris, (énsb-a), 1997, p. 130. », c’est-à-dire au ras du sol. Le réalisateur positionne, en effet, sa caméra à un angle tel qu’il puisse contenir tous les corps dans une seule pièce, bien souvent la chambre exiguë de l’un des protagonistes. Par conséquent, quand les personnages regardent la télévision, virtuellement substituée à la caméra, ils paraissent regarder directement les spectateurs du film d’Araki.
2. Cette adresse frontale se retrouve également dans le documentaire vidéo, fragmenté à l’intérieur de TFU. Pour une meilleure compréhension, il faut ici distinguer provisoirement le travail de Steven du film d’Araki, en reliant certains choix formels aux vœux de l’étudiant. Le jeune homme adopte une forme d’interview invariante : il cadre ses amis en gros plan ou en plan rapproché épaules et leur demande de répondre en regardant l’objectif. Le regard à la caméra, traditionnellement proscrit du cinéma narratif, est ici encouragé car il s’intègre logiquement au projet documentaire. Steven réalise une vidéo sociologique (Araki reprend le modèle de l’enquête de Masculin Féminin) au sein de laquelle le regard dirigé vers le spectateur majore l’authenticité du matériau. Prenant le contre-pied de la proscription classique, le regard est là pour signifier « je ne joue pas », il place le sujet dans la posture – conventionnelle – de celui qui ne ment pas.
De fait, la succession de quelques fragments d’interviews, dès les premières secondes du film, paraît assez proche d’une forme de portrait collectif en vidéo, comme les screen tests d’Andy Wahrol ou le Cinématon de Gérard Courant ont pu en proposer sur film. Chaque interviewé se présente face à l’objectif : prénom, âge, puis quelques variantes d’un personnage à l’autre, surnom, études, etc. Mais le plus intéressant surgit à côté de ces réponses, lorsque Tommy éclate de rire, qu’Andy installe un long silence, ou que Michele et Patricia s’embrassent fugitivement, la valeur du portrait passant peut-être plus encore par ces instants impromptus, ces « rebuts », que par la valeur informative des réponses données. Ce regard venu de l’écran, c’est donc également celui du portrait photographique qui, dans TFU, se retrouve installé dans le temps, et mélangé à d’autres regards.
3. Si l’hétérogénéité du film d’Araki est manifeste, notamment à cause des chocs de texture film/vidéo, il faut noter que les cadrages majoritairement employés visent à regagner une certaine unité. À première vue, en effet, ils tentent de résorber une incompatibilité de support. TFU est intégralement tourné sur pellicule 16 millimètres. Pour intégrer les fragments vidéo au montage, Araki a filmé un moniteur les diffusant, d’où la présence d’un effet de balayage (résultat du décalage entre la vitesse d’enregistrement de la caméra et celle de diffusion des images). Afin, semble-t-il, d’éviter toute ambiguïté quant à l’énonciation mise en place, le réalisateur a sciemment escamoté les bords du moniteur pour ne « ponctionner » les images vidéo qu’à l’intérieur des limites du petit écran [voir la première image]. Si les bords étaient visibles, nul doute que le spectateur, même inconsciemment, identifierait le plan à une vue subjective et donc au point de vue singulier d’un personnage sur des images diffusées. Une fois « interpolées », les images enregistrées par Steven semblent tout à fait s’intégrer au film d’Araki. L’absence des bords visibles d’un moniteur supposément diégétique permet aux images vidéo d’épouser les limites du cadre. En conséquence, ces images sont affectées d’un faible coefficient de réflexivité[77] [77] Christian Metz, sur la figure du film dans le film, distingue plusieurs « degrés » de réflexivité. Voir « Film(s) dans le film », L’énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, pp. 93-111. , elles ne sont pas objectivées et le spectateur peut les appréhender sans relais, comme la matière même du film.
Le cadrage a donc ici vraisemblablement une fonction de raccord, de “continuisation”[88] [88] Jacques Aumont emploie ce terme pour caractériser le principe premier du montage cinématographique, subsumant à la fois raccord et intervalle. Voir « Clair et confus », Matière d’images, Paris, Images Modernes, « Cinéma », 2005, p. 121. , il crée un espace mixte et homogène, au sein duquel l’énonciation est donnée comme une variable : tantôt les personnages regardent les spectateurs substitués à l’œil mort du petit écran (le destinateur est absenté de lui-même), tantôt ils regardent les spectateurs substitués à l’œil – vidéo – de Steven (le destinateur s’offre au destinataire). En somme, le regard à la caméra recouvre ici deux attitudes rigoureusement distinctes. Soit il fait signe vers un retrait, une soustraction de soi, c’est le trope de la télévision comme hypnotiseur, soit vers un don, c’est le portrait comme offrande. Pour récapituler : que les personnages regardent la télévision (sur film) ou qu’ils répondent aux questions de Steven (en vidéo), ils regardent toujours directement les spectateurs du film d’Araki. Le regard à l’objectif agit donc comme le cadrage : il résorbe une différence de format, il suture film et vidéo.

4. Le cadrage global au ras du sol, celui des scènes sur film, répond, semble-t-il, à des exigences pratiques. Araki a tourné avec des non-professionnels, dans leurs lieux de vie mêmes. Pour les scènes d’intérieur, il a notamment filmé des chambres d’adolescents. Il est bien évident qu’une pièce d’une dizaine de mètres carrés où se retrouvent trois, quatre ou six amis ne facilite pas vraiment la variation de différents points de vue. À moins de privilégier les gros plans et la caméra portée, cette variation se heurte assurément à un problème de recul. Cependant, rien n’empêchait de rejouer la même scène en faisant varier, pour chaque version, la place de la caméra – au risque de contrarier la spontanéité des échanges dans le montage final. Quoiqu’il en soit, Araki a privilégié l’unité de vue.
La plupart de ces scènes de chambre dégagent une impression d’intimité, en partie provoquée par leur confinement spatial (la teneur des conversations joue bien évidemment à plein dans cette impression, tout comme les postures lascives, la consommation d’alcool, la musique, la lumière du petit écran, etc.). Systématiquement, la profondeur de champ se trouve court-circuitée, soit par un mur dans le fond de l’image, bien souvent recouvert d’affiches, soit par le plafond mansardé quand la caméra, toujours au ras du sol, opère une contre-plongée plus accusée. La caméra, qui prend la place de la télévision, met donc en visibilité des corps cloisonnés dans ce qui ressemble à une boîte, ouverte sur un côté, celui de l’écran de télévision (c’est-à-dire celui du spectateur). Il y a là comme un effet de symétrie : deux boîtes contiguës, reliées entre elles par le cadre d’un écran.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de rappeler que parmi les exigences des premiers concepteurs de programmes télévisés, américains comme français, on constate une volonté de refonte du langage cinématographique – au regard duquel se conçoit celui de la télévision – en vue de l’adapter au mode de consommation spécifique du téléspectateur. En effet, le téléviseur, de taille réduite et situé dans les pièces à vivre (salon, salle à manger, cuisine, chambre, etc.), se regarde à faible distance, seul ou avec ses proches, dans l’intimité. C’est pourquoi les « pionniers » ont mis en place, grâce au gros plan de visage, à la voix, au regard, à l’investissement virtuel de l’avant-champ, etc., un mode de communication censé à la fois extraire le téléspectateur de son environnement parasitaire et épouser son intimité. Entrer dans cette intimité non pas comme un intrus mais bien plutôt comme un complice, voire un membre de la famille[99] [99] Je renvoie à l’ouvrage de Gilles Delavaud, L’art de la télévision. Histoire et esthétique de la dramatique télévisée (1950-1965), Paris, Éditions de l’INA, « Médias Recherches », 2008. .
5. Georges Sadoul écrit à propos des films de Georges Méliès : « l’unité de vue [y] conditionnait obligatoirement l’unité de point de vue[1010] [1010] Georges Sadoul, « L’École de Brighton et les débuts de Pathé », Histoire du cinéma mondial. Des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1949, p. 43. (9ème ed.) ». Bien que les féeries du Maître de Montreuil-sous-Bois soient le résultat d’un montage savant voulu imperceptible, comme l’a bien souligné André Gaudreault[1111] [1111] André Gaudreault, « “Théâtralité” et “narrativité” dans l’œuvre de Georges Méliès », in Madeleine Malthête-Méliès (dir.), Méliès et la naissance du spectacle cinématographique, Paris, Klincksieck, 1984, pp. 199-219. , le point de vue unique du « Monsieur de l’orchestre » y est, en effet, sciemment privilégié. Le prestidigitateur Méliès conserve dans ses films la distance moyenne séparant le spectateur de la scène.
Tom Gunning a opéré une distinction entre le « cinéma d’attraction » – auquel appartient Méliès – et le cinéma narratif, sur base du couple conceptuel : « confrontation exhibitionniste » contre « absorption diégétique ». L’historien ne cloisonne pas hermétiquement les deux pôles, le premier est majoritaire entre 1895 et 1907 puis, au-delà de la grande « phase de narrativisation » emblématisée par D. W. Griffith, il apparaît comme une composante ponctuelle à l’intérieur de films narratifs, particulièrement liée à certains genres, encore d’actualité (comédie musicale, film d’action à grand spectacle, pornographie, etc.)[1212] [1212] Tom Gunning, art. cit. .
S’il peut sembler un tant soit peu surprenant de convoquer cet appareillage au sein d’une étude consacrée à un film de 1993, cela n’est qu’en vertu d’une conception platement téléologique de l’histoire du cinéma.
Rendant à l’anachronie toute sa fécondité théorique, le concept dynamique de survivance[1313] [1313] La survivance comme présence résiduelle de formes passées à l’intérieur de représentations présentes et « modèle de temps propre aux images » (p. 82) a été copieusement commentée par Georges Didi-Huberman, à partir des travaux d’Aby Warburg, dans L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Éditions de Minuit, « Paradoxe », 2002. Je souligne également l’usage éclairant qu’Édouard Arnoldy fait de ce concept à propos d’un film de Jean Renoir dans À perte de vues. Images et “nouvelles technologies” d’hier et d’aujourd’hui, Bruxelles, Labor, « Images », 2005. est, en effet, à privilégier pour embrasser les différentes conséquences de la dispersion des écrans de télévision dans TFU. La caméra substituée à l’écran de télévision, point de fuite du regard des personnages, met en visibilité un espace fermé, non morcelé : le contre-champ impossible de la télévision – reverse television[1414] [1414] Je reprends ici le titre d’une bande célèbre de Bill Viola : Reverse Television – Portraits of Viewers (1983-1984). . L’unité de vue y conditionne l’unité de point de vue, pour reprendre le mot de Sadoul, à ceci près que ce point de vue est ici celui – désincarné – du téléviseur. La distance entre le « Monsieur de l’orchestre » et la scène est devenue la distance entre le petit écran et le téléspectateur. En outre, l’itération du regard à l’objectif installe une résistance – contre laquelle s’emploie la proscription classique – visant moins l’absorption que la confrontation du spectateur. Si le regard à l’objectif est un outil indispensable au mode de communication télévisuel, garantissant un contact électif avec le téléspectateur (« de vous à moi »), il pointe, selon Gunning, lorsqu’il est exporté au cinéma, un index malheureux sur le spectateur dissimulé dans la salle obscure, ne pouvant dès lors plus jouir du voir-sans-être-vu.
Commenter un film de la fin du vingtième siècle en questionnant le champ de pertinence de ces théories ne doit évidemment pas éluder le problème de l’historicisation du mode de consommation des images en mouvement. Si Gunning propose le terme « cinéma d’attraction » pour caractériser une communauté de films avant 1907, il faut bien noter que ces films s’inscrivent plus largement dans ce qu’André Gaudreault et Philippe Marion nomment le « paradigme de la monstration », au sein duquel prennent également place divers numéros de variétés, dont les spectacles de prestidigitation[1515] [1515] André Gaudreault et Philippe Marion, « Le cinéma naissant et ses dispositions narratives », in Cinéma & Cie. International Film Studies Journal, n°1, automne 2001, pp. 34-41. . Si l’interdit du regard à la caméra est valable au sein d’un autre paradigme, celui de la narration, c’est que le mode de consommation des films avant 1907 ne se fonde pas sur l’exigence d’un cloisonnement redoublé entre le public et les images animées. Au contraire, les films, programmés dans les music-halls, les café-concerts, etc., s’intègrent dans un réseau d’échanges hic et nunc entre les chansonniers, les acteurs, les mimes, etc. et un public qui n’hésite pas à se manifester.
Il serait donc judicieux de s’interroger sur la consommation des films en 1993 pour essayer de spéculer sur une définition possible du « dispositif[1616] [1616] La notion de « dispositif » s’entend ici comme « l’interrelation entre une technologie, un mode de présentation, un mode d’adresse, une forme filmique et un positionnement de l’instance spectateur ». J’emprunte la définition à Frank Kessler dans son article « La cinématographie comme dispositif (du) spectaculaire », in Mélanie Nash et Jean-Pierre Sirois-Trahan (dir.), CiNéMAS. Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps), Montréal, vol. 14, n°1, automne 2003, p. 25. » en jeu et d’envisager ses conséquences sur la place du spectateur, ménagée en creux, dans le film. S’il faut, en effet, considérer les habitudes de consommation qui bordent le film d’Araki à sa sortie, il est un écran de taille qui le partage au cinéma, tendant même à s’y substituer, c’est bien évidemment la télévision. La mise en scène du personnage de cinéma en téléspectateur accuse un renversement spéculaire pour le moins intéressant dans la mesure où ce point aveugle est précisément montré depuis la distance – peut-être faudrait-il écrire : depuis la proximité – qui sépare le téléspectateur de son poste. Si Méliès ne résorbe pas l’écart spectateur/scène dans ses films, Araki, pareillement, conserve l’écart téléspectateur/téléviseur dans le sien. Une même attitude semble ici se dessiner, qui place le cinéma comme point de mire. Regarder un film comme l’on regarde un spectacle de prestidigitation ; regarder un film comme l’on regarde la télévision. Mais – réversion oblige – chez Araki, ce film regarde ceux qui regardent la télévision. La « confrontation exhibitionniste » est ici une relation entre deux espèces de spectateur et l’attraction, si tant est qu’elle subsiste, repose toute entière sur le dévoilement d’une intimité. À ce propos, un plan figurant l’un des six amis, Tommy, se masturbant devant un film pornographique est tout à fait révélateur.
TFU est un film qui a priori contient la prescription de son mode de consommation, un film-symptôme qui, en substance, révèle ceci : en 1993, puisque le cinéma se consomme massivement sur le poste de télévision, il apparaît logique que les films s’adaptent aux conditions du cercle privé et, par conséquent, se modèlent sur le langage télévisuel. D’où la récurrence, dans la vidéo de Steven comme dans le « film d’accueil[1717] [1717] La terminologie « film interpolé »/« film d’accueil » est empruntée à Nicole Brenez dans son article « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental », in Elena Dagrada (dir.), CiNéMAS. Limite(s) du montage, Montréal, vol. 13, n° 1-2, automne 2002, pp. 49-67. », des gros plans de visages, des regards dirigés vers l’objectif, des espaces clos, etc. assurant un contact serré avec le (télé)spectateur, non pas en salle mais chez lui. Il n’y a là aucune réflexivité critique, plutôt un constat pragmatique. Cependant, TFU ne saurait se résumer à un simple exercice de « formatage ». Si le film d’Araki paraît s’arc-bouter à un mode de consommation exogène, il invente surtout de nouvelles formes, à partir des habitudes du téléspectateur.

6. Sur le modèle de Masculin Féminin, TFU se structure en quinze fragments aléatoires (« random celluloid fragments »), ponctuellement annoncés par un bref carton[1818] [1818] À ceci près qu’il ne s’agit pas de « fragments aléatoires » chez Godard mais de « faits précis ». La différence est significative. . Les chiffres, les mots, parfois même leurs formes combinées (« 5ive »), sur fond noir, y sont comme modelés dans la neige télévisuelle. Chaque inscription de cette matière vibratile est accompagnée par un grésillement agressif, au sein duquel l’oreille se surprend à deviner des voix gangrenées de parasites. Ce mode de succession abrupt n’est pas sans évoquer le zapping, le passage instantané d’une chaîne de télévision à une autre entraînant parfois des incursions inopinées sur quelques canaux indisponibles.
En outre, la structure narrative du film, éminemment elliptique, semble convoquer cette pratique de la discontinuité. Chacun des six personnages trace une ligne particulière au sein du récit. Le film forme une série de lignes dont le spectateur ne prend connaissance que par portion. Parfois, les lignes se croisent et deux, quatre, ou six personnages se réunissent dans un même espace-temps. Le spectateur ne possède donc qu’une vision lacunaire des événements racontés. Les seuls épisodes agencés selon une progression narrative pleine sont introduits par un carton signalant une plage relativement homogène, au sein de la structure éclatée du film (« Start narrative here »).
Chaque changement de scène accompagne à la fois un changement de personnage(s) et un changement de musique. À chaque scène adhère une chanson précise, entendue à un certain point de son déroulement. Par conséquent, chaque scène visible pour le spectateur apparaît comme un morceau prélevé sur une totalité supposée, une coupe effectuée dans le flux d’une scène/chaîne virtuelle. TFU est ainsi structuré en canaux, le spectateur passant d’une scène à une autre comme il ferait d’une chaîne à une autre devant son poste de télévision. La télécommande, cet « instrument de déconstruction[1919] [1919] Dominique Château, « L’effet zapping », in Communications. Télévisions/Mutations, Seuil, n°51, 1990, p. 52. », est ici virtuellement remployée comme un opérateur de narration. Ce faisant, Araki transforme une pratique dominée par la contingence en principe d’agencement dramatique. Par exemple, lorsque Steven trompe Deric, le réalisateur prend soin de montrer Steven au lit avant de filmer son petit-ami, inquiet et prostré. Sous une apparence d’arbitraire, il est donc entendu qu’une nécessité préside à cet éclatement.
Aux plans « zappés » se juxtaposent, par extraits, la vidéo de Steven, et d’autres fragments refilmés (publicités, émissions télévisées, films, discours politiques, etc.). Le zapping, s’il semble commander la structure narrative, se devine tout aussi bien dans cette variété de régimes d’images.
Enfin, les paysages nocturnes sont dévorés par des panneaux publicitaires gigantesques que le réalisateur filme frontalement, de façon à remplir complètement le cadre. Par l’emploi de ces grands aplats, Araki sédimente l’espace en couches superposées et remplace la profondeur de champ traditionnelle par une « épaisseur d’images[2020] [2020] Philippe Dubois, « Pour une esthétique de l’image vidéo », La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, Crisnée, Yellow Now, « Côté Cinéma », 2011, p. 90. », typique de l’habillage vidéo des chaînes de télévision. Les personnages déambulent d’un paysage à un autre, d’une publicité à une autre, sous l’œil d’un (télé)spectateur dépossédé de sa télécommande.

Le clivage entre le modèle théorique du spectateur de cinéma soumis aux effets de l’ « appareil de base »[2121] [2121] Je fais référence ici aux analyses de Christian Metz et Jean-Louis Baudry sur la métapsychologie du spectateur de cinéma, dont Frank Kessler, dans l’article cité, souligne le « manque absolu d’égard pour l’historicité de [leur] objet ». et celui du téléspectateur interpellé sur le mode de la confidence est manifestement réinterrogé par le travail d’Araki. En détournant le regard des personnages vers l’objectif de la caméra, les écrans dispersés permettent donc, avant toute chose, d’établir ce constat : les habitudes de consommation, en constante métamorphose, renouvellent les processus créatifs et la forme même des films. Entre cinéma et télévision, TFU s’éprouve comme le site d’un chevauchement entre le paradigme de la narration et celui de la monstration, et engage à esquisser un nouveau modèle de spectateur de cinéma, fondé sur l’atomisation et l’hybridation des modes d’accès aux images animées.






