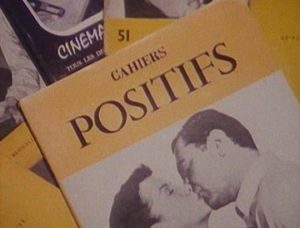Criticon
Vol dans les plumes

Quand le critique n’a rien à se mettre sous la dent, il ronge ses propres mots, suce son encre, se mord la plume. Et, les yeux fixés sur le plafond où se trouve projetée l’image de son ennui, il interroge son verbe en des termes pesants : mais que fais-je donc quand je crache du langage sur de la lumière, quand je coffre un film dans un discours qui, s’il en relance le souvenir, n’en ligote pas moins le sens ? Complexe de l’amant : cet être pour lequel je soupire, j’en fixe l’image pour en épingler le bonheur ; l’amateur de films qui écrit sa philia et l’amateur d’amour qui expose son eros ne font tous deux que dans l’effigie.
Heureusement le critique, homme affairé, ne croise que rarement ce démon de minuit. Sa tâche le divertit de lui-même ; ses jours sont à la mitraille de mots tirés sur les bobines, aux distributions de blâmes et de prix. Il a fort à faire, lui douanier, aiguilleur, greffier de la mémoire, vigie aux yeux scrutés sur le nouveau. Et si dans chaque film il aime à déceler le spéculaire et autres mises en abîme – c’est là le tic du regard critique, voir dans le regard que le film porte sur le monde un regard retourné vers lui-même, regard au carré d’un cinéma qui dissèque son propre œil –, il n’applique que trop rarement à lui-même la recette de ce dédoublement. La critique de la critique, à force de se rogner elle-même, a fini par passer de mode.
Mais parfois la plume s’enraye, si crasseuse qu’elle est à force d’encrer les films. Alors pour faire mine de la nettoyer, le critique pond un Criticon comme celui-ci, en hommage au Satiricon de Pétrone (l’histoire en est la même : lettrés précaires et avinés discourant sur le destin du verbe, errance de la lettre, divorce de la critique et de son objet). Ouvrage qui, rappelons-le, est une vaste farce.
***
Définition a minima : la critique, c’est un plus, un bonus, un supplément. C’est le dessert, ou l’accompagnement (texte-frites avec film-steak). C’est saupoudrer de mots des images sonores, les napper d’une sauce verbale pour en relever le goût. La critique comme assaisonnement.
Définition trop facile, trop réduite. On sait bien que la critique est aussi une gare de triage (en grec, krinein : séparer, choisir, discerner) : elle oriente vers la renommée ou l’oubli, décerne des titres, recouvre l’œuvre d’une qualification qui y reste incrustée. C’est le b.a.ba de l’histoire de l’art, qu’elle est autant histoire des jugements et regards que des productions – bien mieux, qu’elle est l’histoire de l’entremêlement de deux productions, celle des œuvres et celle des discours, époux s’enfantant l’un l’autre. Critique-prisme : il faut entendre au pied de la lettre l’idée qu’elle éclaire les œuvres : pas de visibilité de celles-ci sans la lumière que la première jette sur elles ; pas de luminosité qui ne soit découpe, sélection interne à l’œuvre. Le regard enrichit autant qu’il soustrait. Toute œuvre alors a deux noms d’auteur, voire plus : Rossellini-Bazin, Godard-Daney, Sopranos-Burdeau. C’est déjà dire qu’il s’agit moins d’un assaisonnement que d’un revêtement.
Nouvelle définition possible : regard sur un regard, ou regard dans le regard, regards enchâssés. Seulement, ces regards diffèrent en nature : texte versus film – la critique comme traduction, transsubstantiation. Un point commun, l’impression : de l’encre sur le papier (ou points noirs sur un écran blanc), de la lumière sur la pellicule. Daney disait qu’écrire, c’est réécrire – réimprimer – par dessus l’impression causée par le film. Amoureuse alchimie : telle est la critique, saisie verbale d’un saisissement visuel. À elle alors de dire ce qui fait le(s) sens.
Mais c’est encore trop peu : la critique est aussi analyse, soit, étymologiquement, déliaison, démontage, dépiautement. Elle est ce mode de discours qui s’origine dans l’exégèse biblique et parcourt depuis des siècles toutes les métamorphoses du commentaire : discours-relais, qui décrypte et déchiffre, élucide, déploie un sens encagé dans l’œuvre, où il ne se dit qu’à travers un voile que le langage critique prétend lever. Une glose pour une gnose : ainsi pourrait s’entendre le rapport de la critique à son objet : révélation d’un mystère, réordonnancement de l’œuvre sur le mode d’un discours raisonné (ce qui ne veut pas dire rationnel : la critique mystique se porte bien), comme si le langage avait la prérogative de l’anatomie (il expose le squelette de la chose-chair). La critique comme arraisonnement – c’est le principal reproche qu’elle encourt.
Difficile, en réalité, de définir la critique. On cherchera ces limites moins dans le définitionneur que dans le définitionné. Trop d’éléments s’y croisent – fonction sociale, fonction cognitive, fonction scripturale, fonction épidictique, qui toutes ne se superposent que bien mal – pour en faire une catégorie de discours aux contours nets, à la formule spécifiée. Le discours littéraire a sa loi : l’intransitivité. Le discours universitaire a ses règles et canons, ses codes, son champ. Le discours critique, lui, est un objet flottant, au statut insituable ; on aimerait en faire le bel hybride né des noces de la littérature (dont il reprend l’exigence verbale, le désir de style) et de l’université (soit le règne de l’objet, du discours second), mais ce serait lui conférer une triste position de rejeton contre-nature – et puis, chronologiquement comme logiquement, il ne vient pas à leur suite. Il n’a même pas la chance, que ses deux frères partagent, de pouvoir confondre sa logique avec la fonction de son lieu, la presse, c’est-à-dire l’information : celle-ci, il la déborde amplement, puisque son but est de faire voir plutôt que de faire savoir – raison pour laquelle si peu de critiques sortent d’écoles de journalisme.
Il faut en plus rappeler cette évidence : la critique n’est que l’extension textuelle d’une activité quotidienne à laquelle tout le monde se voue, du bûcheron finlandais au mandarin chinois en passant par la ballerine russe, soit l’exercice de la faculté de jugement. Bref, la critique n’est pas une spécialité, c’est la chose du monde la mieux partagée. D’où l’absence de qualifications précises pour prétendre en exercer le magistère : pas de diplômes bien sûr, pas même un savoir déterminé, juste un regard entraîné et une aisance verbale.
Malaise dans la critique : activité à la fois humble, parce que seconde, et prétentieuse, parce qu’énonçant des arrêts ; occupation qui se justifie plus d’une pulsion critique que d’une demande sociale (combien la révoque en l’accusant d’être une infâme médiation entre un film et son public ?) ; pratique aux contours flous (tout discours est critique, par définition), aux institutions fluctuantes, au public indécis, pratique que ne régit aucune loi (pas même l’absence de loi dans laquelle se reconnaît la littérature) et qui pourtant aspire à légiférer.
***
Fracture de la critique : elle est sous le coup d’une double postulation, écartelée entre deux modes du jugement, celui qui évalue, celui qui analyse. Souvent l’un repose sur l’autre, l’analyse induit une axiologie, l’évaluation s’appuie sur un argumentaire. Mais il y a bien deux pôles, l’un ayant nom feuille de chou, l’autre Blanchot. À la critique se disant « grand public » (étrange dénomination, puisqu’elle infantilise ce même public) le premier de ces deux bouts : critique culinaire, « film comestible », « film indigeste », faisant de l’œil un estomac – on recommande un film comme on recommande un restaurant. L’autre critique, elle si schizophrène dans son rapport au public (préféré averti), aime à se poser comme duplicata, écriture verbale apposée sur une écriture filmique, répondant à une beauté brute par le raffinement d’un discours qui en détaille les contours et la mécanique. C’est l’idéal défini par le duo Barthes/Blanchot : critique qui suspend tout jugement pour ne montrer que le travail de l’œuvre, le problème d’où elle vient et l’avenir de ses effets : critique qui n’est pas un goût mais une coupe (dans la forme, dans le temps de l’art). Critique qui distille et aromatise le sens : si la première est culinaire, celle-ci est éthylique : pour tout but, l’ivresse du lecteur, grisé par un propos qui ravive les saveurs du film.
Or il y a, en plus d’un écart du jugement, une différence d’ambition entre ces deux critiques. La première est une modeste police du goût, une sorte d’agent de circulation. La seconde se nourrit d’orgueil : les textes qu’elle confectionne, elle les voudrait souvent d’une facture aussi ouvragée que celle des objets qu’elle se donne, ayant soin d’elle-même autant que du film qu’elle caresse de son verbe. De là son titre de critique d’art, qui s’entend doublement : critique qui regarde l’œuvre comme produit à la fois d’un artisanat et d’une volonté d’art ; mais aussi critique qui se pense elle-même comme art, qui prétend s’élever à la hauteur de ce qu’elle aborde. « Critique artiste », disait élogieusement Deleuze dans sa lettre-préface au Ciné-journal de Daney.
Cela dit assez bien la double nature de cette critique-là, c’est-à-dire aussi l’ambivalence de son rapport aux œuvres. Le texte critique est à la fois arrimé et autonome ; il n’existe qu’en référence à un autre texte, filmique ou non, mais se voudrait souverain. Il est à la fois second et premier. Preuve de ce paradoxe, le fait – toutefois rare – que certains textes critiques aient connu une pérennité refusée aux œuvres sur lesquelles ils s’appuyaient (exemplairement, ceux de Rivette et Daney sur Kapo). Ce clivage est le refoulé de la critique. Il est aussi ce qui éclaire sa position problématique au sein du milieu : car tels sont les critiques dans le monde du cinéma, engeance honnie et courtisée, à la fois centraux et satellitaires, parasites nécessaires en ce qu’ils sont les pièces maîtresses de la circulation des films et en même temps les seuls, dans tout ce petit monde, à ne pouvoir tirer à eux l’auréole de la production. Ils sont gens de l’extrême-aval, ceux qui viennent après et ne font rien que (rece)voir. Derniers, et premiers, parce que le regard qu’ils jettent contamine les yeux de tous : entre-deux, interface que les vieux rêves d’immédiation hantant l’humanité aimeraient liquider.
***
Tribune, tribunal, tribalisme : les trois péchés de la critique. Hélas, ils n’ont pas de vertus contraires bien définies, qu’on pourrait établir positivement à partir de l’interdit de ces vices. Le champ de la critique est, par principe, dé-réglé.
Tribune : la critique n’est en rien un art éditorialiste, c’est-à-dire une pratique de la promotion d’idéologies. Combien de films dressés en étendards de causes qu’ils ne défendent qu’à peine (causes cinématographiques ou politiques), combien de textes qui lâchent leurs objets pour aller batailler ailleurs. Il est vrai qu’historiquement ce vice a dominé, même chez les plus grands, surtout chez les pionniers : chez Moussinac ou Delluc, Gance ou Canudo, la critique d’un film est la défense d’une idée du cinéma qui est elle-même vision de la société. Bazin a continué ce jeu plus discrètement, en donnant à son axiologie le masque d’une ontologie. Les Cahiers version lacano-maoïste s’en sont donnés à cœur joie avec leurs dazibao. La donne a changé, parce qu’on ne fait plus ouvertement commerce d’idéologies, mais la passion de l’élargissement du jugement se fait encore sentir ici ou là.
Tribunal : le tic critique par excellence, juger un film à partir du Cinéma. Tic propre au paradigme de l’Art dont le romantisme a accouché et dont nous ne sommes toujours pas sortis, tic postulant une essence sur laquelle devraient se régler les existences : le Cinéma comme loi, les films comme confirmations ou infractions. Les jeunes Turcs des Cahiers excellaient dans cette pratique. Godard la perpétue lorsque, dans les Histoire(s), il déclare qu’il y a de plus en plus de films et de moins en moins de cinéma. Fiction théorique dommageable, qui dans la différence ne voit que des écarts, des manquements, et qui là encore n’appréhende le film que depuis une position d’extériorité.
Tribalisme : pas les copinages entre critiques, ou les alliances avec les cinéastes, mais l’école, la secte, mélange d’un corpus cinématographique et d’un corpus idéologique. Ainsi du macmahonisme, ou de la vendetta Cahiers/Positif. Péché peut-être plus véniel que les deux autres, puisqu’après tout, une école, c’est une sensibilité, ce qui définit tout homme et tout regard. Mais celle-ci dont il s’agit ici est résolument fermée, avec un horizon d’attente immuable. Encore une fois, l’extérieur décide du sort du film.
Seulement, ces trois péchés ne sont pas des accidents de parcours : ils sont à l’origine même de l’instauration historique de la critique. Celle-ci a eu pour première motivation une « Défense et illustration » ; s’y sont toujours mêlés une idée du monde, une idée de l’art et un principe de côterie. C’est dire qu’elle s’est inventée en premier lieu, sous couvert d’une simple connoisseurship, comme levier politique. Ces trois péchés d’extériorité se comprennent par son lien d’intériorité au socius : la critique, c’est un truisme, se présente avant tout comme principe de répartition, partage des places, police. Cela, tout du moins, à l’âge des critiques de références, des positions de déférence et des valorisations de préférences, bref à un moment, historiquement déterminé par la presse papier, où les places de critique étaient elles-mêmes comptées, localisées, identifiables. Coordonnées qui se brouillent avec l’apparition de la critique internautique. La chance de celle-ci, c’est peut-être de pouvoir se défaire de ces trois vices qui gangrènent sa sœur de papier.
***
Internet est porteur d’une bonne nouvelle : la critique est en passe de cesser d’être un métier. Qui dit inflation de pages dit dévaluation des gages. Il y a bien les vieilles forteresses et leur soldatesque de pigistes, il y a bien encore, ici ou là, moyen de troquer des mots contre du numéraire ; mais dans l’ensemble, pas de quoi remplir un frigo. La jeune critique (est-ce une catégorie ? Non, juste un pot-pourri générationnel, une étiquette statutaire plutôt qu’une école théorique) le sait bien, pour être déboutée par les rois du papyrus, et se trouver acculée au http : là, dans le royaume virtuel, le si facile droit à la parole se paie d’un don égal de la part du critique, qui livre son verbe sans frais. La moins jeune critique semble le savoir aussi, plus confusément peut-être, elle qui à l’occasion tonne contre les « blogueurs » (nonobstant l’évidente différence entre revue et blog), casseurs de métier, mauvais doubles de leur propre fonction, vite cantonnés dans le pâle domaine de l’amateurisme (étrange accusation : car il n’y a pas d’autre définition qui vaille de l’activité critique : un art d’aimer, Douchet dixit – en dehors de cela, rien pour la cerner, ni règles, ni qualifications, ni même savoir). Elle les brocarde tant et si bien, aidée par une hiérarchie symbolique qui survit à son renversement concret (le papier, on le sait tous, ne tardera pas à définitivement brûler), qu’on ne peut pas ne pas y détecter une angoisse face à cette pullulation de plumes qui, essaimant partout, brouillent les contours de la profession, au point de mettre en cause l’idée même qu’il puisse s’agir là d’un métier.
Voilà ce que représente Internet : la fin de la valeur d’échange, la rupture de l’équivalence mots/money. On peut bien l’accuser d’être un facteur de pollution intellectuelle, il est surtout vecteur de déflation monétaire. Car le papier, malgré les écarts entre écoles, grâce à la diversité des formats supposément adaptée à l’hétérogénéité du public, produisait un marché ne survivant que d’être limité ; Internet penche plutôt vers le potlach ou la braderie, pur espace du troc et du don. La circulation de valeurs s’en trouve chamboulée. Tel est le scandale : qu’on ne puisse plus payer de mots, ni payer des mots.
Mais le problème ne s’arrête pas là. Le but n’est pas de chanter une soi-disant indépendance critique en faisant valoir l’argument que, puisqu’on ne vit plus de sa plume, celle-ci, libérée des attaches salariales, s’envole d’autant mieux. Mieux vaut marquer que l’idée même de profession en prend un coup. Elle était, à vrai dire, déjà entamée : qu’était-ce qu’un critique, sinon un homme qui a le goût pour qualification et le jugement pour fonction ? Pas de quoi faire un boulot : on connaît l’aphorisme de Truffaut, disant que chacun en France avait deux métiers, le sien et celui de critique de cinéma. Ce qui voulait dire que la seule garantie de professionnalisme était, drôle d’inversion, le salaire : un critique était critique parce qu’il était payé, et non pas payé parce qu’il était critique ; aux émoluments d’instituer le rôle – question de crédit, dans tous les sens du terme. Peut-être est-ce ainsi qu’il faut comprendre le fait que, parmi les reproches les plus récurrents à l’égard des critiques internautiques, se trouve celui de « subjectivisme » : accusation qui ne s’appuie sur rien en termes d’écriture, mais qui renvoie à un système de places sociales : au salaire d’objectiver le critique (classique équation hégélo-marxiste : c’est en payant un produit qu’on lui donne une valeur objective/collective). Mais alors l’objectivité dont se réclament ces détracteurs ne s’entend que du point de vue marchand – elle ne concerne en rien le contenu de leurs produits verbaux.
On aimerait prophétiser, dire que bientôt la critique ne sera plus une profession. Cela ne l’arrachera pas pour autant au mercenariat (l’argent n’est pas la seule attache : combien de copinages et d’alliances se forment par les textes ; et puis travaille aussi, et d’autant plus que le capital se désengage, l’échange symbolique, la vieille affaire de la reconnaissance), cela pourra tout du moins lui permettre de reformuler sa pratique. Elle ne sera plus métier, mais simple activité, occupation pour oisifs. Elle trouvera peut-être d’autres formes d’expression, de nouveaux modes discursifs. Et puis elle sera rappelée à sa modestie orgueilleuse que son insertion dans les circuits de la presse avait tenté de gommer : modestie de n’être qu’une appréciation, orgueilleuse dans sa prétention à l’expression. Qu’on ait deux siècles durant payé des gens pour cela passera dans quelques décennies pour une bizarerrie d’époque.
***
Le mot a été lâché : marché. Mot-mana, certes, aux usages trop élastiques pour n’être pas douteux, mais dont on aurait du mal à faire l’économie. Marché double à vrai dire : d’une part celui de la critique en soi, commerce d’opinions, échange de vues, tout l’étalage des doxas ; mais aussi, plus grand, comme son macrocosme, le marché des films sur lequel le premier se branche et qu’il régule en partie (même si l’on sait tout le gouffre existant entre succès critique et succès critique). C’est seulement par cette insertion que la critique, distribution de prix, trouve son assise économique. De là sa double face, sa fêlure interne : jugement de goût d’un côté, simple expression d’une idiosyncrasie, de l’autre production de valeur, plus-value symbolique apportée au film, avec l’espérance qu’elle se transforme en manne financière. Or, on se doute qu’il y a rapport inégal entre ces deux faces, que si la critique se paye et se publie, c’est d’abord en raison d’une demande marchande (ou sociale, mais la frontière est poreuse). L’institution – gestion des goûts et de la circulation – est antérieure au contenu.
Cela non pour portraiturer le critique payé en esclave de son salaire et de son rôle, simple marionnette agie par le Capital, pauvre agent de la superstructure idéologique – ce serait user d’un bourdieusianisme de bas étage. Mais voilà : longtemps, limitation de la presse papier oblige, il y a eu osmose ou isomorphisme entre les deux distributions, des œuvres et de la critique, identique système de places (avec toutes les révolutions symboliques et autres possibles réorganisations du champ) garanti par un tirage compté et des plumes salariées, le tout constituant un marché aux hiérarchies multiples (avec la vieille règle voulant que le gain symbolique n’aille pas sans un certain déficit financier, et vice-versa). Dans ce circuit, chacun sa position bien délimitée, à la fois sociale et esthétique. De là l’alliance de la tribune, du tribunal et du tribalisme.
Si Internet change quelque chose, c’est moins par la massification dont il est inséparable que par le nouveau rapport au marché des films qu’il installe. Rapport plus distendu, plus lâche, plus flou : l’illimitation de la parole critique sur le web fait sauter l’idée d’un champ organisé par ses bornes. L’absence de salaire, le lien moins ténu avec les gens du métier (cinéastes et producteurs), la fragmentation du public produisent les mêmes effets de brouillage, de dissolution des places. C’est la chance de cette nouvelle critique web, qui autrement pâtit à tous les niveaux, que de pouvoir s’arracher aux anciens circuits de la valeur – elle en produit toujours, mais sous une forme plus volatile – et donc se départir des trois tics sus-cités. Son nouveau rapport au marché est le moyen d’un renouvellement de son écriture. Gain portée par une défaite : car s’il y a émancipation par rapport à certains schèmes critiques, ce n’est qu’en raison d’un effondrement du nombre de lecteurs, en raison d’un public dispersé, et d’une perte de pouvoir symbolique. (Notons tout de même que cette défaite est elle-même le fruit d’une victoire sociale, l’accès de tous et de chacun à l’écriture publique – les forums en sont la quintessence –, fait sur lequel on aurait du mal à se lamenter si tant est qu’on prétend avoir du goût pour l’égalité.)
Ceci seulement pour dessiner la possibilité d’une ouverture. Cette « nouvelle critique », dont la nouveauté tient moins à un schéma de pensée qu’à une réforme statutaire laissant espérer qu’elle fera chavirer les plumes, on ne saurait trop en préciser les contours. Ces quelques pages ne voulaient qu’indiquer une légère refonte des positions sociales et de l’ordre du savoir allant avec. En bref la fin probable d’une critique d’école ou de combat, pour le meilleur et pour le pire.
Cela, Paul Valéry l’avait annoncé il y a belle lurette avec son style impayable, lorsqu’il ouvrit son premier cours au Collège de France par ces mots : « Où va la critique ? À sa perte, j’espère. » Probable qu’il n’appelait pas par là à son abolition pure et simple ; plutôt à ce beau mouvement de d’auto-négation auquel aspire toute pensée qui sait devoir se ruiner pour se mieux rebâtir.