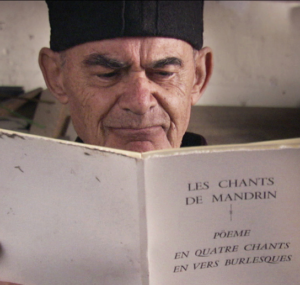Bande de filles, Céline Sciamma
Elle(s)
Sorti le mois dernier, Mange tes morts s’ouvrait, on s’en souvient, par une chasse au lièvre qui donnait aux plaines de l’Oise des allures d’Ouest américain. Le prologue de Bande de filles travaille de la même manière à déterritorialiser le regard. Ce geste, qui mêle à une aspiration réaliste une inspiration cinématographique (sur le versant des genres et de leurs codes), donnait au film de Jean-Charles Hue un souffle qui ne s’épuisait guère qu’au terme de la nuit d’errance et de grâce vécue par les personnages. L’impression est contraire face à Bande de filles : malgré la musique puissante, malgré le sur-découpage, malgré les ralentis, quelque chose ne prend pas. L’amateurisme de ces filles jouant au football américain résiste au désir de Céline Sciamma de « faire cinéma », s’immisçant dans le rythme des plans et leurs raccords jusqu’à produire un décrochage qui affecte la possibilité même de croyance du spectateur. Cette mésalliance entre la fragilité (de l’interprétation) et la force (de la mise en scène), entre le naturel et le volontarisme, n’est pas que ponctuelle. Elle traverse l’ensemble du film, s’avérant particulièrement sensible lorsque la cinéaste décide d’insister, par la durée du plan ou un cadrage qui isole un personnage, sur une réplique. La scène de rencontre entre Marieme et la bande est ainsi grevée, davantage que par la platitude de l’échange, par une mise en scène qui ne laisse aucune place à l’erreur, à la recherche – ce qui fait le prix de l’incarnation par de jeunes acteurs non-formés ou des amateurs -, mais est constamment surdéterminante.
Il est évident que Sciamma, dont les scénarios articulent toujours une quête identitaire à un enjeu de représentation (Naissance des pieuvres sur la sexualité féminine, Tomboy sur le genre), conçoit d’abord ses films dans les creux et les pleins des images existantes. En donnant accès à la représentation cinématographique nationale à de jeunes filles noires vivant dans la banlieue pauvre de Paris, elle fait oeuvre « positive » (comme on le dirait de la discrimination) de visibilisation[11][11] Que cette procédure soit le fait d’une réalisatrice blanche appartenant à une classe sociale supérieure est une affaire non-négligeable, mais différente, et dont il ne sera pas question ici.. Cela est pour elle indissociable d’un mouvement « négatif » ou critique, de retranchement, par lequel elle cherche à se défaire d’un ensemble d’images cristallisées (sur les tours, le prolétariat, la deuxième ou troisième génération d’immigrés, et, évidemment, les filles et les garçons). Le cliché, l’image morte de la jeunesse de banlieue (pour le dire vite), c’est son énergie, sa gouaille, sa spontanéité. Sciamma oppose à cela la rigueur de son récit structuré en chapitres, le refus de la caméra portée, le contrôle de ses actrices (au point que toutes sont d’une terrible fadeur), et une variation dans les niveaux de langage qui ne les cantonnent pas au pittoresque « wesh ». L’ambition est louable, qui tente de penser en cinéma l’advenue de nouveaux corps sur les écrans. C’est pourtant entre ces deux plans, entre l’addition et la soustraction, que le film, incapable de produire ses propres images, se perd. Reste à savoir où, et comment.
S’il est un spectre qui hante aujourd’hui la critique du cinéma français, c’est bien celui du naturalisme. L’usage de ce terme est suffisamment fluctuant pour qu’il puisse désigner une chose et son contraire. Il est en tout cas à chaque fois disqualifiant. Malgré la volonté de stylisation de Sciamma (qui trouve sans doute son acmé dans une séquence déjà célèbre où, dans une lumière bleutée, les filles reprennent, comme en rêve, une chanson de Rihanna), il lui aura ainsi été opposé son faux naturel et sa lourdeur sociologique. Ce problème du naturalisme serait de peu d’importance s’il n’était que l’affaire d’une critique attachée au schématisme de ses catégories d’évaluation (« naturalisme » : mal / « fiction » : bien). Mais, à l’évidence, c’est aussi en ces termes que Sciamma pense la possibilité pour elle de filmer une banlieue et ses habitants – le naturalisme étant la naïveté à éviter. Surtout, c’est le rapport même du cinéma au réel qui est en jeu dans ce partage qui structure le champ du cinéma français. Trop occupée à aller chercher « toujours plus haut » ses cinéastes fétiches, une certaine critique oublie que le cinéma est peut-être le plus prosaïque des arts, le plus terre-à-terre. Il part du réel et il y revient. Ce qui (se) passe entre ces deux moments peut se nommer « fiction », si par là est entendue la capacité de la machine à faire apparaître, dans et entre les plans, ce qui n’avait jamais été vu, ainsi. Le cinéma n’enregistre pas ce qui est ; il fait advenir au visible les virtualités du réel – il invente des réels possibles « à partir de ». Pour cela, il n’est pas interdit d’ajouter à l’optique de la caméra celui de la sociologie ou des sciences humaines – qui ne sont bien sûr pas sans entretenir de liens avec ce qui est censé sauver le cinéma de son démon naturaliste, la fiction[22][22] Voir, par exemple, le texte de Lorenzo Bonoli, « Fiction, épistémologie et sciences humaines », qui offre une synthèse instructive.. Ce travail d’investigation sociologique, c’est par exemple celui que Godard faisait dans Masculin / Féminin : 15 faits précis (sur l’affiche duquel s’étalait, pour rappel, « le sexe et la jeunesse de la France d’aujourd’hui ») ou Deux ou trois choses que je sais d’elle. On ose à peine imaginer la réaction critique si de tels films devaient sortir aujourd’hui. Godard sans doute ne confondait pas la réalité et l’objectif, la fiction et le divertissement.
Si Bande de filles est un film presque totalement raté, ce n’est pas par excès de sociologie, mais par manque. Il ne s’agit pas de regretter l’absence d’un savoir pré-constitué qui permettrait à la cinéaste d’user de ses personnages comme de cas exemplaires afin de tenir un discours surplombant sur l’état des banlieues. Il ne s’agit pas davantage de suggérer que les sciences humaines soient nécessaires pour faire un film sur ou avec des filles-de-banlieues. Mais, puisque Sciamma s’attache à la construction du genre et de la race, on est bien obligé de constater que la sociologie – ou, disons, une approche méthodique d’un terrain et du système des relations sociales qui s’y déploie – manque en tant que moyen et souci. Les questions sociales sont en effet constamment laissées dans les creux du film – à charge pour le spectateur de formuler les hypothèses interprétatives. Un exemple : réduit à l’espace de son salon, le grand frère de Marieme ne peut apparaître que comme une figure “tribale” caricaturale. Sa tyrannie n’aurait pourtant de sens qu’à être inscrite dans le réseau plus large de ses relations avec les autres jeunes hommes du quartier (pour commencer). À cet égard, la naïveté de Sciamma est double : en voulant retrancher les clichés, elle ne fait, faute de construire d’autres images, que les reconduire[33][33] On mesure encore l’absence de dimension sociale, et le schématisme qui traverse tout le film, au fait que le Noir fonctionne uniquement comme signifiant universel, ou transcendant, de l’exclusion, comme s’il n’y avait, par exemple, aucune distinction (de culture, d’Histoire, de rapport à la France) entre ceux qui venaient de pays africains récemment décolonisés, et ceux qui venaient des dom-tom.. Et cela tient à sa conception même du visible. Pour elle, n’existe que ce qui est montré / vu. Respecter le point de vue de ses personnages revient alors à ne donner aucune consistance aux êtres qui pourtant s’inscrivent et définissent leur réseau social, agissent depuis le hors-champ sur le champ. D’où son idée, très limitée, du cinéma comme acte de représentation “positif”, et l’impuissance terrible de son film.
L’absence de hors-champ, limité comme on l’a dit à quelques silhouettes sans vie ni désir, rend toujours problématique le raccord du champ à un contre-champ. Le contre-champ n’existe en réalité que lorsqu’il y a, en face de la bande, de l’identique. Aucun contre-champ ne viendra donner chair à l’institution scolaire lorsqu’il sera signifié à Marieme qu’elle n’a d’autre choix qu’une filière professionnelle. Aucun contre-champ non plus ne viendra montrer les femmes dont la bande commente les tenues lors d’une déambulation aux Halles. Il y aura par contre contre-champ lorsque la bande, rencontrant son double dans le métro parisien, se lancera dans un concert d’invectives. Cela tient autant à l’absence de dimension “sociologique” qu’au fait même que Bande de filles n’est pas un film sur une bande, mais sur le rapport d’un individu à une succession de groupes. Le contre-champ, c’est la bande de filles elle-même, les grappes de garçons en bas des tours, la cellule familiale, le gang de dealers. Ce qui est en face, ce n’est jamais que le même, ou plutôt l’autre vers lequel on tend, dans lequel on va bientôt s’absorber, et qui est déjà comme nous. Voilà le cheminement de Marieme, seul réel personnage du film : sortir de son retrait pour faire corps avec la bande lorsqu’elle est insultée dans le métro ; les regarder chanter Rihanna puis les rejoindre dans le cadre ; se fondre par sa tenue au gang des dealers (en une version extrêmement fade de la Snoop de The Wire, série qui, rappelons-le, n’avait pas peur des sciences humaines).
La construction de soi s’envisage dès lors selon une dialectique élémentaire par où passent les effets de domination : imiter ou être imité. Cela atteint un point de paroxysme lorsque Marieme, d’un côté, revêt la tenue des dealers avec qui elle travaille, et de l’autre, s’habille d’une tenue empruntée à une amie prostituée pour distribuer la drogue dans les beaux quartiers blancs. La négation de son sexe (elle s’aplatit la poitrine à l’aide de bandages) a pour reflet la négation de sa race (elle porte une perruque blonde). Sciamma conçoit cette séquence comme le moment où une fausse liberté économique (avoir son appartement) est la cause d’une aliénation maximale – cela étant la conclusion logique d’un film où le social est toujours considéré sous l’aspect de l’oppression. A défaut de toute dimension politique, Bande de filles ne peut évidemment sauver son personnage des déterminismes qu’à la condition de l’exclure de tout cercle – familial, amoureux, économique,… Voilà la seule voie que Sciamma dessine vers l’émancipation. Ce sujet apolitique, pure individualité soucieuse que d’elle-même, il faudra bien l’appeler, tant les plans finaux du film de Sciamma et de celui de Thomas Cailley se ressemblent, qui montrent leurs personnages tournés de profil vers cet avenir où ils triompheront en ne comptant que sur leurs ressources, un “combattant”. Tel est le héros de notre temps.
Scénario : Céline Sciamma / Directeur de la photographie : Crystel Fournier / Monteur : Julien Lacheray / Compositeur : Para One
Durée : 1h52
Sortie : 22 octobre 2014