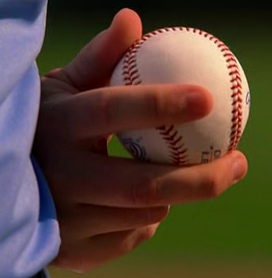Au poste
David Simon et la télévision, une introduction
Pour son premier numéro papier, Débordements a consacré un long dossier au travail de David Simon. Six textes le composent, chacun revenant sur une série ou mini-série, de The Corner (2000) à The Deuce (2017-2019). En voici l’introduction.
Jeune reporter au Sun, David Simon décide de passer le réveillon de Noël 1986 en compagnie des enquêteurs de la police criminelle de Baltimore. L’angle est malicieux, qui croise l’attente routinière d’un homicide aux célébrations de la naissance du Messie. Mais Simon trouve mieux encore au cours de cette nuit : le sujet de sa première grande enquête. Alors que le service touche à sa fin, un policier lance à la cantonade : « Quelle merde on se coltine ici. Si quelqu’un se contentait de coucher sur le papier ce qui se passe dans cet endroit en l’espace d’une année, ça ferait un sacré bouquin. »[11][11] L’anecdote est rapportée par Brett Martin dans Des Hommes tourmentés. Le nouvel âge d’or des séries : des Soprano et The Wire à Mad Men et Breaking Bad (traduit de l’américain par Léa Cohen), p. 188, La Martinière, Paris, 2013. Deux ans plus tard, Simon se met en congé de son journal afin de suivre au jour le jour la brigade dirigée par le lieutenant Gary D’Addario. En résulte Homicide. A Year in The Killing Streets, publié en 1991 aux Etats-Unis et traduit en français sous le titre Baltimore. Une année au cœur du crime. Porté par une recherche obstinée de la précision autant que par un sens aigu de la parabole, l’ouvrage connaît un beau succès de librairie avant de servir de Bible aux séries Homicide et The Wire.
Homicide : Life on the Street comprendra 122 épisodes d’environ 45 minutes. Initiée par le cinéaste de Baltimore Barry Levinson et diffusée sur NBC de 1993 à 1999, elle fait partie de ces séries à la fois novatrices et bientôt rendues caduques par le « troisième âge d’or »[22][22] L’expression est de Brett Martin. Le premier âge d’or correspondrait aux années 1940-1950, le second aux années 1980. Parmi les créations qui ont marqué le début de ce troisième âge d’or, nous pouvons citer, outre The Wire : Oz (Tom Fontana, 1997-2003), Sex and the City (Darren Star, 1998-2004), The Sopranos (David Chase, 1999-2007) ou encore Six Feet Under (Alan Ball, 2001-2005), toutes diffusées sur HBO. de la télévision initiée par HBO. Network soumis à la publicité, et non chaîne payante, NBC se doit d’attirer un public large. Un « cop show » réaliste semble un bon moyen, après le succès de Hill Street Blues (Steven Bochco, 1981-1987). Homicide pousse cependant l’authenticité un cran plus loin, rechignant à user de ce qui fera la longévité d’une de ses concurrentes, NYPD Blue (Steven Bochco et David Milch, 1993-2005) : l’action, la nudité et un langage corsé. Ses inspecteurs ne sont certes pas des saints, mais leur vie sentimentale n’est que peu exposée, et il est bien rare de les voir dégainer un revolver. Leur travail s’appuie avant tout sur l’observation, la parole et la connaissance du terrain. Autre « audace » qui, semble-t-il, jouera en défaveur de Homicide : son casting est trop « noir » pour les spectateurs blancs, et trop « blanc » pour les spectateurs noirs. En se faisant là aussi le reflet de la ville de Baltimore, elle trouble une forme de ségrégation imaginaire très vivace aux Etats-Unis, et d’ailleurs toujours active au moment de la diffusion de The Wire.
Plus encore que dans le ton, les contraintes de production se feront de plus en plus sentir dans la structure des récits et la perfusion régulière d’une bonne dose de spectacle. Enquêtes et épisodes tendent à coïncider, les deux se bouclant le plus souvent en même temps, et quelques situations rocambolesques ne manquent pas de surgir à l’occasion, bien loin des crimes de rue liés à la drogue, comme lors de cet épisode consacré à la lente agonie d’un homme coincé entre une rame de métro et un quai de gare. Si elle a souffert d’un manque de succès obligeant l’équipe à la rendre toujours plus « lisible » et « attrayante » – ce qui se traduira notamment par un rajeunissement et un « embellissement » du casting, des couleurs moins ternes et une esthétique globalement plus lisse, reposant moins sur la caméra portée ou les jump cuts –, Homicide demeure riche d’une ambition formelle, politique et morale rare dans le cadre de la fiction télévisuelle d’alors[33][33] Même s’il ne s’agit pas exactement d’une série « de David Simon », nous regrettons de n’avoir pu, pour des raisons éditoriales, lui consacrer le texte qu’elle mérite. Pour une analyse intéressante et une description précise des conditions de production, nous renvoyons à David P. Kalat, Homicide : Life on the Street. The Unofficial Companion, Renaissance Books, Los Angeles, 1998. Bien que publié avant la septième et dernière saison, cet ouvrage reste un guide précieux.. Les sarcasmes de John Munch sont aussi mémorables que les questionnements métaphysiques de Frank Pembleton ou les doutes de Tim Bayliss, et bien des épisodes frappent encore par leur intensité dramatique. En témoigne « Three Men and Adena » (S01E05), qui se concentre quasi-exclusivement sur l’interrogatoire d’un vieux marchand de fruits accusé du meurtre d’une petite fille. Ce dernier est d’autant plus remarquable que la vérité finit par échapper aux inspecteurs – l’affaire, inspirée par le meurtre réel de Latonya Wallace, ne sera d’ailleurs jamais résolue, les sept saisons se déployant autour de cette faille. De façon générale, la découverte même des meurtriers est rarement source de consolation : l’absurdité ou la banalité des motivations, quand ce ne sont pas les dysfonctionnements de la justice, confrontent les inspecteurs à la vanité de leur métier. Une plainte se fait déjà entendre, dont l’écho ne cessera de s’amplifier, même s’il s’agit toujours de la nuancer, la moduler, voire la contredire : en dépit des bouleversements, rien ne change jamais.
D’abord ponctuelle, l’implication de Simon dans l’écriture puis la production de Homicide ira croissante au fur et à mesure qu’il s’éloigne de la rédaction du Sun. Réputé pour avoir accueilli quelques-unes des plus grandes plumes de la presse américaine, dont celles de H.L. Mencken ou Russell Baker, ainsi que les photographies d’A. Aubrey Bodine, le Baltimore Sun subit durant ces années une profonde restructuration économique et éditoriale. « Au milieu des années 1990, il y avait une telle malhonnêteté intellectuelle et une telle soif de prix au Sun que j’ai réalisé que tout ce que j’avais aimé dans ce journal était en train de disparaître et qu’en fin de compte, l’artifice d’une fiction télévisuelle n’était plus, en comparaison de l’artifice d’une campagne conçue pour le Pulitzer, qu’un péché véniel. »[44][44] Brett Martin, opus cité, p. 207. Avec son ami David Mills, il se lance en 1993 dans l’écriture d’un scénario. Jugé trop sombre pour intégrer la première saison, « Bop Gun » ouvre la deuxième, NBC comptant sur la présence de Robin Williams dans le rôle principal pour attirer de nouveaux spectateurs. Entamé par l’assassinat d’une femme venue visiter « Charm City » en famille, il accompagne le mari dans son errance administrative et sa douleur avant de s’achever dans la prison où le meurtrier apparaît lui-même comme une victime des forces sociales. Plutôt que de multiplier les intrigues, « Bop Gun » se consacre à une situation dont il déplie toute l’ambivalence, déjouant par là même la volonté de clôture – résolution et jugement – qui préside ordinairement au récit policier.
Au contact de Barry Levinson, mais aussi de James Yoshimura, qui lui conseille d’aller relire Tchekhov, et de Tom Fontana, qui dirigera plus tard Oz, l’œuvre qui lui a laissé entrevoir la possibilité de récits plus complexes et engagés à la télévision, Simon intègre les contraintes et les codes de l’écriture audiovisuelle. Malgré ses limites, Homicide s’avère une école et un laboratoire formidables, et certains segments de The Wire – en particulier la mise sur écoute d’un avatar d’Avon Barksdale – connaissent là une première ébauche. Bien qu’ayant par la suite dénigré l’usage de certaines ficelles scénaristiques, comme la multiplication des « red balls », ces enquêtes prioritaires qui rompent avec le quotidien en mobilisant soudain tous les moyens de la police, le showrunner saura s’en souvenir au moment de conclure la première saison de The Wire, lors du double épisode qui voit Greggs tomber dans un guet-apens. A travers le personnage de J.H. Brodie, un jeune cameraman maladroit ne jurant que par Frederick Wiseman, il est possible également que Simon trouve l’un de ses doubles fictionnels les plus transparents. La télévision ne saurait néanmoins encore tout à fait le satisfaire, et ces années sont rythmées par l’écriture, en collaboration avec Edward Burns, de The Corner. A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood. La transition entre journalisme et série s’achève en 2000 avec l’adaptation pour HBO de cette enquête au long cours menée dans un quartier de Baltimore dévasté par la drogue. Depuis, Simon n’a cessé de tourner, bâtissant de projet en projet une œuvre qui semble sans équivalent dans l’histoire de la télévision américaine.
A l’évidence, un tel travail n’aurait pu être accompli sans le modèle économique et artistique développé par HBO à la fin des années 1990 sous l’impulsion de Chris Albrecht et Carolyn Strauss. Certes, il a fallu plus d’une décennie pour que Show Me a Hero aboutisse, et The Wire a été presque constamment menacé de non-renouvellement. Mais chaque récit a pu, à quelques épisodes près pour The Wire et Treme, être développé pleinement. Du point de vue de la fiction, il suffit de décrire le rôle que tient la télévision dans The Corner – le livre comme la série – pour saisir ce que HBO a modifié dans le paysage. Ainsi de cette scène, qui survient après que l’une des figures principales s’est vu refuser l’entrée en cure de désintoxication : « Le visage éteint, Fran se glisse dans l’appartement, pose ses sacs et tape à la porte de la chambre de son frère, au cas où. La pièce est tapissée d’une lueur orange émanant du poste de télévision détraqué de Stevie. Alors qu’elle s’écroule sur le lit, elle entend Little Stevie dans le couloir qui crie à DeRodd de monter pour l’aider à réparer son pneu de vélo. La télévision du salon diffuse I Love Lucy avec le volume poussé au maximum. Dehors, c’est le vacarme habituel, seulement troué par le chant aigu de ceux qui font l’article pour leur drogue. Elle pleure comme elle n’a pas pleuré depuis des années. »[55][55] Notre traduction. David Simon et Ed Burns, The Corner. A Year in the Life of an Inner-City Neighboorhood, p. 338, Broadway Books, New York, 1997. Cette violence d’un divertissement saturant l’espace sans avoir pourtant le moindre rapport avec ce qui s’y vit affleurait déjà, bien que sur un autre plan, lors d’une discussion entre les inspecteurs Bayliss et Pembleton dans Homicide : « – Tu as déjà regardé I love Lucy ou The Dick Van Dyke Show sur Nickelodeon ? Les gens n’étaient pas si violents à l’époque. Les séries sont les reflets de leur temps. – Est-ce que l’une de ces séries montraient des gens habillés de draps blancs brûlant des croix et lynchant des gens dans leur jardin ? »
Que le réalisme de Simon ait consisté à témoigner de l’épaisseur d’existences ordinairement négligées, et à les relier politiquement au destin de la communauté, ne doit pas occulter le travail spécifique de la fiction. Si son obsession du détail authentique lui a valu de la part de Tom Fontana le surnom de « non-fiction guy », les textes qui suivent témoignent assez de l’importance de la mise en récit, de la parole, de l’incarnation et du jeu dans sa recherche. Mais il faut encore mentionner une chose : moins évidemment hantées par les destins croisés du cinéma et de la télévision que The Sopranos, les séries de Simon n’en sont pas moins friandes de références cinéphiles. Dans The Deuce, des affiches de Jules et Jim, Entre le ciel et l’enfer et Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia décorent le bureau du réalisateur de pornos Harvey Wasserman, Blue Collar aiguillonne la conscience sociale d’un mac et l’acteur Woody Strode sert de modèle de dignité. Durant l’écriture de The Wire, les scénaristes s’étaient passés le mot pour glisser tout au long de la deuxième saison de nombreux dialogues issus de La Horde sauvage, manière de renforcer l’inscription du récit dans le genre du western. Evoqué au détour d’un dialogue dans The Wire et cité à travers un extrait dans The Deuce, Le Pont de la rivière Kwaï peut apparaître comme un film matriciel, tant pour le rapport aux morts et à l’honneur que pour le lien métaphorique qu’il initie entre histoire et chemin de fer. Enfin, pas une série depuis Homicide n’a fait l’économie d’un hommage à cette figure légendaire de Baltimore qu’est John Waters, que ce soit à travers un caméo ou la mention d’un de ses films. On le comprend, rendre compte du travail de Simon, c’est aussi s’attacher à cette chair fictionnelle qui n’a rien d’incident ou de secondaire, malgré la formation journalistique de son auteur et la prégnance des questions sociales ou politiques qu’il soulève.
Cette alliance de l’enquête et de la fiction se manifeste de façon exemplaire à travers la liste des scénaristes de The Wire : s’y mêlent en effet auteurs de romans noirs ou de polars, comme Richard Price, Dennis Lehane ou George Pelecanos, et anciens camarades du Baltimore Sun, comme Rafael Alvarez ou William F. Zorzi. « L’écriture commençait toujours par une réflexion de David ou d’Ed [Burns] basée soit sur une référence historique, soit sur une expérience personnelle. Partant de là, nous sautions dans la fiction. Le noyau était factuel, mais la terre dans laquelle il poussait était l’univers de la série, sa mythologie. », dira Chris Collins, un des collaborateurs de The Wire. Cette étape est un moment marqué par de vives discussions, comme l’explique Simon : « [Cela] fait partie du processus de création. Quand quelqu’un arrête de se disputer, c’est qu’il n’en a plus rien à foutre. […] On se réunit entre auteurs pour cela. Confronter nos idées et construire une argumentation dans les règles de l’art, même si on s’énerve parfois. […] Quand la série n’est plus l’œuvre que d’une seule personne, l’univers en souffre. Il est impossible de donner à tous ces personnages si différents le souffle qu’il mérite. »[66][66] Notre traduction. Propos cités par Jonathan Abrams, All the Pieces Matter. The Inside Story of The Wire, p. 150, Crown Archetype, New York, 2018.
A travers les séries, et avec Blown Deadline, sa maison de production, il est finalement possible que Simon ait retrouvé un collectif de travail comparable à la rédaction du Sun, où l’excitation, l’émulation, l’exigence mais aussi la camaraderie et le sens de la dérision servent de valeurs cardinales. De fait, des noms ne cessent de revenir d’un générique à l’autre depuis maintenant vint-cinq ans, et cela à des postes souvent différents : James Yoshimura, scénariste et/ou producteur sur Homicide et Treme ; Nina K. Noble, productrice et/ou co-productrice exécutive sur The Corner, The Wire, Show Me a Hero et The Deuce ; David Mills, scénariste et/ou producteur-exécutif sur Homicide, The Corner, The Wire et Treme ; Eric Overmyer, scénariste, producteur et/ou co-auteur sur Homicide, The Wire et Treme ; Robert F. Colesberry, producteur, producteur-exécutif, réalisateur et/ou acteur sur The Corner et The Wire, sans parler de George Pelecanos, auteur pour The Wire et The Deuce, ou encore d’Ed Burns, ancien policier et enseignant avec qui il co-écrit The Corner puis collabore pour The Wire, Generation Kill et The Plot Against America, actuellement en cours de développement. Une telle fidélité, peut-être unique dans l’histoire du médium, se découvre également de l’autre côté de la caméra. Nombre d’acteurs de Homicide et de The Corner, aperçus parfois le temps d’une scène ou d’un plan seulement, habitent toujours l’univers de Simon.
Si le « troisième âge d’or » de la télévision a pu se définir par la production de séries plus exigeantes, ambitieuses, adultes, complexes, autant d’adjectifs qui mériteraient bien sûr discussion, celui-ci a aussi favorisé un certain type de réception. Ce n’est pas sans raison que The Wire a vraiment commencé à être discutée et critiquée à partir du moment où elle a circulé en DVD – et, plus tard, en téléchargement. Il fallait la voir et la revoir pour qu’à travers le défilé des épisodes et la familiarité avec les personnages se découvrent pleinement la minutie d’une écriture et la consistance d’un monde. C’est cela qu’il convient maintenant de décrire, pas à pas, série après série.
Cliquez pour commander le premier numéro papier de Débordements.